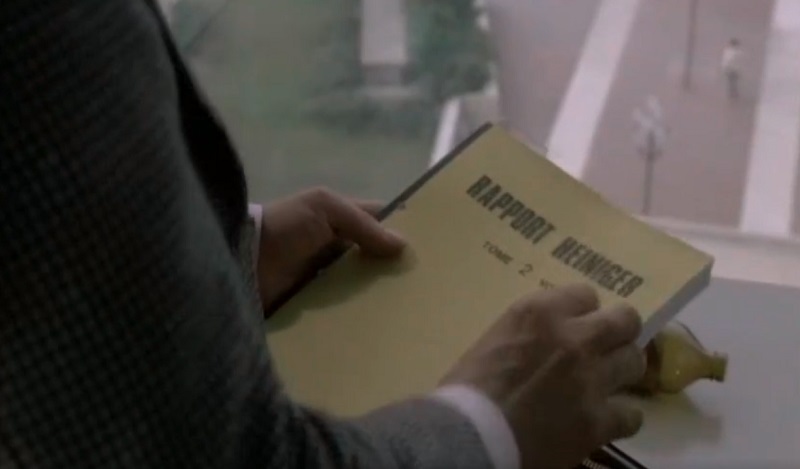Image de la virilité
Qu’est-ce qui faisait la qualité de Terminator ? La vulnérabilité de l’humain venant du futur, nu et désarmé, venant y affronter une machine à l’apparence d’un zombie ou d’un Argonaute de Ray Harryhausen quasiment invulnérable.
Par la suite, dans le cinéma de James Cameron, en dehors de quelques éléments qui, épisodiquement, permettaient à ses films de sortir de l’ordinaire, il y a toujours eu cette marque très prononcée de la virilité envahissante (quitte à y intégrer des personnages féminins plus virils encore, cf. Vasquez dans Aliens ou un autre dans Abyss). Cameron a beau avoir mis en scène le second Alien, il n’en a probablement jamais reconnu la spécificité ; en tout cas, il lui avait apporté une touche supplémentaire, virile et belliqueuse, dont la franchise aurait pu tout autant se passer (même si l’idée de laisser des cinéastes poser leurs pattes sur la franchise donnera le ton pour les suivants).
Il y a chez Cameron un côté Roland Emmerich qui, en dehors de ses qualités intrinsèques, m’a toujours un peu rebuté. L’Allemand, comme le Canadien, cherche à se présenter plus américain que les Américains. Cameron semble ainsi être toujours dans la surenchère : ses femmes soldats doivent être plus badass que Ripley, ses effets spéciaux, plus innovants, et donc ses Américains, plus Américains que la moyenne, et plus cools aussi… Le personnage de Cameron, le prototype du personnage cameroonesque, c’est l’homme viril du Sud. C’est le soldat qui partage les valeurs de camaraderie, presque sportives, avec ses partenaires (tout dans les gesticulations des personnages de soldats rappelle l’univers du foot américain). On peut y voir une forme de constance et mettre ça au crédit d’un « auteur », mais à quel moment cela devient-il la spécificité, la marque d’un cinéaste, et à quel moment ce cinéaste se réfugie-t-il derrière des modes, des futilités ou des facilités en reproduisant des codes répétés par d’autres (Oliver Stone et John McTiernan en particulier), et à quel moment commence-t-il à se parodier lui-même ou à ânonner une partition lui ayant assuré un succès passé ?
On n’est plus en 1980. De Abyss à Titanic, Cameron a parfois su proposer autre chose que ces pitreries virilistes d’un autre siècle, ce qui lui permet (lui, au contraire d’autres cinéastes des années 80) de continuer à proposer ses horreurs bleutées au public. Et s’il le suit, c’est probablement uniquement parce qu’il s’intègre dans une autre mouvance du cinéma américain qui est celle des fantaisies (rendues possibles par les avancées technologiques dont, c’est vrai, il a participé). Si la mode s’essouffle un jour ou si, au contraire, d’autres viennent combler les failles des productions précédentes, rien ne dit que les « grands bleus » de Cameron fassent date. Justement, tout ce qui restera de ses films (l’histoire, les relations stéréotypées entre les personnages) n’aura-t-il pas affreusement vieilli ? La vulnérabilité de l’homme face à la machine, c’est un sujet universel. Roméo et Juliette transposée au microcosme en décomposition du Titanic, c’est universel. L’invasion d’un peuple par un autre, c’est universel. Mais l’invasion d’un peuple par un autre traitée à travers un prisme si démodé, l’est-ce toujours autant ?
Si Terminator tenait sa réussite de la vulnérabilité de son voyageur temporel (et de son personnage féminin, là encore, qui a des “couilles”), on retrouvait ça dans les Star Wars dont les types de relations inspirées des screwball comedies des années 30 mettront bientôt au placard les relations rétrogrades entre hommes et femmes redevenues la norme dans les années 70 malgré les mouvements de contre-culture qui foisonnaient à la même époque aux États-Unis (jusqu’à la Princesse Leia — qui n’avait rien du prototype de princesse des contes de fées, et tenait donc plus de la femme émancipée du cinéma pré-code —, cette contre-culture a surtout été, au cinéma, le fait des hommes : dans Bonnie and Clyde, dans Le Parrain ou dans Taxi Driver, on se rappellera du type de personnage qu’interprète Faye Dunaway, Diane Keaton et Jodie Foster ; Easy Reader est un trip entre potes, etc.). Je porte peut-être trop d’importance à la révolution qu’aurait pu susciter la nature du personnage de Leia sur la société, mais je reste pourtant encore persuadé aujourd’hui que c’est lui qui a permis l’enchaînement de tout ce qui suivra concernant la place de la femme au cinéma. Sans Leia, je ne suis pas sûr qu’on aurait eu ainsi immédiatement après le personnage de Ripley, ni même celui de Sarah Connor.
Les années 80 feront alors de la résistance, comme une forme de contre-réforme, en insistant sur un mode de vie à l’américaine où la femme est au foyer (parfois, elle y élève seule ses enfants, comme dans E.T.) et où l’homme expose ses muscles surdéveloppés dans un environnement hostile. Mais la société s’inspirera d’une nouvelle forme d’égalité illustrée par certains cinéastes, et le cinéma inspirera, de son côté, des nouvelles aspirations à l’égalité, que ce soit chez les femmes ou les personnes de couleurs. Soft power.
Cameron ne se situe pas vraiment dans cette mouvance. C’est tout de même fort d’imaginer tout un environnement et une ethnologie extraterrestres et arriver à retomber sur ses pattes en recyclant les mêmes clichés relationnels des films américains des années 80, voire des films ou séries pour ado. Même les mimiques des acteurs qu’on devine derrière leur masque numérique bleu reproduisent des expressions particulièrement expressives mais débiles des Américains pour qui il semble toujours si indispensable de paraître cool, amusant, plein d’esprit, courageux, aimant les défis, dragueur, taquin, moqueur, de posséder un esprit de camaraderie (et de compétition), etc. Les filles ne manquent pas, bien sûr, d’être douces, et si elles sont déterminées, elles sont aussi plus habiles ou légitimes que d’autres à diriger des séances de yoga, à canaliser la puérilité ou l’agressivité des hommes (ou des frères), à nourrir les poissons ou à préparer des bentos. Enfin, elles sont encore plus susceptibles de ne pas supporter les drogues hallucinogènes du grand arbre spirituel… Ah, la douce princesse qui s’évanouit… Toujours le bon filon pour donner le beau rôle de sauveurs aux garçons… American Pie à Pandora. C’en est presque embarrassant.

Murène, murène, dis-moi qui est la plus docile
Virilisme, écologie et ethnographie
Du virilisme à la surexploitation, il n’y a qu’un pas. Cameron fait mine peut-être de proposer des films “écolos” avec cette série de films Avatar, et je ne doute pas des bonnes volontés du réalisateur, sauf que plus il semble chercher à montrer les vertus du monde et des personnes qui y vivent, plus il force le trait, plus j’ai l’impression qu’il a définitivement fait le choix de s’intéresser plus à la machine qu’à l’humain vulnérable issu du futur qui avait fait le succès de son premier film. Si l’on vous proposait de revenir quarante ans dans le passé, choisiriez-vous de le faire sous les traits d’un homme chargé de sauver la planète ou seriez-vous une machine tueuse, monsieur Cameron ?
Presque un siècle après, Avatar et sa suite me font ainsi penser à L’Oiseau de Paradis. Tous les clichés virilistes, suprémacistes, coloniaux, religieux y passaient. La nature y est belle comme sur une carte postale, et ceux qui l’habitent paraissent incapables de l’apprécier à sa juste valeur. Déjà émergeait l’idée qu’il fallait la préserver des “Occidentaux” (des humains, dans Avatar), mais peut-être aussi un peu des autochtones eux-mêmes (trop ignorants des richesses qui les entourent). Bien entendu, la vision de ces mondes exotiques est fausse, tronquée et idéalisée. Ici par exemple, tout est propre, la terre et l’eau ne sont jamais sales, on se roule dans l’herbe qui donne l’impression de sortir de la machine à laver ; on n’y devine ni moisissures, ni poussières, ni tache, ni déjections, ni maladies ; on y croise peu d’insectes ou de prédateurs et quand on le fait, ils obéissent clairement à cette nécessité de voir les choses, les espèces, de manière binaire (les mouches représentent la putréfaction des corps, les prédateurs sont des monstres, des nuisibles, qui en dehors de leur statut de prédateurs n’ont aucune existence propre, au contraire de toutes les espèces « domestiquées », sagement mises à disposition des espèces humanoïdes qui leur sont supérieures et à qui, par conséquent, elles doivent obéir). Un paradis aseptisé par le bleu des chiottes. Voilà, en somme, une étrange image de paradis : un fantasme qui en dit surtout long sur l’idée que se fait l’homme occidental, dit civilisé, urbain, sur le monde sauvage, un monde qu’on irait volontiers découvrir en safari afin de conforter nos préjugés, un monde qui ne chercherait jamais à contredire nos stéréotypes, nos fantasmes, et nous assurerait que l’on se taille toujours la part du lion.
On en profite pour faire de l’appropriation, ou de l’assimilation, culturelle, on ne sait au juste. Le mythe du bon sauvage n’est pas loin : on applique à des peuples censés être extraterrestres des usages bien de chez nous (certains signes distinctifs rappellent ceux des peuples dits sauvages, indigènes ou, comme on dit dans l’Arkansas, « natifs »). Le récit se porte peut-être davantage du côté des indigènes (et encore), mais on en est encore même plus à l’époque des années 80, mais aux années 60. Avatar devient alors un vulgaire western avec des cowboys et des Indiens. Et on peine parfois à savoir de quel côté Cameron se place. Peut-être dénonce-t-il justement cette sorte d’hubris dévastatrice de l’humain sur la nature et sur les siens qui sont en marge, le problème, à force d’y revenir toujours depuis Aliens, c’est que c’en est devenu un credo. Montrer à chaque occurrence filmique des mâles musclés et vulgaires au comportement de cowboys, ce n’est plus de la dénonciation, c’est de la fascination. Le doute peut être permis au premier essai, mais parfois, à force d’insister et de ne plus savoir dans quel camp il se trouve — effet Tueurs nés —, on serait presque convaincu que Cameron se sente quelques réelles affinités avec les mâles du Sud des États-Unis ou des campagnes et votant pour Trump tant cette figure du mâle viril tout-puissant est une obsession chez lui depuis quarante ans.
Le bleu, c’est pratique, quand on plonge dans l’océan, pas une algue, pas d’impuretés, de prédateurs, de poussières, rien, une véritable piscine aseptisée, comme tout le reste d’ailleurs. Curieuse conception d’un environnement sain et paradisiaque. D’un côté, Cameron cherche à montrer tout son sérieux quand il imagine des vaisseaux spatiaux pour faire hard SF, paraître réaliste, et de l’autre, tous les environnements proposés sont fâcheusement aseptisés. La hard ecology n’est pas pour tout de suite. Ça marche bien le blue washing ?
Et puis, le bleu reste du maquillage. L’exploitation de la nature qui est faite des Na’vis n’est finalement pas aussi vertueuse que le film pourrait le laisser penser. Quand l’environnement décrit n’est qu’un fantasme, même les usages qui s’y appliquent sont des fantasmes : on y retrouve, collés aux peuples autochtones, traduits de manière allégorique, cosmétique, tous les enjeux, les impératifs, les codes ou les usages des peuples de villes bien humaines. Ces Na’vis n’ont rien d’authentique, ce ne sont que des humains (Américains) déguisés. Et finalement, Cameron ne semble pas avoir compris grand-chose des causes de la surexploitation de l’environnement et du besoin d’exploration (et d’expropriation). Les séquences idiotes de concurrences entre jeunes Na’vis, c’est un calque parfait d’un mode de vie à l’américaine. Cameron irait faire un stage en Sibérie, en Afrique ou en Amazonie, et il devrait être capable de comprendre que ces comportements n’ont rien d’universel et qu’ils illustrent au contraire un rapport à la nature, à la surexploitation, à la concurrence, à l’appropriation qui n’est pas compatible avec un respect de l’environnement. Ses petits hommes bleus sont des envahisseurs en puissance, ils ne vivent déjà pas en symbiose avec leur environnement, ils l’exploitent. La différence avec les humains, c’est qu’ils n’ont pas les mêmes moyens technologiques à leur disposition. Je suis sûr que les ados d’American Pie se croient également très… spirituels. Eux aussi interagissent, même au sein d’une même famille, selon les bons codes de l’armée américaine (ordre et loyauté au chef, au patriarche). Eux aussi doivent penser que s’il y a des prédateurs dans la ville, une baleine viendra les tuer pour les sauver, parce que la seule vie non humaine que l’on tolère, c’est bien encore et toujours une forme de vie qui nous apporte un service. Même les anémones de mer géantes, si on se connecte spirituellement à elles, au lieu qu’elles nous répondent qu’elles s’en battent les couilles de nos problèmes de guerre, elles se mettront au service de la seule espèce qui vaille sur cette planète : les Na’vis. Pandora est en cela plus un laboratoire, un cirque humain, un parc aquatique qu’un modèle de monde durable. Les espèces n’y sont pas autonomes : comme sur Terre, on tolère leur existence si on peut en tirer avantage ou profit. Les espèces de la mer d’Avatar sont une transposition des serviteurs équestres de l’homme : tu siffles, et ton esclave arrive à la rescousse. Regardez comme je suis écologiste, je possède un delphinarium.

Cheval de Troie de la surexploitation prenant son envol sous les fesses d’un géant
Virilisme et esthétique (relation des personnages, type de récits)
À la longue, cette gloire à la virilité dans un monde théoriquement étranger à nos usages peut même passer pour ridicule, à la Matamore ou à la Starship Troopers. À l’insu de Cameron, d’ailleurs. Car, autre spécificité de son cinéma, le cinéaste reste étranger au second degré. Le rendant d’autant plus ridicule. L’humour chez Cameron n’y apparaît que pour user de moqueries prétendument spirituelles visant à challenger des partenaires — l’esprit d’équipe, si caractéristique des groupes sportifs ou militaires, a remplacé le sens de l’honneur autrefois spécifique à la virilité « chevaleresque » et précisément moqué de Matamore à Don Quichotte. Mais ces outrances viriles sont assumées. Or, l’outrance, quand elle n’est pas l’instrument d’un second degré, est risible. On serait même en droit de nous demander si ces deux films Avatar ne constituent pas un prequel au film de Paul Verhoeven dont le monde inhospitalier, désertique et peuplé d’insectes tueurs pourrait être le monde des Na’vis touché par les mêmes maux que le monde terrestre quelques siècles plus tard.
Sur l’aspect contextuel, environnemental, esthétique du film, cet accent viriliste « premier degré » n’est pas sans conséquences. Même au niveau des groupes relationnels (les bons, les méchants, les chefs, les esclaves volontaires), et en particulier entre hommes et femmes, tout paraît absolument fade, stéréotypé et sans intérêt. Pendant que Disney (qui n’est pourtant pas très woke) arrive à produire des séries Star Wars uniquement composées de femmes au sein des personnages principaux sans que ça ne pose problème (et au contraire, parce que ça va dans le sens de la société et de l’histoire), Cameron en est encore à des types de relations qui posaient déjà un malaise dans les productions de la première moitié du XXᵉ siècle. Les mâles sont invariablement grands et musclés, destinés à être des leaders et à s’ancrer dans une société, qu’elle soit humaine ou na’vi, aux valeurs conservatrices, voire réactionnaires. Les petits garçons veulent et doivent ressembler au père protecteur de sa famille et de son clan, et quand un petit humain a grandi parmi les « bons sauvages », il n’y est pas dépaysé parce que les valeurs y sont finalement calquées l’une sur l’autre. Seule la couleur du pagne change. De la même manière, les femmes sont toujours en soutien de leur « maître mâle », dociles, dévouées au mari, à leur progéniture et à leur clan, agiles guerrières (c’est déjà ça de gagné) ; et les petites sont déjà prêtes à se montrer tout à fait jolies et dociles pour répondre aux ordres des puissants ou à se mettre en retrait pour mettre en valeur ceux destinés à mener la meute. Je ne suis pas le plus grand défenseur des mouvements féministes de ce siècle (qui s’attachent trop à des faux problèmes en oubliant l’essentiel, à mon sens), mais quand on voit le traitement fait dans ce genre de films des relations entre hommes et femmes, on a envie de faire la révolution, et on se demande en fait quels épisodes de l’histoire ceux qui l’ont écrite (cette histoire) ont manqués pour en rester à des principes relationnels que l’ont pensait définitivement ringardisés. Comme un symbole, le personnage que joue Sigourney Weaver est plongé dans un sommeil profond. Ne te réveille surtout pas, mémère, tu prendrais le lead. Laisse-le aux hommes, ils sont là pour ça, « ça va bien se passer ».
Dernière chose, d’habitude, dans les films d’extraterrestres, ce sont les humains qui sont les exploités. Si le retournement ici peut sembler une bonne idée, son inefficience est palpable : à force de reprendre les codes des films virils et patriotiques humains pour sauver l’humanité des méchants envahisseurs pour le compte des Na’vis, on se demande bien à quoi peut bien servir ce retournement. Pourquoi devraient-ils être sauvés si, finalement, tout bons sauvages qu’ils sont, ils n’en sont pas moins exactement faits à l’image de leurs envahisseurs ? Cameron, comme c’était déjà le cas dans Aliens (voire, d’une certaine manière, dans Titanic), s’intéresse beaucoup moins à raconter une histoire qu’à illustrer le déroulement d’une opération militaire. Et le problème avec des films d’action, c’est qu’ils sont répétitifs, et en dehors de quelques exercices de style rares et réussis, quand l’action prend le pas sur l’environnement et les personnages, sur les enjeux, elle dévore tout. Supprimez l’action, et les failles du récit apparaissent au grand jour. Un objectif immédiat (les histoires de Cameron s’étalent rarement au-delà de deux ou trois jours), et on s’en écarte finalement assez peu. C’est quoi l’intérêt de décrire tout un univers, une planète extraterrestre, des peuples, si l’objectif du film se limite à aller capturer un chef adverse ? Sérieusement, dans une histoire, il n’y a de matière ici que pour un premier acte. L’aspect politique, voire spirituel, la profondeur des personnages et leurs relations, soit ça se résume à quelques idées qui tiennent en deux lignes et qui n’ont qu’un intérêt cosmétique, soit on s’appuie sur des clichés et des platitudes pour se rassurer et plaire au plus grand nombre. Et dans tous les cas, on ne fait qu’effleurer l’univers proposé.
C’est toute la différence entre « action » et « événement ». Parfois, une histoire, c’est opérer un dialogue en « action » et « réaction ». Une histoire, c’est aussi souvent une suite d’événements sans corrélations immédiates (et pour éviter les coïncidences, on n’a d’autre choix que d’étirer ces événements sur un temps long), c’est une transformation progressive des enjeux et des positionnements « moraux » des personnages (et pour éviter les facilités de retournement, on n’a d’autre choix que de jouer sur l’insistance, sur un semblant de répétition). S’il n’y a que de « l’action », cela devient un peu unidimensionnel et le récit ne s’applique qu’à mettre en scène un événement unique. Maigre pour une histoire. Ça marche pour les films catastrophes qui, par définition, ont un événement d’ancrage suffisamment important pour constituer une histoire autour d’un événement unique : ce qui est légitime pour Titanic ou Abyss paraît moins évident pour Avatar. Cameron aurait tout à fait pu recentrer son récit dans ce style, en se focalisant sur trois unités : un seul lieu, un seul événement, et une durée limitée. Mais le simple fait de choisir d’adopter deux points de vue (humains et na’vi) et de les opposer à travers un récit en montage alterné interdit cette possibilité. Le récit hybride entre un style opératique et un autre « catastrophique » échoue ainsi à construire sa propre cohérence. Mais est-ce que Cameron et son public s’attachent à de tels détails ?… Probablement pas.