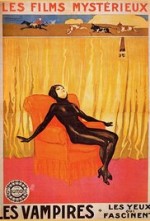Quatre ans après son film en faveur des objecteurs de conscience, Tu ne tueras point, Claude Autant-Lara s’attaque à un autre sujet engagé et « clivant », voire impopulaire : l’avortement. Un avortement qui se pratique largement dans le pays, mais qui, pour être encore clandestin, a des conséquences sanitaires graves. En filigrane, c’est donc plus largement la condition de la femme (que ce soit celle de la femme médecin ou encore de la femme enceinte qu’elle soit mariée ou non, qu’elle l’ait choisi ou non) qu’aborde le film. Il le fait à travers le récit d’une interne en gynécologie racontant parallèlement sa propre découverte de sa grossesse, les implications sociales que cela entraîne, et la mort tragique d’une de ses patientes décédée à la suite des complications survenues après un avortement (et après un défaut d’information).
J’ai loué par le passé les qualités de direction d’acteurs d’Autant-Lara, ici, il faut se coltiner un acteur franchement pénible et mauvais aux côtés de l’excellente Marie-José Nat (le réalisateur doit avoir sa part de responsabilité : il ne semble pas avoir accordé la même attention au travail de préparation qu’implique l’interprétation d’un personnage aux pratiques médicales spécifiques avec l’actrice qui devra par exemple reproduire un accouchement difficile et un acteur qui se contente de foutre ses mains sur les hanches et de faire le beau). Une fois passé l’agacement (qui se mêle d’ailleurs assez vite à son personnage de Don Juan salopard), on est pris par le sujet du film. Et c’est du brutal. Du très brutal.
Le film, inspiré du roman d’un écrivain lui-même médecin, a une visée parfois presque plus clinique que morale, politique, sociale ou philosophique. Avant de se prononcer sur la condition de la femme, sur le droit à l’avortement, sur la contraception, autant montrer ce que cela signifie pour une femme en 1960, soit de n’être considérée que comme une pondeuse pour la société et un mari, soit de se faire avorter clandestinement (avec les conséquences sociales, sanitaires, voire pénales, que cela implique). Quand on parle de quelque chose, il faut montrer de quoi on parle. Frontalement. Et l’idée de dévoiler la réalité des femmes à travers deux destins (l’une sur la voie de l’émancipation, l’autre sur celui d’un chemin de croix) est tout indiquée pour illustrer la question de la condition de la femme au milieu du siècle dernier.
On réfléchit aujourd’hui à l’idée de mettre l’avortement dans la constitution, en dehors du fait que c’est surtout une énième manœuvre de Macron pour détourner l’attention quand il flirte en réalité avec l’extrême droite, je doute que cela ait un grand intérêt politique. Ce qui en aurait un, en revanche, ce serait de diffuser ce film tous les ans sur le service public, histoire de nous rappeler ce qu’étaient les conditions sanitaires et la place des femmes dans la société dans les années 60. Parce que si, aujourd’hui, il y a encore des antivax (avant même la pandémie) qui pensent que c’est inutile de se vacciner avant d’attraper un truc et d’aller le refiler, au hasard, dans des pays ne disposant pas d’une couverture vaccinale suffisante, s’il y a encore des gens pour penser qu’un passage à l’hôpital est anodin, s’il y en a encore qui pensent que, bof, avant la contraception, on devait bien s’arranger d’une manière ou d’une autre…, eh bien, oui, le film montre à tous ceux-là de manière très clinique la brutalité que c’était en 1960 de ne pas recevoir de conseils contraceptifs, de pratiquer un avortement clandestin, de devoir faire face aux risques hémorragiques ou infectieux, même pris en charge par la médecine de l’époque. Le tout, avec la peur de se faire dénoncer, ou le risque de voir un flic débarquer sur votre lit de mort pour interroger les médecins sur les raisons des complications qui vous ont tiré vers la tombe.
Quelle chance a-t-on : juste avant de foutre le feu à la planète entière, on aura résolu pas mal de problèmes de santé, on aura fait de gros progrès en matière de droits humains, et on aura baisé sans compter dans la joie et la bonne humeur avec l’étrange sentiment qu’hommes et femmes peuvent être égaux.

Parce qu’en 1960, c’était loin d’être gagné. Si les femmes pouvaient plus mourir à la suite d’un avortement qu’à la suite d’un accident de voiture, nous dit-on dans le film, sur le plan plus sociétal, la condition de la femme est à des kilomètres de ce qu’on pouvait nous montrer par ailleurs au cinéma. Même chez les voisins de la Nouvelle Vague pourtant bien égratignés ici (Godard semble avoir apprécié le film, moins rancunier qu’Autant-Lara en tout cas) chez qui l’image de la femme émancipée n’est que rarement en prise avec la réalité. C’est l’autre aspect « clinique » du film. Le personnage d’interne en gynécologie qu’interprète Marie-José Nat aurait voulu être un homme parce que « c’est tellement plus compliqué d’être une femme » (accessoirement, on la suppose aussi un peu homosexuelle : son histoire avec sa patiente, ce n’est pas seulement l’histoire d’un raté, mais aussi une histoire d’amour qui commence dans un ascenseur et deux mains qui se trouvent). L’interne n’est pas la seule femme dans les parages, mais on se demande si les autres femmes qu’elle croise dans son internat ne sont pas uniquement celles que ses collègues masculins traînent dans leur lit. Les autres femmes, au travail, comme les sages-femmes, ne semblent pas particulièrement apprécier sa présence (l’autorité, l’expérience d’un homme, tu comprends). Ce n’est pas le cas des patientes qui voient sans doute d’un meilleur œil de se faire ausculter par une femme. C’est que les hommes, pères, médecins, internes ou policiers, sont tous uniformément odieux. La réputation des internats et des hôpitaux ne semble pas avoir beaucoup changé aujourd’hui, mais au moins, on en voit ici une triste illustration. L’occasion manquée qui provoquera le décès de la jeune mariée après les complications d’un avortement clandestin, c’est bien le résultat d’un commentaire assassin, machiste du Don Juan interne qui considère qu’ils ne sont pas là pour informer les patientes sur des moyens contraceptifs. Et puis quoi encore ! (On serait au tout début du planning familial et si on rêve d’une « nouvelle vague en médecine », on n’y est pas encore « parce qu’ici, on respecte les anciens, pas comme dans le cinéma. ») Claude (le personnage interprété par Marie-José Nat) se reproche de ne pas avoir conseillé de trouver un diaphragme en pharmacie à la future mariée qui s’inquiétait de ne pas savoir comment éviter de tomber enceinte. Ce sont donc les commentaires stupides d’un sale type qui causera la mort de cette femme de 18 ans.
Et évidemment, parce que c’est toujours comme ça, qui Claude invitera-t-elle dans son lit ? Le sale type. Remarque, pas beaucoup le choix. Il n’y a que des sales types. Jour et nuit, on sauve des vies. Et entre les deux, on se fout de la gueule des patients qu’on a reçus ; et on se tape l’infirmière ou la petite interne. L’élite.
Du brutal, je vous dis.
Le film a donc une valeur documentaire historique indéniable en plus d’être un mélo assez bien réussi (à moins que ce soit un film d’horreur : je ne conseille à personne de voir comment on essaie de récupérer un patient atteint du tétanos, ce n’est pas beau à voir). Il montre la réalité brutale des conditions sanitaires avant la pilule et bien avant le droit à l’avortement. On se demande même comment Claude a pu mener ses études : même majeure, elle est forcément encore liée à ses parents (son père, du moins) ; or, il n’est jamais question de ses liens familiaux. On ne peut pas tout montrer dans un film, mais justement, voit-on cette réalité-là, mettons, dans les films de la Nouvelle Vague ? Il y a deux manières d’être émancipée : l’être sexuellement dans un film de Godard ou de Truffaut où, comme dans n’importe quel film de « la qualité française », on baise comme dans « les films », sans rien montrer, sans parler du comment ni des conséquences, simplement en montrant une scène heureuse au petit matin ; et l’être (émancipée) juridiquement, dans le monde vrai. Le film est sorti en 1965 (le roman au début des années 60), c’est précisément l’année où les femmes gagnent leur émancipation. Dit autrement : elles ne sont plus considérées comme des mineures et rattachées soit à leur mari soit à leur père. Heureusement que les hommes peuvent encore foutre des mains sur les roploplos des collègues, comme ça, pour rire, quoi…
Autre réalité illustrée dans le film : la présence d’une infirmière noire et d’une concierge asiatique. Les sales boulots. Une réalité rare à l’époque, et l’occasion pour Claude (l’interne, pas le cinéaste), en visitant la chambre de ses jeunes mariés, de s’en rendre compte : il y a plus grand malheur que d’être une femme médecin dans un monde d’homme. Être une femme pauvre. Pas le temps d’être heureux dans une chambre de bonne. La promiscuité vous fait vite des petits.
Un film vaut donc mille discours. Ou une promesse d’inscrire le droit à l’avortement dans la constitution… Par ce que : et après ? Tu l’inscris. Quelqu’un pourra toujours le supprimer à son tour. Mais t’es content, petit roi, tu auras effectué un de ces « accomplissements » symboliques dont tu es friand. Encore les belles promesses d’un sale type. Éduquer, informer, rappeler que ce n’était pas « mieux avant », tu ne l’inscris pas dans la constitution, ce n’est pas un symbole, mais une réalité, et tu l’inscris dans la mémoire des citoyens. En principe, ça s’évapore moins facilement. C’est de mémoire dont on a besoin. Pas de symboles. Et ce film pourrait participer à cela. Le service public est bien trop occupé à faire des débats entre personnalités de droite et d’extrême droite ou à faire la publicité à des charlatans qui prétendent que les vacances font diminuer le QI, plutôt qu’à montrer des films utiles capables d’entretenir cette mémoire collective.
Cela doit bien faire un demi-siècle qu’on est en vacances.
Bonne rentrée à tous. Profitez de vos libertés et de vos droits acquis. Bientôt, c’est la fin du monde.
Journal d’une femme en blanc, Claude Autant-Lara 1965 | Gaumont, Arco Film
Sur La Saveur des goûts amers :
Listes sur IMDb :
Liens externes :















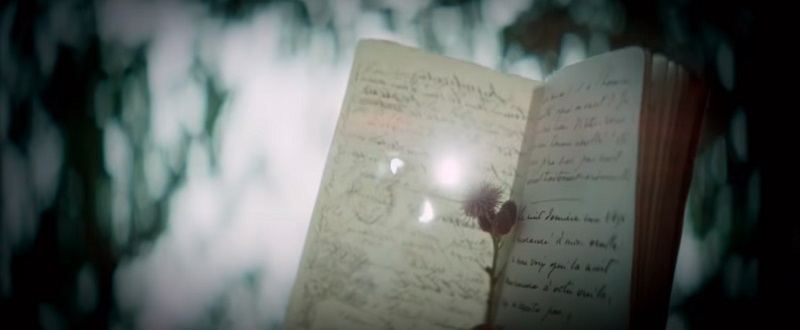












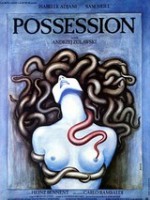





 Année :
Année :