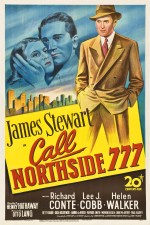Les Enfermés dehors

L’Attaque de la malle-poste

Titre original : Rawhide
Année : 1951
Réalisation : Henry Hathaway
Avec : Tyrone Power, Susan Hayward, Hugh Marlowe, Jack Elam
— TOP FILMS —
Petit western méconnu d’Hathaway, c’est sans doute pourtant un des meilleurs du genre. Pas seulement un western, mais surtout un huis clos (ou quasi, et considéré souvent comme un western noir), un film d’une grande intensité dans la veine des films de prises d’otages (Les Visiteurs, d’Elia Kazan, La Maison des otages, de William Wyler, Un après-midi de chien, de Lumet, Funny Games, de Haneke…).

Mon spoiler… Tyrone Power aide son ami à tenir un relais de diligence en plein milieu de nulle part (entre San Francisco et Saint-Louis). On apprend rapidement qu’une bande de voyous rôde dans les parages, on demande alors à la diligence, qui s’apprêtait à repartir, de rester. Susan Hayward n’est pas d’accord, mais on ne lui laisse pas le choix : elle devra passer la nuit au relais avec son enfant. Enfin, son enfant…, on apprendra plus tard qu’il s’agit en fait du fils de sa sœur (laissant peser le doute sur sa condition quand elle demande qu’on l’appelle Mademoiselle et non Madame…). Un homme seul arrive alors au relais et dit être le shérif Miles. Il se révèle en fait être le chef de la bande qui sévit dans les parages : l’ami de Power est tué et Power gardé en otage, car les bandits veulent s’en prendre le lendemain à une diligence pleine d’or, et Power est le seul en sonnant du clairon à leur donner le signal comme quoi tout va bien… Tevis, une des crapules de la bande, le plus fou, le plus sadique (Jack Elam qu’on retrouvera quelques années plus tard dans Il était une fois dans l’Ouest : l’un des hommes de la bande d’Henry Fonda) s’amuse avec des vêtements féminins. Zimmerman, le véritable nom de celui qui s’était fait passer pour le shérif Miles, plus intelligent, plus éduqué (dans la tradition des chefs de bande) comprend que ça signifie (il est fort !) qu’il y a une femme, et que… par déduction, elle ne peut être que celle de Power. Ah, ah !… La Hayward revient donc au relais après avoir fait trempette dans un bain. La bande les enferme tous deux dans la chambre les croyant mariés, en attendant la diligence le lendemain. Power demande à Hayward de ne pas nier ce malentendu sinon il lui assure qu’ils la tueront. Durant la nuit, Power entame le mur avec un couteau qu’il a réussi à piquer en cuisine, il essaye également de faire passer un message écrit à une autre diligence qui passera au relais mais qui n’intéresse pas la bande, mais ce sera sans succès. Le lendemain, le mur laisse apparaître un trou conséquent mais pas suffisant pour laisser passer un adulte et ils n’ont plus rien pour entamer le mur. Quand la diligence arrive enfin, tout le monde se met en place pour leur faire croire que tout est normal, Hayward suit la scène depuis la chambre, et c’est ce moment que choisit le bébé pour passer à travers le mur ! Agacé par les cris hystériques d’Hayward, Tevis ouvre la porte de la chambre, Zimmerman arrive pour l’engueuler, mais Tevis le tue et devient du même coup le chef de la bande… Au loin, les hommes de la diligence ont cru entendre des échanges de coups de feu et décident de s’approcher l’arme au poing. S’ensuit un gun fight particulièrement violent et sadique : Power et Tevis se canardant l’un et l’autre à couvert, l’issue semble délicate, mais le bébé arrive entre les deux. Tevis avait là l’occasion de faire rendre les armes à Power… en tirant sur le bébé ! Mais Hayward l’achève. Tout est bien qui finit bien.

Le film est assez remarquable à plusieurs niveaux. D’abord son aspect assez fortement naturaliste. Le huis clos rend impossible le côté épique qu’on voit dans la plupart des westerns. C’est un anti-western en ce sens, comme peut l’être La Cible humaine où l’action se concentre sur deux ou trois lieux dans une même ville et où l’action principale est… l’attente (un peu également comme dans Rio Bravo ou dans 3h10 pour Yuma si je me rappelle bien). Cet effet est accentué par la mise en scène : l’emploi d’une grande profondeur de champ (pourtant dans des espaces clos) permet d’utiliser comme dans Citizen Kane ou comme chez Leone plusieurs « plans » dans le cadre. On a surtout ce plan qui tape à la figure de la présentation de la gueule sadique de Tavis : son visage en gros plan (avec son strabisme, ça fait peur) et un arrière-plan parfaitement net. Le noir et blanc permet avec ses jeux de contrastes d’apporter un côté réaliste que ne possédait pas le Technicolor à l’époque. L’image est à la fois plus réaliste et plus brute. On pense à plusieurs cinéastes pour certaines séquences : Le Trou, de Becker, quand ils creusent le mur (on peut en trouver dix milles des films de ce genre, c’est vrai), Hitchcock, quand il suggère plusieurs scènes à l’avance que le bébé se faufilera sous le mur (l’ironie aussi de la situation), ou encore Haneke, et sa violence sadique, le minimalisme.
Un grand film.

L’Attaque de la malle-poste, Henry Hathaway (1951) Rawhide | Twentieth Century Fox
Sur La Saveur des goûts amers :
— TOP FILMS —
Les Indispensables du cinéma 1951
Listes sur IMDB :
















 Année : 2009
Année : 2009