Noir Leone

Samouraï
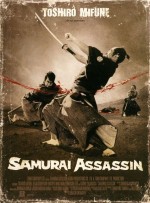
Titre original : Samurai
Année : 1965
Réalisation : Kihachi Okamoto
Avec : Toshirô Mifune, Keiju Kobayashi, Michiyo Aratama, Yûnosuke Itô, Eijirô Tôno, Tatsuyoshi Ehara
— TOP FILMS —
Formidable combinaison entre chambara, film noir, western spaghetti, tragédie identitaire…
Le film commence par une embuscade avortée à la porte de Sakura par un groupe de samouraïs visant l’assassinat du premier ministre Ii Naosuke. Cet échec va mener à une seconde embuscade, qui, elle, aboutira : l’Incident de Sakuradamon (sans doute moins connu que l’histoire des 47 Ronins). Tout l’intérêt ici est de travestir l’histoire en faisant intervenir des personnages et des incidents non répertoriés dans les livres d’histoire. Pendant tout le film, un scribe, ou historien officiel, est chargé de retranscrire par le chef des conspirateurs les événements qui feront rentrer le groupe dans la postérité. Et quand certains événements ne leur sont pas favorables, on réécrit l’histoire.
Idée géniale à la fois pour légitimer la possibilité d’une autre version de l’histoire (qui n’est qu’un prétexte à inventer de nouveaux personnages, en particulier celui de Toshiro Mifune, ou pour rappeler une nouvelle fois que ce ne sont jamais que les puissants et les vainqueurs qui l’écrivent, l’histoire), pour faire rentrer le public japonais dans un contexte historique qu’il est censé connaître (en tout cas plus qu’un public occidental), mais aussi parce que c’est de l’or pour construire une histoire épique, les déclamations de ce scribe servant tout au long du récit à intervenir pour expliquer le contexte ou accélérer l’action comme le ferait un coryphée dans le théâtre antique ou une voix off dans un péplum.
On pourrait toujours dire qu’il n’y a rien de naturel dans le récit du scribe, mais c’est justement cette grandiloquence, cette déclamation saccadée, presque criée, qui fait rentrer le spectateur dans une histoire épique. On sent donc ici toute l’influence du théâtre japonais. C’est précisément ce qu’est un jidaigeki. Pas seulement un film en costume, mais avec un style de jeu bien particulier (en dehors des films de Mizoguchi, plus réalistes). On le voit dans la première scène entre Toshiro Mifune et Keiju Kobayashi : ils discutent en marchant dans les couloirs de la résidence du chef de clan, et leur jeu n’a rien de naturel. L’idée est bien d’incarner des héros, des caricatures, et les répliques sont dites de manière outrancière. Mais c’est cette distanciation qui donne du souffle à la fable. Pourquoi se soucier de réalisme ? L’idée, ce n’est pas de rabaisser des héros à la condition de simples hommes, mais au contraire de les élever au rang de demi-dieux. L’acteur ne prétend pas incarner un personnage : il se met derrière comme un marionnettiste sans souci de cacher les artifices de son jeu.

Samouraï, Kihachi Okamoto 1965 | Mifune Productions Co. Ltd., Toho Company
Cette première scène d’ailleurs n’est pas sans rappeler l’introduction, également très théâtralisée, de Kill, que Kihachi Okamoto réalisera quelques années plus tard. L’unité de lieu y fait pour beaucoup. Le récit n’est une suite que de contractions et de distension du temps. Au début, pesant, pour insister sur l’attente, l’incertitude, et ensuite, rapide. On retrouvera le même principe dans la scène finale, et trois ans plus tard dans l’introduction d’Il était une fois dans l’Ouest. L’ajout du personnage de la serveuse, outrancièrement aimable, insouciante, vient en contrepoint avec l’atmosphère lourde de la scène qui ne fait que la renforcer.
L’utilisation de la neige dans ces deux scènes d’introduction et de conclusion offre des images saisissantes (et c’est pourtant semble-t-il un fait historique : voir le lien en fin de commentaire). La neige donc, au début et à la fin ; et tout du long, une pluie incessante. Même quand on ne la voit pas, on l’entend tomber dans chaque scène, ce qui là encore ne fait que renforcer l’atmosphère apocalyptique du film. Et il s’agit bien de la fin d’un monde. L’Incident de Sakaradamon est au cœur du Kakumatsu, cette courte période de chaos succédant à l’arrivée des navires américains au Japon et mettant fin à son isolationnisme. L’une des dernières phrases d’Ii Naosuke avant de mourir, sera d’ailleurs révélatrice : « C’est la fin du Japon, la fin des samouraïs ».
Une fois que l’assassinat est reporté, le film se propose donc de revisiter l’histoire. Si on est Japonais, on sait parfaitement comment doit s’achever le film : par la réussite des conspirateurs dans leur entreprise. L’intérêt n’est donc plus politique et lié à ce seul souci de tuer le ministre (c’est bien cet aspect trop « historique », plan-plan qui m’ennuie dans l’histoire des 47 Ronins), mais de proposer une « petite » histoire à l’intérieur de la « grande ».
Si le plan des conspirateurs a échoué dans un premier temps, c’est que le ministre en avait été informé. Il faut donc trouver le traître qui se cache dans leurs rangs. La dynamique du film vient alors s’articuler autour d’une enquête jouant sur les différences de points de vue. Le personnage de Mifune et celui de Kobayashi apparaissent très vite comme les suspects principaux. On est amené à les connaître à travers l’exposé d’un enquêteur, d’un témoin, d’un ami. Chaque scène d’interrogatoire se transforme alors en flashback. On pourrait être autant dans Rashomon, Barberousse que dans un bon film noir. La même quête de la vérité (idéal pour le « récit épique » : la pièce épique par excellence étant Œdipe roi, qui est une enquête sur les origines), les mêmes mensonges, et surtout la même fascination pour ces tranches de vie racontées. Il faut comprendre les motivations de Mifune et Kobayashi à rejoindre le clan, et pour cela, on doit raconter leur histoire. Celle de Kobayashi, loin d’être une fausse piste, les mènera finalement au véritable traître, et sera surtout le prétexte, cruel, donné à Mifune pour prouver sa loyauté envers le clan…



Comme dans Œdipe, ce qui était d’abord une enquête pour résoudre un problème d’ordre général (le traître parmi le groupe), se transforme en une quête personnelle sur les origines. Mifune ne connaît pas son père, et comme dans toutes les familles monoparentales…, ça pose problème. Du pain béni pour l’acteur qui peut jouer son personnage favori de bougon crasseux. Seule différence avec la pièce de Sophocle, c’est le chef de clan qui mène ici l’enquête. Mifune s’est depuis un moment résolu à ne pas connaître son père. C’est donc ce chef qui va découvrir la réalité de ses origines… La dernière demi-heure met ainsi en concurrence deux aspects de la trame, que le chef de clan voudrait éviter de se voir réunis. La petite histoire ne peut devenir la grande. Et cette histoire est bien cruelle. Mifune ne connaîtra jamais la vérité. À l’image de la vérité cachée par le scribe obéissant à son chef…
La morale est claire : si on connaît les événements majeurs d’une histoire, on ne peut en mesurer tout le poids, comprendre les enjeux, et saisir les ambitions ou les histoires personnelles qui se cachent derrière chaque individu. Ce qu’on connaît de l’histoire est toujours la part émergée de l’iceberg. Le ministre a été tué, c’est un fait indéniable. Pour le reste, il suffit d’un nom barré, d’un incident évincé, pour que les raisons et motivations cachées derrière un tel acte demeurent un mystère. Cette image finale du film, qui est probablement bien ancrée dans l’imaginaire nippon*, celle de Mifune, héros hypothétique, oublié, rayé des livres d’histoire, se trimbalant glorieusement avec la tête du ministre au bout d’une pique, c’est un peu le symbole de nos craintes concernant tous les acquis qui nous précèdent : et si nous aussi ne nous trimbalions pas sans le savoir avec la tête de notre père sur une pique ? Derrière chaque événement de l’histoire se cache une ombre, un doute, des héros oubliés, des livres d’histoire trafiqués. Qu’un chambara parvienne, tout en nous proposant des scènes de katana d’une belle inventivité, à nous questionner sur le sens de l’histoire, sur la nature des héros, c’est plutôt jouissif et inattendu. Du spectacle, et du sens.
* L’incident de Sakuradamon (1860) (soierie)


























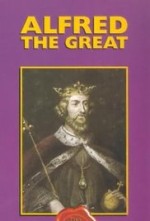 Année : 1969
Année : 1969




 Année : 2006
Année : 2006 
 Année : 1994
Année : 1994
