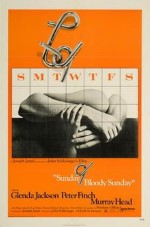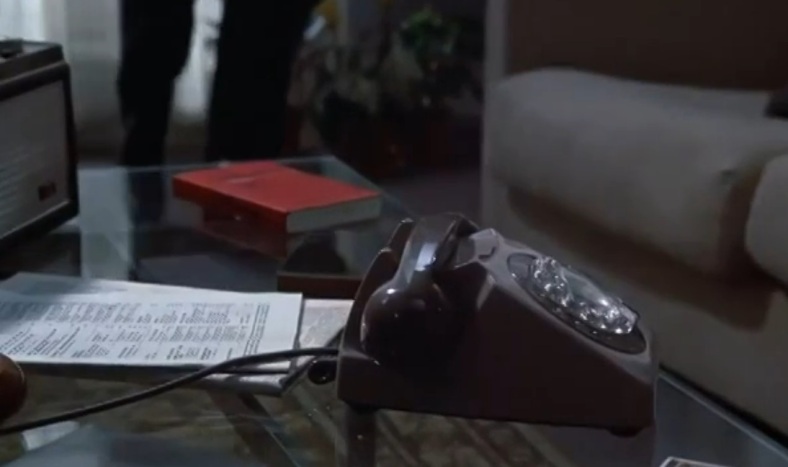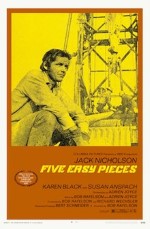Les Carnets de route de Mito Kômon
Titre original : Mito Kōmon man’yūki / 水戸黄門漫遊記
Année : 1958
Réalisation : Kenji Misumi
Avec : Ganjirô Nakamura, Shintarô Katsu, Saburô Date, Tamao Nakamura
— TOP FILMS —
Il faudrait qualifier Misumi de cinéaste errant tant une bonne partie de ses meilleurs films prennent place sur la route… On retrouve d’ailleurs Shintarô Katsu, quelques années avant ses collaborations les plus mémorables avec Misumi pour des films de personnages errants (en tant qu’acteur dans Zatoïchi et en tant que producteur de Baby Cart, le rôle-titre étant assuré par son frère, Tomisaburô Wakayama). Il est ici un (double) usurpateur assurant la partition humoristique du film en compagnie de Ganjiro Nakamura, l’acteur, entre autres, d’Herbes flottantes, et rôle central de ces carnets de route. Ces carnets de Mito Kômon sont inspirés de la vie d’un seigneur ayant réellement existé et occupé le poste de « conseiller provisoire du milieu » avant de se retirer. C’est cette « retraite » qui fait l’objet de cette histoire de voyages cocasse et bouffonne.
On est entre Alexandre Dumas pour les aventures de grand chemin et la commedia dell’arte. Et comme beaucoup de récits populaires japonais, on se rapproche pas mal du ton de la bande dessinée et des variations pouvant se décliner à l’infini à partir d’un même principe (les voyages forment la jeunesse et… une partie des histoires déclinées en séries sans fin). J’avoue être particulièrement amateur de ces facilités. Il faut regarder ça comme un exercice de style : à chaque voyage, sa trajectoire, à chaque étape, sa rencontre et son épisode dédiés.
Le petit plus ici, c’est que la trajectoire de départ est lancée par une idée plutôt lumineuse : un seigneur à la retraite, connu pour ses facéties et son humilité, décide de parcourir le Japon pour partir à sa rencontre ; il décide de partir seul ou presque sur les routes à une époque où les seigneurs forment des processions hautement codifiées et sécurisées ; bien sûr, les autorités ne sont pas de cet avis, et on apprend en même temps que le seigneur voyageur, au détour d’une conversation qu’il n’était pas censé entendre, qu’on précède ses pas dans chaque ville-étape pour lui assurer les aventures qu’il réclame tout en lui assurant la sécurité qui est due à son rang.
S’ensuit un jeu de quiproquos sans fin qui finit en apothéose. Chacun essaie de tromper la partie adverse en se faisant passer pour ce qu’il n’est pas ; et dans ce jeu du chat et de la souris, on se demande bien qui sera le plus filou en réussissant à berner l’autre. Comme chez Shakespeare, on peut dire que le monde est un théâtre et qu’hommes et femmes réunis n’en sont que des acteurs. (On pourrait même rapprocher les acolytes à la fois inséparables et indissociables qui précèdent, accompagnent ou chassent le seigneur dans sa procession — on ne sait plus très bien — aux deux compagnons d’Hamlet, Rosencrantz et Guildenstern dont Tom Stoppard avait tiré un film tout aussi cocasse et bouffon. À moins qu’on ait affaire aux Dupont et Dupond de Hergé.)
En plus de multiplier les situations d’une savoureuse drôlerie, le film est aussi, par beaucoup d’aspects, émouvant : suivant le même principe du « monde est une scène », les masques finissent toujours pour tomber. Les identités ainsi révélées sont l’occasion de se reconnaître, de se confondre en excuses, de pleurer ensemble, etc. Grand moment aussi quand le vieux seigneur cherche ses amis de voyages disparus après une bataille… : les seuls amis peut-être véritables qu’il se serait faits, car eux seuls, croyait-il du moins, grâce à leurs masques respectifs (et leurs fausses identités), le prenaient pour ce qu’il est vraiment : un vieux fou sans prétention aspirant à l’anonymat, à l’humilité et à la découverte du monde des petites gens. Dans les histoires japonaises comme partout ailleurs, l’émotion que suscitent les révélations identitaires reste toujours la même. On ment, on s’amuse, on se redécouvre, on se reconnaît, et on se tombe dans les bras. Du moins en pensées.
Des carnets de route à l’humour tendre et espiègle. Un peu comme si La Forteresse cachée était mixé avec Tora-san.
Pas d’images du film, mais quelques photos de plateau à retrouver ici ou ici. Les récits de Mito Kômon firent l’objet de nombreuses adaptations. Celle-ci est produite par la Daiei, mais la plus connue semble celle de la Toei avec Ryûnosuke Tsukigata dans le rôle principal (acteur dans Le Sabre pourfendeur d’hommes et de chevaux ou dans Le Mont Fuji et la Lance ensanglantée dont l’histoire reprend ce principe, sur une note plus dramatique, des voyages initiatiques).
Listes sur IMDb :
Liens externes :