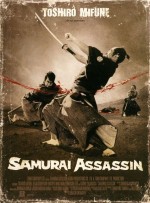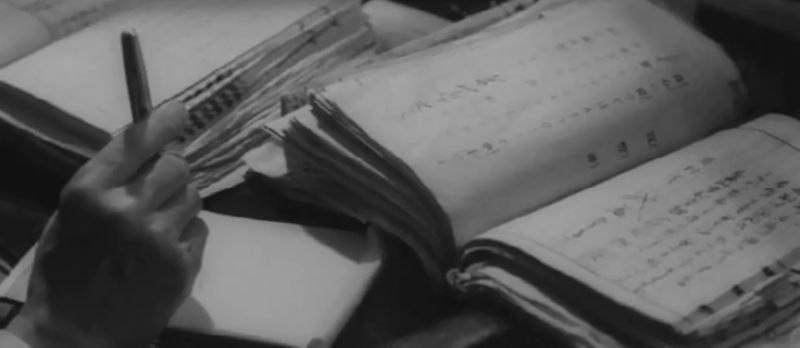L’humour goutte-à-goutte

Yaé, la petite voisine

Titre original : Tonari no Yae-chan
Année : 1934
Réalisation : Yasujirô Shimazu
Avec : Yumeko Aizome, Ryôtarô Mizushima, Den Ohinata, Chôko Iida
Il y a des comédies qui sont des tonnerres et qui ont l’ambition de nous faire rire aux éclats ; et il y a des comédies qui sont des brises de printemps, ou de petits torrents qui dévalent tendrement des collines. Shimazu montre un monde idyllique où les hommes de mauvaises intentions n’existent pas. Tout est doux et indolore. Tout est sujet au rire et à l’amusement. On se prend à rêver que de tels personnages puissent exister et on rit, ou on pouffe bêtement, en comprenant que tout cela n’est bien sûr que de la fiction. On rit. Comme les Japonais rient quand ils sont gênés. Le temps d’un film on goûte à cette étrange humilité qui fait tout apparaître en rose et qui nous fait naïvement voir que le bon côté des choses. Il faudrait filmer les spectateurs des films de Shimazu comme lui filme ceux qui s’amusent à la découverte d’un épisode de Betty Boop. L’œil qui frise en permanence ; une brise qui chatouille comme une plume titillant nos oreilles et nos joues.
Farceur le Shimazu, l’air de rien. Quand il ose un échange de répliques entre deux lycéennes sur le volume de leur poitrine. L’audace du hors-champ, des adolescentes faussement innocentes et coquines ; et la gêne, plein cadre, du jeune homme laissé seul dans le salon et qui entend tout. Le retour de la voisine fait tout autant sourire : le garçon lui reproche son manque de pudeur, et elle lui répond qu’entre filles, elles peuvent bien parler de ces choses-là. On dirait aujourd’hui qu’elles l’allument.
Dans la même scène semblant sortir d’un fantasme d’écolier, la jeune fille propose à son voisin chéri de lui laver et de lui repriser ses ignobles chaussettes. C’est Boudu violé par les nymphes de Shimazu… Voit-on ça ailleurs que dans nos rêves. The girl next door, la petite voisine pas vraiment jolie, mais qui prend un malin plaisir à vous chatouiller les sens. Petit regard en coin, sourire moqueur… Le sexe n’est pas encore une éventualité alors on se tortille autrement. On flirte, on se taquine, on se chamaille.
Un peu plus tard, les mêmes continuent à jouer les amoureux : « Je te plais ? — Bof… » On ne se tape pas sur les cuisses, c’est sûr, mais on s’amuse des réactions de ces ados dont on peut lire les sentiments comme dans un livre écrit à l’eau de roche. « Tiens, c’est vrai que tu ressembles à Fredric March. Maah, tu es flatté ? » On pourrait presque le voir rougir ; et elle s’amuse de le faire marcher. Absurde, ridicule et tout à fait charmant. Parce que… Fredric March, sérieusement ? Le garçon en question n’a évidemment rien de Fredric March. Ozu, avait réutilisé plus tard la même bêtise flatteuse avec un autre acteur américain (à moins que ce soit dans un film de Naruse, j’ai la mémoire qui flanche, je me rappelle plus très bien).

Yaé, la petite voisine, Yasujirô Shimazu Tonari no Yae-chan 1934 | Shochiku
Les scènes se succèdent ainsi, et le flirt continuerait à n’en plus finir comme des préliminaires habillés si une grande sœur mariée mais en délicatesse avec son mari ne venait pas se réfugier chez ses parents. Encore, une situation, un personnage qu’on retrouvera par la suite dans les films de Naruse et d’Ozu. La grande sœur viendra donc se consoler dans les bras de notre Fredric March et sa cadette pourra alors nous amuser de sa jalousie un peu pataude — donc délicieuse. La comédie est là, en décrivant les petits défauts de ces personnages attachants. Des petits vices ne portant pas à conséquence que les auteurs connaissent bien pour être une source inépuisable de sympathie : la gourmandise (du jeune frère), l’ivresse (des pères), l’effronterie (de la voisine). C’est léger, c’est maladroit, c’est naïf…, l’idée en fait qu’on se fait de l’enfance (chacun sait que c’est un mythe, l’enfance étant au contraire une période où la cruauté règne en maître).
On est au début du parlant, Shimazu manie parfaitement l’usage des dialogues. Il sait quand montrer à l’image celui qui parle ou prêter attention au contraire aux réactions de ceux qui écoutent. On retourne même parfois presque au muet quand il joue avec d’incessants jeux de regards. Action, réaction : frustration ; action, réaction : vexation ; action, réaction : émulation ; action, réaction : circonspection ; action, réaction : tension… Sol, sol, sol… mi♭ !
Autre exemple de la délicatesse « muette » avec laquelle Shimazu montre ses personnages : en rentrant d’une soirée en voiture, le jeune frère pique du nez. Ce qui deviendrait facilement un motif de rire un peu vulgaire ne fait ici que sourire. C’est juste ce qu’il faut pour nous attendrir ; un peu comme quand on fond devant un enfant luttant contre le sommeil et qu’on regarde sombrer un sourire au cœur.
Shimazu possède cette légèreté, cet amour pour l’existence et les petites médiocrités humaines. On aime ses personnages parce qu’ils sont inoffensifs, des monstres gentils. Oui, c’est un paradis. Et cela, malgré la tragédie qui finit toujours immanquablement par pointer le bout de son nez. La mort, elle, ne dort jamais.
Après-guerre, Ozu tournera des films qui se rapprocheront de cette tonalité. Ça commencera avec Chôko Iida dans Récit d’un propriétaire, qui joue ici une des mères. C’est vrai que quand on la voit apparaître dans le film d’Ozu, avec son air sévère, on comprend tout de suite que le morveux parviendra très vite à l’amadouer. Un cinéma qui s’attache à décrire des anges, la beauté et l’humilité des petites gens.

Chôko Iida
Alors, certains pourraient y voir du cinéma réaliste sans saveur, où il ne se passe rien. Pourtant il n’y a rien de réaliste à présenter des anges à l’écran. Je n’en ai rencontré aucun. On peut s’amuser à prendre la situation de départ et voir comment elle évolue dans le monde idéalisé de Shimazu et dans la vraie vie parisienne :
Quand le voisin joue au baseball en empiétant joyeusement sur la propriété voisine, et qu’il vient à casser un carreau avec sa balle, chez Shimazu, il vient s’excuser, tape la discute avec la fille des voisins ; la mère du joueur vient présenter ses excuses, demande à son fils de ramasser les morceaux et repart en demandant à la fille des voisins de présenter une nouvelle fois ses excuses à sa mère. Quand le lendemain, le vitrier passe, tout ce joyeux petit monde se renvoie la balle pour savoir qui payera les frais.
Dans la vraie vie ? Je casse la vitre de l’appartement de mon voisin, je commence par recevoir des insultes, je lui envoie les miennes en retour avant de venir m’excuser mais comme j’ai les excuses qui ressemblent à des insultes, il me ferme la porte au nez et m’envoie le lendemain la facture. Deux jours après, il insulte ma femme dans la cage d’escalier pour avoir un mari moyennement aimable, il reçoit en retour une volée de gifles, dépose une main courante au commissariat dans la foulée, me traite de couille molle au retour ; pour me venger, je lui grippe son garage mécanique en y fourrant un peu de sable dans les rouages ; le garage retombe sur son char à meule immatriculé dans le Calvados ; en représailles, il viole et massacre mon chien, je lui crève les yeux, il me tord et m’arrache les burnes, je lui vomis dans le cou, et on finit tous deux par la fenêtre, empalés vingt mètres plus bas sur la verrière du restaurant indien du rez-de-chaussée dans lequel on n’avait jamais daigné, ni lui ni moi, foutre les pieds. La voilà la vraie vie ! C’est ce qui arrive tous les jours entre voisins… Shimazu à côté, c’est L’Île aux enfants. Allez demander un ou deux œufs à vos voisins, vous avez toutes les chances de les recevoir sur la tête et de trouver le lendemain vos pneus crevés… Bienvenue dans le monde réel. Non, non, Shimazu n’est pas réaliste. Un idéaliste et un petit plaisantant, oui. Il nous montre un avant-goût du paradis, pour filer à la fin du film en nous disant : « hé couille molle ! le paradis n’existe pas ! » Merci bien. C’est triste la vie, et ça l’est encore plus à la fin.




Listes sur IMDb :
✓
✓
✓
Liens externes :