La comédie est-elle vraiment un genre ? Parce que si le rire cache derrière l’explosion d’une farce crémeuse s’étalant en pleine poire d’une victime quelconque un petit fond de cruauté que les meilleurs gagmen parviennent aussitôt à saupoudrer de bienveillance salutaire et mielleuse, c’est peut-être un peu que la comédie par essence n’est qu’un drame déguisé. Le théâtre n’est-il pas fait depuis la nuit des temps d’un visage double représentant successivement ou simultanément la comédie et le drame ? Une même histoire, selon la tonalité qu’on voudrait lui donner, ne pourrait-elle pas être à la fois, ou alternativement, une comédie et un drame ? La satire n’est-elle pas la meilleure alliée pour pointer du doigt les travers des hommes ? Le fou du roi n’était-il pas le seul à être autorisé à dire à son maître ce qui avec d’autres leur vaudrait d’avoir la tête tranchée ? La comédie n’est pas un genre, mais un moyen. Pas de comédie sans larmes, sans cruauté, mais aussi sans humanité. Drame et comédie composent une même logique ; dans l’un ou l’autre, il n’y a que la vie que l’on représente à l’écran ou ailleurs dans toute sa complexité. Vouloir faire l’un ou l’autre, c’est déjà se tromper de route. Qu’une fable soit dramatique ou comique, elle repose toujours au début sur un même subterfuge, et à la fin, sur un retournement de « genre ». Voilà bien une certaine forme d’illusion comique pourrait-on dire, et aussi, le grand drame (sans rire) de notre époque où une comédie ne se vautre jamais totalement dans le burlesque pour ne pas avoir à se salir, à froisser quelqu’un. En restant digne, la comédie ne bouscule ni ne réveille jamais rien, pas même les zygomatiques du spectateur indifférent : nos comédies actuelles, en refusant d’être des farces, prétendent proposer des histoires où seul l’humour, le cocasse, pourrait être indifféremment répété sans que le spectateur n’ait à en tirer des leçons. On pouffe, et adieu. L’art de la fable (d’abord), si c’est l’art du retournement final (la morale), alors un spectacle où les tartes à la crème volent toujours dans le même sens, jamais vers ceux qui les envoient, est un spectacle navrant. Car il est bien là le génie incompris de la tarte à crème (ou de la baffe burlesque), dans sa capacité à se retourner contre son initiateur : un arroseur arrosé, c’est une réflexion sur le monde, une révolution de conscience. Il y a que ceux qui voient des cons partout qui retournent jamais leur veste. La comédie cruelle, retournée, dramatique, parfois romantique, c’est un basculement cathartique, un dévoilement, une révélation. En se soumettant à son charme, le spectateur n’y lève pas seulement les lèvres, mais sa personne tout entière. Alors non, la comédie n’est pas un genre, c’est une transgression du drame.
Prout.
(Ça, c’est la version moins prétentieuse pour définir la comédie.)
(Mais c’est plus amusant quand je me prends au sérieux, non ?)
La comédie doit donc toujours être tragique, cruelle, pour être réussie. Elle peut être sentimentale aussi, pas forcément dans le sens péjoratif, mais humaniste, façon amour du prochain, reconnaissance de l’étranger comme un individu égal et respectable, etc.
Là reposait déjà la réussite des comédies de Chaplin. Au burlesque, Chaplin, dans ses meilleurs moments, y ajoutait la romance, et souvent ce qu’il faut d’humanisme. Pas d’humanisme sans cruauté. On parlerait difficilement aujourd’hui de comédies romantiques pour les films de Chaplin, encore moins de comédies dramatiques ou de satires, mais toujours durant le muet, le romantisme (ou l’autre versant, plus cruel, voire sadique, et plus présent sans doute dans les purs slapsticks) s’allie souvent au burlesque : Harold Lloyd en est un autre exemple. Plus tard, au milieu des années 30, c’est la mal nommée screwball comedy que ce même Capra fera accoucher avec New-York Miami, avec le même principe. Pourtant la recette d’un homme et d’une femme (voués à être ensemble ou parfois même déjà en couple) dans une comédie où ils sont sur un pied d’égalité n’est là non plus pas nouvelle : on peut voir par exemple Le Mari à double face de Leo McCarey, et aux premières heures du parlant, ce sont même parfois les femmes qui dirigent les hostilités en mêlant dialogues savoureux et intrigues sentimentales avec les films de Mae West ou de Jean Harlow (déjà avec Frank Capra, déjà avec ce bellâtre de Clark Gable). L’idée a sans doute toujours fait recette. Si la comédie n’est peut-être pas un genre, mais une tonalité censée révéler la nature véritable des choses, elle retourne les préjugés, appuie là où ça fait mal, et libère encore les conflits enfouis pour les mettre en pleine lumière… « Pourquoi les petites Japonaises rient-elles ? » me demande un jour ma voisine de palier. Parce qu’elles sont gênées. Le rire (comme les larmes) est compassionnel, empathique, il réunit, il apaise… quand il a cessé d’être cruel. Mais c’est bien là l’astuce, il faut d’abord que le rire soit un moyen, pas une finalité (le rire gratuit du ton sur ton, et non le rire qui s’additionne à un autre « genre »), ensuite il faut encore que le rire, parfois cruel, se retourne contre celui qui rit. On serait dans un thriller, qu’on dirait que chaque comédie a besoin de son twist (le revirement est de toute façon un procédé commun en dramaturgie, autrement dit « nécessaire », pas du tout une astuce inattendue qui viendrait comme une cerise sur un gâteau qui vaudrait tout aussi bien sans cette petite touche grotesque).
Frank Capra donc, utilisera tout au long de sa carrière ce principe : des romances… burlesques, des drames sur l’ambition et le pouvoir… comiques, des fantaisies existentialistes tendance conservatrices… comiques. L’humour toujours pour faire passer la pilule. Bessie à Broadway (Matinée Idol en version originale) donne le ton.
Mais dans l’idée du retournement cathartique (et donc du mélange de « genres »), il va même un peu plus loin.
Si on peut parler de l’alliance de la comédie avec la romance comme d’un machin transgenre, attention au retournement de cerveau, parce qu’on retrouve là encore la même idée de retournement avec un autre aspect bien particulier du film : le subterfuge du travestissement. Si la comédie est une tonalité visant à retourner nos idées reçues en allant d’abord dans le sens de notre cruauté naturelle (ce qui est entendu, préjugé), puis en la retournant contre nous-même, il y a une forme de comédie un peu dédaignée aujourd’hui (justement sans doute pour manquer trop souvent à son devoir de « retournement ») qui est la comédie du travestissement. Le travestissement est un genre burlesque (un peu grotesque, primaire) dans lequel on inverse les rôles, on combine des éléments censés être opposés, tout cela pour donner une impression d’étrangeté qui, on ne sait parfois trop pourquoi, produit l’hilarité. Le type de travestissement le plus évident, c’est celui du travestissement sexuel, quand un homme (plus rarement une femme) se déguise avec des habits de femmes et adopte des manières efféminées. Billy Wilder ou Ernst Lubitsch avaient joué dans certains de leurs films de ce travestissement sexuel (le premier avait même trouvé une variante dans The Major and the Minor avec le travestissement de l’âge). Or il y a également un autre type de travestissement, commun au XIXᵉ siècle aux États-Unis jusqu’au milieu du XXᵉ et qui n’a peut-être son pendant en France qu’à travers les numéros d’imitateurs, c’est celui des blackface minstrel shows. Aujourd’hui oublié et mal vu car considéré un peu vite comme un numéro raciste mettant en scène un acteur blanc se grimant en personnage noir, le blackface minstrel show n’est pas pour autant un spectacle tourné vers la dépréciation des Noirs, en tout cas pas toujours, et surtout pas ici. Car oui, le personnage principal de cette comédie sentimentale est, un peu comme dans Le Chanteur de Jazz, une vedette de Broadway de ce type de spectacle dans lequel un Blanc se travestit en Noir.
Alors, si une comédie réussie, basée sur un retournement cathartique, doit passer par la cruauté, est-ce à imaginer que Bessie à Broadway à un petit quelque chose de raciste ? Eh bien non, parce que cet aspect est presque anecdotique dans le film : le héros, Don Wilson, est une vedette à Broadway dans cet exercice, mais cela ne sert que de base de départ, car très vite on le voit changer d’environnement et se rendre en province.
Ça me semble toutefois un élément qui mérite de s’y arrêter parce que là encore, l’idée du retournement bienfaiteur, révélateur, y est très subtilement présente, et il questionne presque notre manière de voir la comédie aujourd’hui.


D’abord, que signifie le matinée idol du titre ? Au début du siècle à Broadway une matinée idol, c’est une petite star du dimanche, l’idole des jeunes filles, des ménagères et des grands-mères. J’ai qualifié Clark Gable de « bellâtre » plus haut, c’est un peu ça, et l’équivalent au cinéma à l’époque du film pourrait être Rudolph Valentino. En France, la séduction en moins, un Laurent Gerra pourrait être une telle matinée idol (passant lui par la télévision et non la scène) ou un Christophe Rippert, que les adolescentes à la fin des années 90 devraient encore se rappeler aujourd’hui. Or si Don Wilson se grime en Noir, et puisque c’est lui que le titre du film qualifie ainsi, il n’en est donc pas moins l’idole des femmes. Si de nombreux minstrel shows étaient sans aucun doute clairement tournés vers la farce cruelle (sans volonté ni tentative d’en proposer un retournement) pour se moquer de l’archétype du personnage noir, souvent dans le Sud, ici le show de Don Wilson joue au contraire sur ce jeu de décalage décrit plus haut et qui est à l’origine de l’humour, du rire (la fascination et le recours au travestissement ne datent pas d’hier). Le décalage ici, c’est de présenter un Blanc que l’on devine derrière son maquillage, représenter un personnage noir, mais l’astuce, la sophistication, tient en ce que ce personnage noir se grime (dans l’esprit du petit Blanc du début du XXᵉ siècle) en homme respectable, adoptant lui-même les habits et les manières de gentleman (l’idée du retournement à double détente est bien présente). On s’y tromperait en voulant y voir un personnage antipathique et ce n’est pas inutile à comprendre pour être sensible à l’aspect sentimental du film…
Si le sens du burlesque, c’est de se moquer suffisamment pour procéder à un retournement cathartique et révélateur, capable de faire disparaître les différences et de faire entrer le spectateur en empathie avec celui dont il se moque, le blackface minstrel show, en lui-même, n’est ni offensant ni raciste. Nous ne sommes pas dans un théâtre itinérant dans le sud des États-Unis, mais à Broadway, et une matinée idol ne saurait être un personnage de Noir grossièrement décrit : avant tout, il doit séduire. En dehors de ce maquillage grossier, quels sont les attributs et les particularités de ce comedian ? Quand il chante, le blackface ministrel adopte les pas et les gestuelles de chanteurs de music-hall de l’époque, ce n’est pas une caricature de Noir, c’est un personnage à part entière, comme Arlequin ou Guignol : balais dans le cul, costume trois-pièces, canotier sur la tête…, c’est du Maurice Chevalier ou du Charles Trénet (on pourrait remarquer le jeu de bras, c’est exactement le même, et très caractéristique de l’artiste faisant son tour de chant). Ce blackface-là est un charmeur, à la fois séduisant et amusant, bref, le gendre idéal, et par conséquent, il n’a en lui pas une once de vice et ne se risquerait jamais à paraître aux yeux de ces dames… subversif. De mauvais goût ou pas, l’humour n’est-il pas toujours, et d’abord… raciste, non par idéologie (sinon il serait subversif) mais par facilité, caricature ? L’humour avant de révéler la nature humaniste des hommes doit bien passer par une certaine forme de cruauté, et donc se moquer d’une cible toute désignée. Sinon le retournement ne peut pas se produire. Pour rire, il faut de la cruauté, et de la honte. Et pour cela il faut grossir les différences, aller au plus simple, caricaturer, et donc opérer une certaine forme de racisme naïf. C’est un peu comme une réflexion : les idées ne tombent pas du ciel, il faut bien avant de s’interroger sur elles-mêmes, que l’on se prenne les pieds dans d’étranges sottises. Pourrait-on être bienveillant sans cruauté et sans misère ?
Alors oui, le minstrel, en tout cas le nôtre, celui de Frank Capra et de Johnnie Walker, est une sorte de pitre dont le rire vise un peu sans doute à nous questionner sur la nature de nos différences. Il est même à noter, que déjà à l’époque, certains blackface minstrels étaient joués par des Noirs, et on peut imaginer que le succès de Josephine Baker en France soit lié au même principe de travestissement. Plus tard, et si on extrapole un peu, certains attributs de cette image caricaturale se sont retrouvés dans l’imagerie Motown des années 70, en particulier avec Mickael Jackson adoptant certains accessoires (les gants du gentleman) et toute une gestuelle inspirée des mimes (dans un numéro de danse, on n’est jamais loin des numéros d’acrobatie, surtout à l’âge d’or de Broadway où Ned Wayburn, directeur d’une école de danse et chorégraphe des revues produites par Florentz Ziegfeld, intégrait une section « danse acrobatique » à ses cours). Avec Michael Jackson d’ailleurs, la fascination naît peut-être aussi un peu d’un décalage se jouant sur presque tous les tableaux : racial, sexuel, âge, musical. Bambi, c’est la matinée idol des années 70-80… et c’est un retournement transgenre permanent.


Si au départ, l’idée de travestissement racial peut paraître cruelle, la force du décalage (et du rire) c’est aussi de proposer de plus en plus une image lisse capable d’être acceptée par les demoiselles bien comme il faut. Ou comment, ce qui peut apparaître cruel au départ, aide au contraire à rapprocher les individus, non plus malgré, mais grâce à leurs différences. Si on dit parfois que l’amour et la haine peuvent être proches, il en est de même avec le rire cruel et le rire bienveillant. C’est au fond le même élan, et c’est dans la tête du spectateur qu’une différence se joue. Si le racisme met toujours mal à l’aise, et si le travestissement n’est pas une manière… déguisée de nous montrer autrement que les choses ne peuvent être aussi simples, on pourrait se demander si ce malaise, en tout cas au départ, n’est pas nécessaire pour être combattu. Exactement comme le fou du roi, seul capable de lui transmettre ce qui fâche. Jusque dans les années 90, en France en tout cas, l’humour raciste (ou considéré comme tel aujourd’hui) était encore accepté, et puis avec le politiquement correct, ce n’est plus le personnage caricaturé qu’on pré-juge, mais la légitimité de l’acteur à se moquer. Si on juge l’acteur et l’interdit de se moquer, on l’interdit de nous révéler notre propre bêtise, car quand au fond, l’acteur, le travesti, l’imitateur, le minstrel, le pitre, le fou, prend une cible qui apparaît aux premiers abords comme une victime, il ne fait rien d’autre que nous prendre comme cible nous. Juger de qui a le droit de se moquer, c’est alors nous interdire de porter un regard sur nous-même, et toutes les vertus du rire, de la dénonciation bienfaitrice, du retournement, tout cela s’évapore. Et la société devient tellement intolérante à ce qui est jugé à tort comme des écarts (ceux des fous) que le travestissement ne peut être qu’un art vulgaire et grossier. Depuis vingt ans, on ne rit plus et on a gagné une forme d’intransigeance, de dénonciation accusatrice (qui pointe du doigt les autres plutôt que nous-mêmes) et d’inquisition permanente entre les légitimes à se moquer de, et les non légitimes. Et comment en vient-on à dissocier, ségréguer, les deux sinon en nous rendant victime grossièrement de ce qu’on pense dénoncer ? Ainsi, on jugeait encore Coluche légitime quand il jouait l’abruti populo, mais Michel Lebb ne l’était déjà plus quand il imitait l’accent africain. De la cruauté à la bienveillance, c’est peut-être moins parfois aux acteurs mêmes de faire un effort pour passer de l’un à l’autre, mais bien au public de lutter contre ses propres préjugés. C’est à la société d’accepter et de rendre accessible des spectacles rendant possibles l’art discriminatoire (oui, oui) du travestissement, exactement comme on accepte les vertus de la caricature, car sans travestissement, pas de transgression de l’interdit, pas de mise à l’épreuve des peurs ou des préjugés irrationnels. La farce est au service de la société en nous proposant un « retour de bâton » profitable pour tous : on balance des tartes, on se moque, mais cela n’est pas suffisant, car vient ensuite le clou du spectacle sans lequel la fable hilare demeurerait inachevée… quand la tarte se retourne contre celui qui l’a envoyé. De la cruauté, ou du rire stupide, on en vient parfois à l’humanité, et au rire bienveillant qui nous rapproche, au rire heureux et intelligent, qui fait qu’on ne rit plus de mais avec.
Toutes ces digressions laborieuses sont en fait nécessaire (prout, prout) pour expliquer les deux mouvements du film. Si cet humour bien particulier (obligé de passer par la cruauté pour nous la renvoyer en pleine poire et ainsi réveiller l’humanité en nous) fonctionne en deux temps, l’introduction (le premier mouvement) peut sembler un peu lourde et laborieuse. Non pas qu’il faille une demi-heure pour jouer de la cruauté pour finir avec une autre où on se taperait sur les cuisses et se tiendrait fraternellement par l’épaule…, c’est plutôt qu’il faut du temps comme pour un numéro complexe au cirque pour mettre en place tous les éléments qui nous péteront à la gueule dans le dénouement. En réalité, tout le film tient sur ces deux ou trois séquences qui, en toute fin, permettent de donner du sens à tout le reste.
Dans un premier temps, on peine encore à comprendre les enjeux de notre histoire d’amour entre un minstrel à succès de la scène de Broadway se retrouvant engagé par accident dans une troupe itinérante en province et une jeune première dévouée à son art, un peu naïve et sans grand talent. L’alliance pour l’instant du burlesque et de la romance peine à faire mouche, et l’attention repose sur l’efficacité de quelques gags, autant dire qu’on navigue longtemps entre plusieurs eaux. Et puis dans la seconde moitié du film, tout s’envole, se précise, et gagne comme une sorte d’évidence inattendue. Qui s’invite à la fête pour donner un sens à tout ça ? La cruauté bien sûr, et son double retourné : l’humanité.
Ainsi, quand les amis de notre minstrel star proposent à notre petite troupe de théâtre de venir se produire à New York, ce n’est bien sûr pas pour en apprécier l’étendue des talents dramatiques, mais bien dans l’intention cruelle de se moquer d’eux.
Le travestissement est un subterfuge et on en rit d’autant plus que certains s’y laissent prendre. Et c’est parfois la vérité qui se travestit. Alors, quand c’est toute une troupe d’acteurs de province qui se laissent ainsi abuser, ridiculiser, on est déjà dans une sorte de retournement réjouissant mais la cruauté prendra vite le dessus. On se moque des gens un peu naïfs à qui on joue un mauvais tour. Ce n’est qu’une farce, mais une farce non pas sur scène, mais une vraie, à laquelle on participe malgré soi (jolie mise en abîme). On se pose alors inlassablement les mêmes questions. Ne rit-on pas toujours aux dépens de quelqu’un ? Le véritable rire (celui qui apaise, se fait cathartique) ne doit-il pas toujours se faire cruel avant de devenir tendre et compassionnel ?
Le spectateur (du film) sera finalement très vite placé en face d’une cruauté brutale, et à ce moment Frank Capra, avec son humanité, sa finesse, nous détourne de ceux qui se moquent sans retenue (les spectateurs new-yorkais). Qu’y a-t-il de mieux pour faire ressentir la cruauté des uns à l’égard des autres qu’un fou rire non communicatif ?
Le fou rire, on le gagne quand quelque chose d’abord nous amuse, gentiment, et puis dans une vaine tentative de prendre du recul parce qu’on en mesure déjà un peu la cruauté, on s’interdit de se laisser aller ; la gêne alors s’installe, on réprouve cet élan qui nous frise le regard, et plus on se retient, plus on s’amuse de nous-mêmes ; le basculement ici qui interdira un retour à la normale, c’est la connivence avec son voisin ; elle serait avec la victime de nos rires qu’elle se changerait déjà en empathie, mais elle se fait au contraire avec un autre qui nous offre le prétexte de rire un peu plus, de rire même de nous-mêmes. Si le retournement a lieu pour ces spectateurs, il ne fait que renforcer l’idée de départ et on ne s’éloigne qu’encore plus de celui contre qui on rit. On reste dans la cruauté. Mais si, au contraire, on ne participe pas à l’hilarité générale, au fou rire, c’est un autre basculement qui s’opère, et ce sont les spectateurs moqueurs qui deviennent le sujet de nos yeux scrutateurs. Si cette hilarité n’est pas la nôtre, elle en devient bien plus cruelle. Car avant cela, le subterfuge du travestissement organisé par Don Wilson et ses amis peut sembler un peu cruel, mais on ne s’en émeut encore pas beaucoup. On attend que la bombe explose. Et quand elle explosera enfin, reste deux possibilités pour le cinéaste.


Bessie à Broadway, Frank Capra 1928 The Matinee Idol | Columbia Pictures, Frank R. Capra Production
Dans cette seconde partie, la scène de la représentation (que l’on connaît déjà pour l’avoir vue dans la première partie), sera bien la catastrophe annoncée pour les acteurs qui la jouent. L’étincelle humaniste ici, et qui plonge le film dans une forme de comédie transgenre, vient de la volonté de Capra de nous montrer l’autre face du masque (celui du théâtre double). Don Wilson commence à avoir honte et semble regretter de faire subir ce supplice à ceux qui sont devenus désormais ses partenaires (encore plus pour celle qu’il aime). On a déjà entamé un processus de « reconnaissance ». On s’attarde aussi sur le regard presque d’enfant naïf du directeur de théâtre tout heureux d’assister aux débuts de ses acteurs sur les planches de Broadway et finissant en larmes incrédules devant le public hilare.
Frank Capra ne manque pas son retournement et fait du Capra : le gagman laisse place au clown triste et à son empathie. Il détourne les yeux et pointe son attention ailleurs que sur ces spectateurs indélicats en prenant le parti des victimes.
Action, réaction, champ, contrechamps, cruauté, empathie… La mise en scène est moins une affaire de technique que de proportion, de choix et de distance : dans ce dénouement, c’est bien la capacité de Capra à prendre enfin de la distance, à faire un choix clair, qui nous permet de regarder la situation sous un angle différent. On ne rit plus, on pleure, et le masque s’est retourné.
Le style Capra s’affirme même encore un peu plus, car déjà la fable doit s’achever sur une note positive. Ultime retournement des masques, c’est celui de son blackface minstrel qui vient à couler sous la pluie dans une excellente scène de « reconnaissance » (au sens dramaturgique comme au sens littéral). À l’hilarité stupide de la masse, Capra oppose déjà sa vision optimiste, naïve et plutôt conservatrice du « nous », un « nous » de petit comité, resserré autour du noyau familial (ou de ce qui le deviendra) et d’une « communauté », celles des acteurs de province. Cette séquence de « reconnaissance » sous la pluie deviendra (ou était déjà) un classique, voire un cliché, dans la comédie romantique.
« Comme les larmes dans la pluie », dira, un demi-siècle plus tard, un humanoïde… Les masques coulent, et c’est une autre réalité qui se présente à nous. Du rire, à la cruauté, au burlesque, on passe enfin à la romance, à l’amour de l’autre. Comme dans les contes pour enfant. Happy End. Magie du cinéma.
L’épilogue quant à lui, sonnera presque comme un dernier paragraphe à la fable : « Ils vécurent longtemps et eurent beaucoup de plaisir à s’aimer sur les planches d’un théâtre itinérant. »

 Année : 1929
Année : 1929











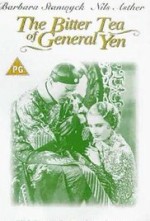






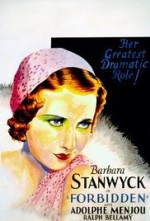 Année :
Année : 






 Année : 1935
Année : 1935
















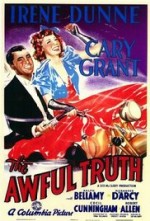 Année :
Année : 







 Année : 2007
Année : 2007