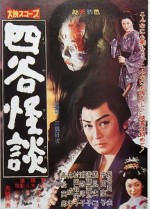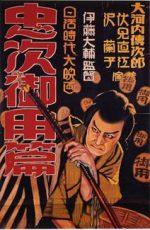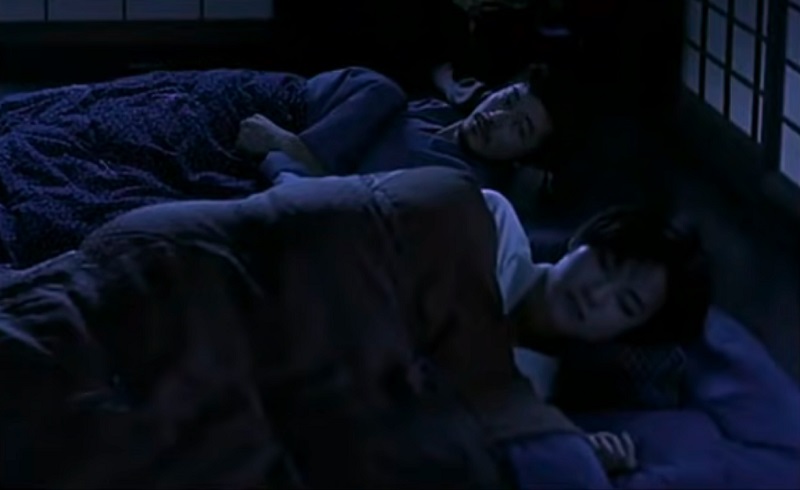Qui est le ninja ?

Les Carnets secrets de Senbazuru
Titre original : Senbazuru hicho / 千羽鶴秘帖
Année : 1959
Réalisation : Kenji Misumi
Avec : Raizô Ichikawa, Jôji Tsurumi, Sachiko Hidari, Tamao Nakamura
Petit bonbon plein d’aventures populaires qui ne vole pas très haut, mais qui fait bien plaisir à voir. Une sorte de Robin des bois ninja accompagné d’un nain (joué par un enfant façon Spy Kids) s’interpose entre un clan dont le chef cherche à venger son père et un autre bien plus puissant ayant ses entrées dans les arcanes du pouvoir shogunal. Cela a beau être de la pure fantaisie (avec beaucoup de politique dedans), on peine à comprendre qui combat qui au juste pendant un long moment. À se demander si le public japonais n’identifie pas immédiatement certains codes vestimentaires qui aideraient à séparer les uns et les autres, un peu comme un Occidental reconnaîtrait sans problème dans une adaptation des Trois Mousquetaires qui appartient aux mousquetaires du roi et qui roule pour le cardinal, ou si ces histoires n’ont pas toutes déjà été racontées cinquante fois… L’occasion de se demander, par exemple, si toutes les pastilles (mon) identifiant chaque clan ou région et apparaissant un peu partout des lanternes, aux kimonos en passant par les bandeaux cérémoniels (de deuil par exemple) sont toutes réelles dans les fictions (on reconnaît, la principale, pour les moins initiés, au moins celle des Tokugawa) ou si la fiction a l’habitude d’en inventer. Si elles sont facilement identifiable par le public japonais, cela pourrait expliquer qu’on ait parfois l’impression d’être laissés sur le carreau au milieu de ces forêts de clans. Au-delà des codes, il doit y en avoir d’autres qui restent invisibles pour un public non initié et pour qui ces récits sont tout à fait divertissants, mais parfois un peu obscurs.
On retrouve ici beaucoup des éléments récurrents des récits populaires, et cela, dans n’importe quelle culture au monde : la quête de l’objet disputé par divers partis (MacGuffin nippon) ; le gang ou le clan qui complote dans l’ombre et vole les honnêtes petites gens ; le chevalier au grand cœur qui se charge (ou est chargé comme ici) de ramener l’ordre et la justice ; son acolyte dévoué (Passe-Partout, pour les intimes) ; la femme de mauvaise vie qui vient mettre des bâtons dans les roues de notre héros et qui finit par en tomber amoureuse ; et, enfin, le seigneur qui, du haut de sa stature de chef intouchable, donne les bons points (et les têtes coupées) à la fin de la partie.
En plus de la présence réjouissante de Raizô Ichikawa (que je vais finir par mieux apprécier dans les comédies que dans les films où il prend une grosse voix de grand garçon), on remarque la présence assez inattendue de Sachiko Hidari avant qu’elle participe (alors que tout ce petit monde restera le plus souvent à Kyoto tourner des chefs-d’œuvre en robe de chambre) à la nouvelle vague japonaise (on peut même dire qu’elle a déjà commencé si on considère le style et la présence au scénario de Shôhei Imamura sur Chronique du soleil à la fin de l’ère Edo). Elle vole la vedette à un peu tout le monde dans l’épilogue du film en à peine dix secondes durant lesquelles elle a le temps de désacraliser la séquence des sentences des accusés (parodie ou pas des séquences de jugement dans Rashômon). Mademoiselle (ou Madame, puisqu’elle s’est mariée en cette même année) joue dans un chambara sans prétention, mais c’est bien elle qui tue déjà toute la concurrence en tirant la couverture à elle. C’est Giulietta Masina dans les années 50, et avec la nouvelle vague, ce sera bientôt Anna Magnani. Actrice formidable. On voit d’ailleurs, bien avant ce finale plein de dérision, une séquence où elle s’énerve qui change totalement avec le jeu très codifié encore en rigueur à l’époque. Elle n’a pas encore cette voix criarde et plaintive qui fera plus tard sa caractéristique, mais la spontanéité et la justesse de ton, associées au respect des gestes précis et codifiés du genre, je crois que c’est du jamais vu.
Bref, je sors mes propres carnets et pars à mon tour (et sans nain) en quête d’informations. Nous sommes en 1959, c’est donc la même année que Le Fantôme de Yotsua et surtout quelques mois après le plus ancien film vu jusqu’à présent du bonhomme : Les Carnets de route de Mito Kômon. On remarque ici, comme pour ce dernier, un certain mélange des genres qui expliquera peut-être pourquoi Misumi sera plus tard affecté à la réalisation de Zatoïchi (jusqu’à exagérer encore le trait avec Hanzo). Diriger des acteurs dans une comédie, là où le rythme, les mimiques et la compréhension parfaite des soubresauts qui animent la situation d’une séquence, ce n’est pas donné à tout le monde, même si ce n’est pas vraiment ce qu’on retient de Misumi (peut-être à tort — moi le premier, quand je m’extasie de sa maîtrise sur Brassard noir dans la neige ou sur Tuer !).
À force de voir toujours les mêmes têtes d’ailleurs, on peut virtuellement reconstituer une certaine idée (probablement loin de la réalité) du fonctionnement d’un studio pour les films en costumes. Beaucoup de ces acteurs sont issus de la scène kabuki. Et pour les plus en vue, ils sont les héritiers de familles prestigieuses. C’est le cas ici, par exemple de Raizô Ichikawa (le patronyme « Ichikawa » semble évoquer une série d’acteurs d’une même lignée). Comme on peut le voir dans Herbes flottantes sorti la même année, on a affaire à un milieu où on reprend le flambeau d’une génération à l’autre, où on adopte des disciples, et où on travaille en troupe sur plusieurs années. Peut-être plus que dans les productions de films modernes, tout ce petit monde sous contrat vit et travaille probablement aux alentours de Kyoto pour bénéficier à l’occasion des extérieurs de l’ancienne capitale ; certaines majors y possèdent par ailleurs des studios ; et de nombreux acteurs issus de la scène y sont originaires (avec Osaka).
On aurait tendance en bons Français que nous sommes à tout voir sous l’angle du désir du réalisateur quand le système se rapproche probablement plus du système hollywoodien de l’âge d’or avec des artisans et des techniciens sous contrat (ce qui explique en grande partie le rythme de production qu’on jugerait indécent aujourd’hui : les techniciens, dont fait partie le réalisateur, travaillent à l’année, pas sur une œuvre en particulier). Dans ce cadre, la norme, ce serait donc les employés (acteurs ou techniciens) qui formeraient le gros des personnes présentent sur un lieu de tournage, et ces groupes de travail se retrouvant sans cesse d’un film à l’autre sur plusieurs années (c’est le cas ici, on voit toujours les mêmes têtes). Ces employés de studio seraient alors à l’occasion rejoints par des acteurs ou des techniciens disposant d’un contrat ponctuel afin de pouvoir répondre à des exigences propres d’une production (on emploie un acteur spécifique comme on court la campagne pour trouver un spot répondant à l’exigence d’une séquence spécifique en somme). Ce serait le cas pour Ozu sur Herbes flottantes d’ailleurs (remake de la même histoire de troupe de théâtre tourné vingt ans plus tôt), le film étant exceptionnellement réalisé par Ozu avec les moyens de la Daiei. Et c’est donc ainsi que techniciens et acteurs du film sont en contrat avec la Daiei (imposés par conséquent au réalisateur). L’acteur principal du film, Ganjirô Nakamura, comme Ozu à ce moment-là, ne semble pas être soumis à un seul studio.
Nakamura semble être l’équivalent d’un Louis Jouvet ou d’un Laurence Olivier. Il n’a pas été choisi au hasard pour Herbes flottantes : il est lui-même un acteur fameux de kabuki et, à en croire sa fiche biographique wiki, c’est un art qu’il a hérité de son père et qu’il a lui-même transmis à son fils. Voire… à sa fille, Tamao Nakamura. Les deux ont souvent travaillé ensemble dans les films de Misumi qu’on a pu voir lors de cette rétrospective à la Cinémathèque française (elle a un rôle dans ce film). Elle a le plus souvent joué des rôles de faire-valoir, mais le plus amusant (et le plus éclairant), c’est que si on continue de fouiller les carnets roses et blancs des pages wiki, on apprend qu’elle s’est mariée en 1961 avec un autre acteur fameux de la firme (enfin, peut-être est-il devenu “fameux” une fois mariée avec la fille du Laurence Olivier local) et bientôt producteur de ses propres films : Shintaro Katsu. Réunissez Kenji Misumi, Shintaro Katsu, Tamao & Ganjirô Nakamura et vous avez le casting quasi complet déjà des Carnets de route de Mito Kômon en 1958. Un petit monde, ces studios.
Un monde surtout qui marche d’un même pas, probablement donc plus dicté par les patrons des studios que par un réalisateur. C’est pourquoi, quand on sort nos habituelles tournures critiques pour attribuer à un réalisateur la responsabilité de tout ce que l’on voit à l’écran, parfois même de l’histoire, on ferait bien de se rappeler qu’à l’image des acteurs d’Herbes flottantes (ou au hasard, des Acteurs ambulants) et de toutes les troupes au monde, un seul homme ne décide pas de tout. On en a connu d’autres des réalisateurs de l’âge d’or nippon qui, une fois les studios écroulés, n’étaient plus capables de proposer quoi que ce soit de bien enthousiasmant (même chose pour des cinéastes hollywoodiens). Coupez un réalisateur de toutes ses équipes techniques travaillant comme lui pour le compte d’un studio et qui a su peaufiner sans relâche une méthode de travail, film après film, et vous vous retrouvez, comme dans Les Acteurs ambulants, avec une tête de cheval toute cabossée vous laissant démunis face au spectateur. Impression d’autant plus renforcée que lors d’une séance suivante, une responsable des Archives du film japonaises précise qu’à l’occasion de la rétrospective Misumi sur laquelle celle de la Cinémathèque française a calqué la sienne, elle avait interrogé d’anciens collaborateurs du cinéaste qui indiquaient que sur le plateau de tournage, le réalisateur s’occupait uniquement de la mise en scène (des acteurs, s’entend). Cela ne signifie pas qu’en amont, Misumi ne se soit pas mis d’accord sur les effets à produire avec la caméra avec son directeur de la photographie habituel (Chishi Makiura, à partir de 1960), mais c’est une indication relativement importante quand on a l’habitude de faire d’un réalisateur l’auteur du film.
Pas sûr toutefois que critiques et amateurs aient l’envie de heurter ce qui n’est au fond qu’une facilité. Ou un mythe séduisant. Quelle belle histoire à se raconter que de présumer que le réalisateur ayant collé son nom en face du titre de “réalisateur” au générique d’un film soit maître de tout ce qui apparaît à l’écran (et que par nos seules déductions plus ou moins éclairées, on vienne à en décrypter les… intentions). Le réalisateur démiurge. L’hauteur omniscient. Un peu trop souvent, nos icônes, nos jalons pour nous y retrouver dans le noir, nos doudous pleins de bave que l’on agite fièrement encore assis sur cinq centimètres de couche. Avec des conséquences troublantes et embarrassantes quand on propose ainsi des rétrospectives (bienvenues, mais parfois un peu tordues) en programmant des séries de films sans en montrer la fin quand un volet final est réalisé par un autre ou carrément quand le début d’une série manque à l’appel. Bon, les limites de la logique des auteurs et des monographies, c’est aussi, un peu un problème de riches, il faut le reconnaître (commentaire soufflé par les non-Parisiens). Dans le film du jour (celui que j’ai vite, comme à mon habitude, mis de côté), il y a les carnets secrets du titre, et il y a une boussole. Il semblerait qu’on cherche tous à notre manière cette boussole une fois perdus dans cette forêt de films ; et certains jouent peut-être un peu trop bien le rôle de la femme de mauvaise vie cherchant à nous faire perdre le nord… Il faudrait aux cinéphiles des pastilles identitaires (mon) pour savoir qui est qui et qui fait quoi dans un film, mais tous se dérobent, exprès : ce sont des ninjas !

Qui est le ninja ?
Image (sans doute promotionnelle) piochée sur le site de la Cinémathèque.
En attendant, je reviens sur mon doudou du jour : on se demande bien pourquoi Sachiko Hidari a tourné après celui-ci si peu de jidaigeki. On pourrait tout bonnement se dire que son style était beaucoup plus approprié aux films de la nouvelle vague, tout comme on pourrait se dire… qu’une fois mariée à un réalisateur précisément de la nouvelle vague, elle n’avait plus grand-chose à faire à Kyoto. Doit-on y voir alors une forme… d’intention de l’actrice, auteure de sa propre carrière ? Boh (avec l’accent japonais).
Il faut que j’arrête de lire les carnets blancs, moi… Promis, le prochain film, je paraphrase l’histoire du film et essaie d’y comprendre les intentions de l’auteur.
Qui ?

Image promotionnelle du film avec Sachiko Hidari et Raizô Ichikawa (dégottée sur un site de fan de l’homme aux yeux de biche)
Sur La Saveur des goûts amers :
Liens externes :