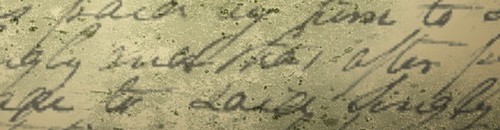Janvier – Juin 2026
Juillet – Décembre 2026 >
février 2026
El romance del Aniceto y la Francisca, Leonardo Favio (1967)
Sous-titré « le voleur de poule ».
Concision du récit et lenteur de la mise en scène : le défi éternel, et une parfaite réussite ici. Jolie participation également des mouvements de caméra pour participer au récit (mouvements en arrière pour élargir le sujet, panoramiques d’accompagnement ou pour intégrer un nouvel élément dans le cadre). Certains effets « nouvelle vague » comme les jump cuts ou les gros plans de corps nus sont peut-être un peu datés, mais globalement, une perle qui mérite son statut d’œuvre phare du cinéma argentin. (Pas fan en revanche des combats de coq, même si je suppute une valeur symbolique à la chose – chose à laquelle je resterai toujours aussi hermétique.)
Ajout dans le Top espagnol et Amérique du Sud.
Ichi the Killer, Takashi Miike (2001)
Quelques boomers qui se cassent de la salle. Les mêmes qui nous empêchaient de regarder les dessins animés japonais ou Tarantino dans les années 80-90 parce que c’était violent. Joli conflit de générations.
Sinon, c’est assez typique des réalisations d’adaptation des mangas. Beaucoup d’idées et d’audaces visuelles. On ose tout. L’écriture respecte tout autant l’esprit manga : des personnages construits sur des caricatures XXL, sur des traumatismes formateurs et sur des vices spécifiques retournés comme des forces. C’est comme si Tarantino rencontrait Hanzo the Razor. Il y a une certaine logique à voir le réalisateur d’Audition (vu il y a vingt ans, me semble-t-il) signer cette adaptation.
Il y avait quelque chose dans l’atmosphère au tournant du nouveau millénaire… Seven ou Fight Club possédaient déjà cette fascination pour le gore charcuté en lumière chaude, cadrage dégoulinant et montage resserré. Je ne suis pas le plus grand amateur de torture et d’hémoglobine (tendance Grand-Guignol) au cinéma, mais l’écriture déconstruite, les caricatures à la Tarantino et la chorégraphie de la violence, ce serait plutôt ma came.
Black Coal, Diao Yi’nan (2014)
Polar antonionien chinois plutôt bien ficelé et excellemment réalisé. L’intrigue paraît souvent être mise de côté au profit d’une ambiance glaciale et crépusculaire (cold case oblige), si bien que certains éléments cruciaux sont lâchés l’air de rien, et quand ils ressurgissent par la suite, les resituer avec précision relève de l’effort impossible. Reconstituer les morceaux, cela peut se révéler ardu, mais quand il faut se fier à une mémoire défaillante (tout attentive alors à se laisser imprégner par l’ambiance), plus rien n’est certain…
Mais l’intrigue a-t-elle tant que ça besoin d’être comprise dans sa globalité ? Non. C’est sinistre, l’ancien flic est un parfait antihéros (un vrai salaud qui paie pas de mine), les twists nous font chavirer jusque sur la piste de dance et sur la patinoire… Que demande le peuple ?
L’univers glacial d’une ville moyenne de province avec son givre et ses néons que l’on visite à vélo ou en Solex (sorte de Rossinante moderne), c’est tout de même quelque chose.
City on Fire, Ringo Lam (1987)
Chow Yun-Fat fait partie de cette trempe d’acteurs baroques et multi facettes, comme Song Kang-Ho en Corée un peu plus tard, capables de tirer toute une production derrière lui. Si John Woo a pu se permettre le même baroque, quitte à se répandre sans honte dans le mélodrame (ou n’oublie pas le « Sue Ellen » du Syndicat du crime à l’époque de la série Dallas), c’est bien parce qu’il disposait d’un acteur d’assumer tous les genres possibles à l’écran. On sent bien sûr aussi l’influence de Sergio Leone, mais l’originalité d’un acteur comme Chow Yun-Fat, c’est qu’il joue en permanence et dans tous les films le bon, la brute et le truand. À lui le salle boulot, les grands instants de bravoure, les jolies filles et les meilleures répliques. C’est un pitre. Seul un pitre, un clown, à la fois clown blanc et Auguste, pourrait assumer cette fonction dans des films si baroques. Et c’est donc bien grâce à sa présence que les productions hongkongaises pouvaient s’autoriser les pires audaces. Que serait ici cette histoire d’infiltration et de braquage de bijouteries sans l’aspect romantique et le tempérament particulièrement casse-couille de la petite-amie, utile pour tout le volet comique du film. John Woo reprendra (ou s’inspirera, je n’ai pas la chronologie en tête) ce principe avec des personnages féminins jouant certes toujours les utilités dans des caricatures, mais au moins, les actrices étaient amenées à proposer des interprétations comiques (Tsui Hark faisait la même chose dans Pekin Opera Blues). Jusqu’à My Sassy Girl, cette sorte de renouveau de la comédie de remariage de l’âge d’or du cinéma américain, sera une constance dans le cinéma asiatique.
janvier 2026
Ivan, Alexandre Dovjenko (1932)
Deux ou trois plans/moments intéressants : la mère qui file se plaindre de la mort de son fils sur le chantier du barrage auprès d’un responsable qui feint de s’impliquer pour qu’un tel drame ne se reproduise plus (la mère semble sceptique, résignée, peut-être, et décide de partir) et la même mère qui avance à la fin au milieu des « camarades » dans une salle bondée, les toisant comment des poulets en travelling arrière.
Pour le reste, c’est nul. La propagande n’aime pas les films narratifs ; beaucoup de cette époque se ressemble, mais Dojvenko se montre particulièrement mauvais à livrer un semblant de continuité narrative (je pense que les autorités forçaient cette vision « totale », panoramique, non centrée sur des personnages : l’individu, c’est petit-bourgeois), à diriger des acteurs et à trouver un semblant de rythme.
Ce sont les effets du cinéma muet. Avec l’apparition du son (des dialogues, plus précisément), l’image alliée à de la musique ne produit plus cette sorte de berceuse sidérante propre au muet : le parlant exige d’instaurer des situations ou un récit-cadre dans lequel une « voix » présente des événements façon « histoire au coin du feu », et ça, beaucoup de réalisateurs ne le comprennent pas encore. Le muet pouvait prendre le rythme et la composition d’une pièce de musique, d’un ballet ; avec le parlant, la scène et la logique narrative imposent un nouveau cadre auquel plus personne ne peut échapper.
Aerograd, Alexandre Dovjenko (1935)
commentaire :
5 heures 40, André de Toth (1939)
Énigme policière so british censée se dérouler à Paris avec les codes en usage de l’autre côté de l’Atlantique dans une production hongroise. La globalisation. (Excellente direction d’acteurs.)
Pitfall/Le Piège, André de Toth (1948)
Quintette à la Naruse qui tourne à l’américaine : cinq protagonistes, trois armes à feu, que pourrait-il se passer de mal ?
– Le mari, agent d’assurance, forcément lâche et coureur (code Hays oblige, la production l’a probablement affadi, quel honnête homme n’a pas fauté au moins une fois dans sa vie ?).
– Sa femme, rangée, digne, inflexible, jusqu’au jour où son homme lui avoue sa liaison (on peut regretter de ne pas la voir avec un pistolet à pâtisserie ; son arme à elle, ce sera les apparences : en bonne petite bourgeoise, elle décidera de faire comme si de rien n’était).
– La femme déchue, digne aussi, mais parce qu’elle est belle doit en payer les prix en attirant à elle les hommes lâches et dangereux (elle ne demandait rien d’autre que de finir elle aussi à proposer matin, midi et soir des œufs brouillés à son homme).
– Son fiancé, un vaurien, facilement manipulable et un poil trop « protecteur » (le genre de types à habiller sa poupée avec des cadeaux hors de prix et à ne pas supporter qu’on lève les yeux sur sa chose)
– Enfin, le manipulateur qui convoite la même femme que les deux autres et qui, éconduit, décide de se venger en resserrant un piège entre ses concurrents.
Comment l’équation se résout-elle si l’on considère qu’il faut y retrouver la fin du Repas de Naruse ? Indice : il faut toujours qu’un plan ne se déroule pas comme prévu (et le môme, à ma grande déception, ne détient aucun pistolet à eau).
Les dialogues sont remarquables, surtout au début (la banalité de la vie maritale montrée comme un polar). Et les acteurs le sont tout autant (j’ai parfois des réserves quant à son utilisation dans des films noirs, notamment dans Le Grand Attentat, mais sa nature quelconque sied exactement à ce personnage).
Enfants de salauds, André de Toth (1969)
Nouvelle entrée dans les Ratés de la Cinémathèque. Ajout dans les top films britanniques.
George Washington, David Gordon Green (2001)
Du très bon et du moins bon. Dans le très bon, notons l’excellent épilogue. Une tonalité nostalgique et désinvolte. Un montage savant, alambiqué, avec la voix off d’une des adolescentes qui n’est pas le personnage principal. C’est même une sorte de mélange entre montage alterné et montage-séquence. Cela fait peut-être un peu bande-annonce ou publicité pour une introduction, mais il y a un côté Il était une fois en Amérique ou Ce jour-là sur la plage joliment maîtrisé. La photo est belle, tirant sur l’orange. Les acteurs, surtout les plus jeunes, se débrouillent pas mal.
Pour le moins bien, j’ai été plutôt perturbé par la nature protéiforme du récit. Après un quart du film environ, l’histoire connaît un virage tragique qui le fait basculer dans le drame alors que l’on suivait jusque-là une chronique urbaine adolescente dans je ne sais quel trou perdu du pays. Le style ne change pas pour autant : un événement tragique majeur se poursuit et presque littéralement, on le met dans un coin et l’on n’en parle plus. Il détermine en partie les événements futurs de la chronique, mais pas tous. Ça donne un côté artificiel et pour le coup mal maîtrisé au film. C’est parfois un peu creux, comme avait pu l’être à son époque le premier film de Spike Lee, Do the Right Thing. Sur le choix des séquences ensuite… C’est la difficulté des chroniques : imaginer des situations détachées d’une logique narrative continue qui suivent une chronologie vite établie et qui illustrent au mieux l’époque et l’univers dépeints. C’est peut-être la nature composite du film qui provoque ça, mais j’ai trouvé ces situations souvent trop statiques et répétitives. Quand elles étaient en rapport avec l’événement tragique ayant fait basculé la nature du récit, elles me semblaient bien mieux choisies, mais leur nature ne faisait que renforcer l’étrangeté de l’ensemble. Pourquoi montrer cette bande d’ouvriers réunis dans un terrain vague regardant toujours dans la même direction ? C’est affreusement artificiel, mal contextualisé et l’on se demande bien ce que ces types ont en commun avec les jeunes adolescents. La voix off du début donne peut-être un indice, expliquant poétiquement ce qui lie et sépare les générations de leur coin paumé, mais cela ne me semble pas justifier une telle insistance envers des figures somme toute inutiles.
Bref, ça reste excellent, surtout pour un premier film. L’ambiance, la tonalité sont assez appréciables.
John et Irène, Asbjorn Andersen, Anker Sørensen (1949)
Les mêmes ingrédients que le précédent, mais beaucoup moins bourgeois et peut-être déjà plus dans une veine criminelle. Le mode opératoire est le même, à se demander s’il n’y aurait pas chez les Scandinaves une forme de code Hays (que s’appelorio la Bible sans doute). Sinon, c’est presque aussi convenu, aussi peu audacieux et sans créativité. Dommage, parce que les deux réalisations sont irréprochables et les acteurs ne sont pas mal du tout. Les personnages sont insignifiants, voire insupportables (deux couples changeants dans les deux films), les motifs de disputes, ridicules. Cela reste des films sentimentaux colorés avec deux ou trois taches criminelles parfaitement orienté pour le public féminin, pieux et bourgeois de l’époque. Pourrait-on faire autre chose avec des histoires de couple ?… (L’Italie et le Mexique, voire l’Espagne produisaient au même moment ce type d’histoires à l’eau de rose tirant sur le rouge. Cottafavi en a pondu quelques uns. Les bonnes surprises sont rares.)
La mort est une caresse, Edith Carlmar (1949)
Fantasme de bourgeoise qui veut se faire le garagiste. Vingt ans plus tard, les Scandinaves reviendront sur le devant de la scène avec le même type de scénario… grâce au porno.
« Le poison de la jalousie mène au féminicide : tremblez, mes petites bourgeoises ! Si jamais l’envie vous prenait d’agresser votre amant garagiste avec votre lime à ongles, vous finirez étranglées ! Quelle ingratitude ! »
Fantozzi, Luciano Salce (1975)
J’y allais avec quelques craintes, vu mon incapacité à adhérer à l’humour grotesque italien (comme japonais) des années 70. Cela n’a pas manqué. Au-delà des explications habituelles sur l’impossibilité bien souvent des comédies de ce type à s’exporter et sur l’humour générationnel (ce n’est pas la même chose de le découvrir enfant en famille qu’à mon âge), je continue de dire que l’humour « est vertical, ascensionnel, il regarde vers le haut, moque les puissants, non les miséreux. » C’est rare que je ne puisse pas tenir jusqu’à la fin d’un film. Mais quand un film est odieux avec les petites gens, les personnages fragiles, les enfants, culturel ou non, je n’arrive pas à rire. Je préfère rire des bourgeois et des princes.
Les Filles, Sumitra Peries (1978)
commentaire :
Écoutez les grondements de l’océan, Hideo Sekigawa (1950)
Dans la jungle des tyrannies
La guerre fait rage
Pour abrutir les hommes
Un bataillon marche
Sans trop savoir s’il suit
Un convoi funèbre
Ou s’il est déjà composé
De cadavres ambulants
L’officier a dit « crevez »
Alors les soldats ont crevé
Il a dit « stop »
(Parce qu’ils ont bouffé son cheval)
Alors ils ont stoppé
Les obus pleuvent
Une pluie de sang s’abat
Sur eux
Ou sur ceux qu’il reste
« Le Japon, c’est de quel côté ? »
« De là où vient la pluie »
Placé dans les films préférés / japonais préférés
Rapt, Dimitri Kirsanoff (1934)
Dimitri semble avoir totalement perdu son mojo en passant du muet au parlant (comme bien d’autres). Le cinéma parlant passe inévitablement par une conjonction rapide et cohérente d’éléments sonores. L’usage de la musique devient purement narratif : elle survole le récit, l’illustre. Ici, elle semble s’essayer à des expérimentations au fil de l’eau. Cela pourrait se comprendre si Dimitri avait expérimenté au muet, mais ce n’est pas vraiment le cas (en tout cas pour ses deux chefs-d’œuvre). C’était plus un poète des images. Le rythme est donc lent, chaotique, le récit fait du surplace, tout paraît monté avec les pieds. Les acteurs sont loin d’être au point alors que le résultat sembler flirter avec les films de la période de transition du muet au parlant quand les réalisateurs, pris de court, se mettaient à rajouter des séquences dialoguées et sonores sur le tard. 1934, Dimitri n’est pas en retard, il est à côté de la plaque.
Et… pardon, mais que fait la police ? Ça n’a ni queue ni tête : un type kidnappe une jolie blonde du village voisin et on ne voit pas un képi, pas une figure d’autorité de tout le film ?
Onze heures sonnaient, Giuseppe De Santis (1952)
Les codes du film catastrophe appliqués à la cage d’escalier d’un immeuble qui s’effondre sous le poids de dizaines de femmes répondant à la même petite annonce pour un poste de dactylo. Plus d’un demi-siècle après et dans un autre pays, le fait divers est indolore, mais à l’époque, cela frôle un peu l’indécence. La place laissée dans le film au journalisme de foire pourrait prise par les auteurs de ce récit. Le cinéma n’a eu de cesse depuis de multiplier ce genre d’expériences d’illustration d’événements tragiques, et il n’y aurait pas une forte connotation politique à cette approche, c’en serait très certainement insupportable. De Santis, qui colle un peu trop au genre du film catastrophe avec ses excès de pathos avec ces instants de bravoure et ces rencontres inattendues qui augurent du meilleur en se vautrant dans le mélodrame, s’en tire grâce à la dénonciation franche et nette de la misère, présentée comme principale responsable de cette catastrophe. Lui et ses scénaristes (parmi lesquels Cesare Zavattini dont on reconnaît la patte à la frontière entre le néoréalisme et le mélodrame) n’ont pas cédé non plus à la facilité qui aurait consisté à caricaturer les différentes figures pouvant apparaître à tour de rôle comme responsables de l’effondrement de la cage d’escalier (le propriétaire, l’architecte, le comptable qui a passé la petite annonce dans le journal). D’autres personnages tirent plus volontiers vers le mélodrame (dans le sens « mélange des genres ») comme le père pingre (forcément interprété par Paolo Stoppa), le locataire bourru ou la concierge. Le mélodrame n’aime rien de mieux que les caricatures…
Le mélange des genres, entre néoréalisme et mélodrame, va même jusqu’à offrir au spectateur quelques relents probables de téléphones blancs avec des pompiers et des policiers tout ce qu’il y a de plus humain et de compétent.
Casting remarquable, mais c’est une constante dans le film catastrophe : à l’image des films à sketches, le récit éclaté du genre permet de telles réunions.
Carmen de Kawachi, Seijun Suzuki (1966)
Le travail de Suzuki avec tout ce qui tient de la forme, de la technique et de l’esthétique vaut toujours le coup d’œil : composition des plans, recherche du mouvement ou du cadre parfait, addition de musique pour proposer une sorte de spectacle total, jeux de montage, effets de transition et des putains de décor, des accessoires, des trouvailles, tout ce qui alimente une certaine densité esthétique à son film.
Reste que cela ne suffit pas. L’intrigue fait passablement penser à celle de La Femme insecte, film réalisé quelques années plus tôt par Shôhei Imamura. Deux chroniques d’une femme qui abandonne la campagne (plus précisément ici la montagne) pour rejoindre la ville. Imamura comme Suzuki dépoussièrent ce sujet classique dans les shomingeki, mais là où Imamura adopte une approche naturaliste, presque documentaire, voire psychosociale, Suzuki préfère la chronique comique qui flirte avec la satire. J’ai souvent eu l’occasion de le dire ici : il est rare que la comédie japonaise, quand elle passe par autant d’exubérances, parvienne à me séduire. Les comédies douces-amères ou pince-sans-rire à la Ozu ou à la Shimizu auront davantage ma préférence. Oh, bombe, d’Okamoto ou Les Combinards des pompes funèbres, de Misumi se placent exactement dans cette veine de la satire grotesque, aux accents presque napolitains, à laquelle je n’accroche pas du tout. À aucun moment, je ne suis en mesure de m’identifier au personnage principal. Trop d’agitation, trop de situations tirées par les cheveux, et je me désintéresse du sort des personnages. Je n’aime pas les gens qui parlent fort et qui remuent dans tous les sens, j’y suis pour rien…
Si vous appréciez le contenu du site, pensez à me soutenir !
Réaliser un don ponctuel
Réaliser un don mensuel
Réaliser un don annuel
Choisir un montant :
Ou saisir un montant personnalisé :
Merci.
(Si vous préférez faire un don par carte/PayPal, le formulaire est sur la colonne de gauche.)
Votre contribution est appréciée.
Votre contribution est appréciée.
Faire un donFaire un don mensuelFaire un don annuel