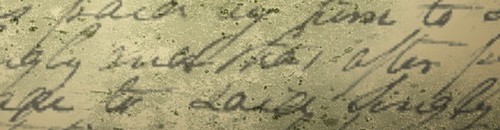Juillet – Décembre 2024
décembre 2024
Agora, Alejandro Amenábar (2009)
Vous vous réveillez un matin, et vous vous dîtes que c’est idiot qu’il n’y ait pas de film sur un personnage comme Hypathie. Et là, quelqu’un vous dit que ce film existe… Étrange impression que de voir un film que l’on avait imaginé quelques heures plus tôt. À la différence, que ce film n’était pas hollywoodien. On s’en contentera. Ce n’est pas si mal. Je suppose que tout ce qui concerne l’ellipse est romancé, mais l’aspect scientifique et historique, c’est encore le plus intéressant du film. Arrivera-t-on un jour à faire un film à Hollywood sans enjeux amoureux et sans batailles montrées dans tous ses détails ?
Achik Kerib, Sergueï Paradjanov, David Abachidze (1988)
Bel exemple d’usage de procédés de distanciation : suite de tableaux presque muets illustrant une seule idée sans souci de réalisme, les acteurs bougent à peine les lèvres, et le texte est postsynchronisé à la manière soviétique, mais dans un esprit plus formel. Les séquences extérieures semblent avoir été tournées dans la vieille ville de Bakou, sur le Pont Rouge à la frontière entre la Géorgie et l’Azerbaïdjan, et à Tbilissi. Tout le film est bercé par une jolie musique indo-pop avec des variantes iraniennes, voire slave (en plus de l’Ave Maria de Schubert, j’ai cru reconnaître un standard russe). Ça m’a l’air plus fauché que La Couleur de la grenade, mais l’histoire, façon vieille légende, meuble plutôt bien l’attention.
Page :
Fin de ma longue liste commentée sur les meilleurs films avec des femmes indépendantes ou célibataires.
First Contact, Robin Anderson et Bob Connolly (1982)
L’une des plus anciennes histoires de l’humanité racontée à travers l’une de ses dernières occurrences : la rencontre entre deux peuples qui ignoraient chacune jusqu’alors l’existence de l’autre. Ce qui valait sans doute pour les différentes espèces hominines il y a plusieurs millions d’années vaut pour les « Européens » entrant en contact avec des populations papoues de la première moitié du vingtième siècle : méprise sur la nature des étrangers, incommunicabilité, exploitation des ressources et des bras (manière « civilisée » de parler d’esclavagisme), bouleversement des usages, fin des préjugés et des premières méprises, exploitation sexuelle, etc. Les humains n’ont probablement jamais changé, et désormais à court d’exemples pour raconter cette légende vieille comme le monde, l’humanité s’amuse à le faire avec des extraterrestres. La morale en sera toujours identique.
On y retrouve des éléments de Cannibal Tours, et de Angels of War (tourné la même année), et pour cause, Dennis O’Rourke y assure ici la photographie (comme sur Angels of War). Ces films partagent le même sujet traité sous différents angles, ou plutôt, à différents stades de leur développement (ou de leur exploitation).
Jolie musique éthérée à la Aguirre au synthétiseur sur des images de collines du centre verdoyant de l’île.
Ironie « civilisationnelle » : les vieillards australiens ont un accent tellement prononcé et une prononciation si typique de leur âge avancé (et ma compréhension de la primitive anglaise ayant ses limites) que j’ai souvent mieux compris la parole papoue sous-titrée que la leur.
novembre 2024
Annonces matrimoniales, Antonio Pietrangeli (1963)
Petite satire gentillette, ni trop drôle, ni trop méchante. L’occasion de voir surtout que les usages et les attentes des célibataires passant à travers un dispositif, quel qu’il soit, pour trouver l’amour, tout ça n’a pas beaucoup évolué. La satire est même légèrement inutilement méchante en se moquant ainsi des défauts et du ridicule de toutes ces personnes. L’homme est certes particulièrement odieux, mais elle n’a que de petits défauts facilement négociables (je vais lui envoyer ma photographie). C’est une idiote à la Judy Holiday, plus fraîche, solaire, que réellement bêta. Peut-être que Sandra Milo est justement trop belle et trop intelligente pour le rôle, sans quoi tout le reste paraîtrait insurmontable (en quoi posséder une tortue devrait-il être un problème ?). Le personnage de François Périer, en revanche, entre les messes basses, les arrière-pensées, les coups en douce… On avait déjà notre dose, et les scénaristes en rajoutent une couche en en faisant un alcoolique. Pas vraiment le sujet d’une satire à mon sens. On ne se moque pas des petites personnes, même si sur la forme, on n’en est pas aux excès de la décennie suivante. En revanche, si l’homme était aussi solaire, voire lunaire, que la femme, tout en ne s’entendant pas, cela aurait pu être un joli film à la fois triste et drôle. (C’était le cas d’ailleurs des Émotifs anonymes, dans mon souvenir.)
Pacifiction, Albert Serra (2022)
Comme l’impression d’assister à un naufrage consternant comme je pensais seule Claire Denis capable de nous en proposer. Intrigue vaporeuse + déficience dans la capacité à créer des ambiances ou une dramaturgie offrant au spectateur matière à éveiller une certaine fascination = ennui et incompréhension.
Placez Jean Dujardin dans une longue pub Chanel pour vendre des shampoings au numéro 5 en récitant Mère courage de Brecht entrecoupée de séquences en boîte de nuit avec les petits enfants de Fassbinder et de Jean Genet que ça n’aurait pas beaucoup plus de sens et éveillerait autant les hourras de la critique toujours habile à interpréter tels des psychanalysticiens les tripes de quelques cinéastes sans pudeur disant se les mettre à l’air.
Magimel alterne le bon et le moins bon (sans doute conditionné aux libertés qu’il se permettait avec le texte que manifestement Serra lui soufflait à l’oreille – excellente technique qui vaut bien les techniques de Lelouch) : un tempérament que je peux pas piffer, il faut lui reconnaître un sacré talent. C’est peut-être le seul intérêt au film avec la présence de Pahoa Mahagafanau qui assiste au même film que nous en avant-première et qui semble bien exprimer à chaque plan où elle apparaît le sentiment du spectateur : « mais qu’est-ce que je fais là ? ».
Sans filtre, Ruben Östlund (2022)
L’art difficile de la satire. Je comprends que le style du Suédois irrite toujours autant, mais il y a une forme de constance misanthropique qui jusqu’à présent ne m’a jamais trop dérangé. La scène de la tempête n’a certes rien de subtil, mais la satire, quand elle vise le grotesque, n’a pas forcément à être subtile. Sinon, ce serait comme reprocher à Chaplin de tirer vers la caricature quand elle réalise Le Dictateur. On frôle certes un moment les outrances d’un Next Floor, de Villeneuve. Mais ce qui manquait au court métrage, c’était justement l’humour et la longueur. Une fois passés sur l’île, on passe à une nouvelle étape de la satire avec un retournement attendu et presque aussi cathartique. Le début est féroce et aide sans doute à lancer le film. Manque peut-être sur l’île la présence d’une personne de la classe moyenne, un employé de pont, pas la cheffe des employés justement. Un détail. Les satires sont rares alors que le monde ne s’est jamais porté aussi mal. Östlund a au moins le mérite de combler ce manque.
The Dead Zone, l’adaptation et le roman (Stephen King, Jeffrey Boam, David Cronenberg)
commentaire croisé :
Le Coup de l’escalier, Robert Wise (1959)
commentaire :
Juillet, Darezhan Omirbayev (1988)
Court métrage tout à fait charmant. Un cinéma de l’enfance dans des territoires exotiques, le combo souvent gagnant. En peu de minutes, Omirbayev suggère pas mal d’idées : la fuite vers le cinéma pendant la sieste au moment où le frigo se met en marche pour ne pas réveiller la mère, la séance pour voir un film indien et frôler le bras de sa voisine, aller voler deux melons pour pouvoir les vendre et espérer ainsi retourner au cinéma (et conclure ?), la femme enceinte qui sort puiser par deux fois de l’eau et qui revient toujours bredouille, le rêve qui s’inspire d’éléments du réel, et enfin, l’acheteur des melons qui se retrouve enfermé dans sa cabine de train où il était parti chercher l’argent (les gosses penseront sans doute qu’ils se sont fait flouer et que ce n’est que justice). Simple, efficace.
La Renarde, Michael Powell, Emeric Pressburger (1950)
Affreusement pénible à voir. Tout le contraire du film précédent. Si l’on pardonne au Canterbury Tale ses défauts, c’est que le sujet et les personnages valaient le détour. Dans La Renarde, pas un personnage n’est à sauver. Il ne suffit pas d’être une femme pour proposer des histoires mettant en scène des personnages en quête d’indépendance et capables de casser les archétypes propres à la perpétuation d’une double domination : celle des hommes sur les femmes, et celles des puissants sur les pauvres. Hazel est une sorte de Carmen sans panache, la stéréotype de la femme sauvage qui s’éprendra d’un con. Hazel est forcément jolie, et les deux hommes qui la convoitent sont forcément deux notables des environs (ce qui fera bien rire le père, lui-même archétype du veuf pauvre n’ayant strictement rien à foutre de sa fille unique ; il est sans doute l’idiot du village du film précédent qui se serait égaré dans le suivant…) prétendre s’être épris de la donzelle au premier coup d’œil. Les incohérences dans le Canterbury Tale, on les pardonne. Ici, non, parce qu’au lieu de servir une singularité, ce n’est que pour appuyer des archétypes pitoyables : deux hommes riches tombant amoureux au même moment de la même femme pauvre. Et comme la femme en question est sauvage, elle promettra le mariage au premier (le sage, et le sage dans une histoire à la con est tenu par un homme d’Église) tout en se donnant au second (c’est que celui-ci a tous les attributs du mâle toxique, violent et manipulateur, donc tu comprends, c’est super sexy). Rarement vu un truc aussi rétrograde au cinéma. Hazel aurait des couilles, une vraie Carmen, ou une Scarlett, elle serait maîtresse de son destin, assumerait ses bêtises et agirait comme une adulte. Tout le contraire ici : il suffit de lui dire qu’on l’aime pour la convaincre de nous suivre, elle lance des promesses à la con (se marier avec le premier homme qui lui demanderait sa main… mais what ?), elle se fait baptiser par son homme parce que pourquoi pas, un autre homme vient la tirer de son foyer, et là comme ça, ça lui vient tout d’un coup, elle se rend compte qu’elle aime ce type qui vient toquer à sa porte. Et quand le mari vient finalement toquer à l’autre porte (celle de l’amant), alors que la donzelle s’amuse à courir dans les champs en robe de soirée et à moquer le domestique qui lui avait évité un viol (sympa la reconnaissance) elle sort un « oh ciel, mon mari… OK, bah finalement, je retourne à la maison ». Parce que pourquoi pas. Qui peut apprécier un personnage avec si peu de caractère ?…
A Canterbury Tale, Michael Powell, Emeric Pressburger (1944)
Un peu barré comme film. Jouer la carte de la singularité, ça passe ou ça casse. Et comme tout est charmant dans le film, il n’y a pas à beaucoup se forcer pour accepter les étrangetés scénaristiques de cet objet non identifié. Il y a pourtant de quoi être un peu perdu entre les fausses pistes, l’enquête improbable menée par une travailleuse agricole, un soldat américain et un autre, anglais, semblant à peine superviser les deux autres pour venir à bout d’un malotru se permettant de foutre de la colle dans les cheveux à la première femme venue ne respectant pas le couvre-feu particulièrement imposé aux femmes dans la ville. Surtout, ne pas faire du juge ayant édicté cette loi ridicule le premier suspect… On se fout pas mal des incohérences, d’ailleurs, on se fout pas mal de l’histoire. Et paradoxalement, on peut même dire que ce sont toutes ces étrangetés offrant au récit ces situations bizarres (sans la moindre note fantastique ou onirique pourtant) qui donnent au film sa tonalité si singulière. Dans une structure narrative hollywoodienne, tout aurait un but, tous les fils du récit mèneraient à une même logique qui se conclurait au dénouement. Ici, c’est presque même le contraire : on s’attend d’abord à suivre une histoire de rencontre amoureuse des plus banales, alors que la relation entre les deux protagonistes se contentera d’être platonique. Il y aurait même un côté presque naïf, comme dans un film pour enfant, à ne jamais évoquer la possibilité (même entre eux) d’une relation. On y songe peut-être un moment quand le soldat demande la couleur des cheveux de la travailleuse agricole, mais l’étrangeté du film, c’est bien qu’on lance cette piste et n’y revient plus du tout par la suite (la faiblesse narrative devient donc une qualité). Étrangement donc, une fois que l’enquête a été résolue, tout ce petit monde se rend à la cathédrale et chacun vient un peu y trouver ce qu’il attendait et n’espérait plus (c’est le sens de la procession qui avait lieu quatre siècles plus tôt, et connaissant un peu les deux bonhommes à la manœuvre, c’était sans doute le point saillant de leur histoire et le reste n’était que prétexte – un prétexte pour le moins loufoque).
Elvira Madigan, Bo Widerberg (1967)
commentaire :
octobre 2024
Un flic sur le toit, Bo Widerberg (1976)
Une bonne moitié du film bien ennuyeuse à suivre l’enquête d’une brigade de la criminelle pour retrouver l’assassin d’un flic véreux. La seconde partie prend alors un tournant à quatre-vingt-dix degrés : l’enquête s’achève, car le tueur réfugié sur un toit tire sur tous les policiers. Les tueurs de masse sont à la mode (on y retrouve le même rapport à la violence que dans La Cible par exemple). Le film s’anime, avec une réalisation très british (du type de celles qui ont inspiré la révolution des polars aux États-Unis en passant par Peter Yates – j’avais évoqué ça dans mon article sur l’évolution des transparences dans le cinéma américain) faite de grands-angles, de zooms et de mouvements rapides de caméra. Plus étonnant encore, l’humour (qui perçait déjà dans le film avant ça et qui aidait à ce que l’on ne pique pas totalement du nez) s’immisce dans des situations tragiques pas habituées à être ainsi tournées en ridicule. À noter une séquence spectaculaire qui évoque peut-être le landau des escaliers d’Odessa dans Le Cuirassier Potemkine : filmée avec des optiques grand-angles, la caméra suit à hauteur d’enfant le tricycle d’un gamin qui s’approche de la scène où le tireur a déjà tué deux policiers. L’idée aura peut-être inspiré Kubrick qui en fera ce que font tous les génies quand ils volent les idées des autres : quelque chose de bien meilleur encore.
Alfredo, Alfredo, Pietro Germi (1972)
Gentil dynamitage du mariage. La comédie italienne semble déjà avoir écumé tous les sujets. L’essoufflement se laisse ressentir, dans l’approche, surtout ; parce qu’en détail, c’est finement écrit. L’approche, si je reste dans la logique de mon précédent article sur l’humour ascensionnel, la satire (si c’en est une) égratigne l’institution du mariage, mais finalement assez peu la société. Voir un simple employé de banque séduire deux femmes magnifiques, cela relève beaucoup plus du fantasme que d’une réalité sociologique (on retrouve un des défauts des premiers films de Germi). Dustin Hoffman reprend en quelque sorte son rôle du Lauréat et ouvre la voie à ce qui sera l’emploi de Woody Allen, mais l’astuce justement chez le New-Yorkais, c’était que ses personnages étaient à trouver plutôt du côté des intellectuels que des employés lambda. Hoffman avec Polanski et Allen avait popularisé la « sexualisation » (si l’on peut dire ça comme ça) des petits laids au cinéma. Mais « employé de banque », non.
En revanche, la description de la femme excessive, possessive, qui se plaint de ne pas avoir assez d’attention, versatile, vise juste… Le tout, sans jamais rendre ces femmes méprisables. Un exploit. On sent toutefois la ligne de crête toute proche.
Meurtre à l’italienne, Pietro Germi (1959)
commentaire :
Cockfighter, Monte Hellman (1974)
J’avoue mon incompréhension. La quête absurde après quoi court le bonhomme (une médaille), je peux comprendre les quêtes de l’inutile, mais pour un sport aussi futile et vulgaire, je peine à suivre. Je pense avoir eu la même réaction (en plus mesuré) de la copine à la fin quand elle se présente pour la première fois pour suivre un combat. S’il y avait un film susceptible de contenter mon petit plaisir, il était là, dans la confrontation avec les demoiselles du film (qui ne font ici que de la figuration). Désolé, mais j’ai besoin de voir des poules dans un film, les concours entre couilles, très peu pour moi. (Et c’est sans parler la production bien laide de Corman et le jeu insipide de tous les interprètes. De toute évidence, Hellman n’est pas un directeur d’acteurs. Quand il tombe sur des génies, il participe, malgré lui, au Nouvel Hollywood. Quand il dirige sa copine, trois péquenauds ou qu’il demande au meilleur d’entre eux de jouer les muets, je ne connais pas meilleur moyen de se tirer une balle dans le pied. La copine du Sud joue d’ailleurs tout à fait atrocement.)
Gelosia/Jalousie, Pietro Germi (1953)
Un sommet du mélodrame. Une bonne vieille tragédie comme on en fait plus avec un amour impossible entre un aristo et une fille de rien qu’il prend rapidement comme servante, puis l’idée farfelue de la faire épouser par un domestique que l’aristo tuera par jalousie. Voilà le point de départ. Le développement revient aux origines de la relation à la manière d’un film noir et d’un long flashback, avant de revenir au présent et de jouer sur la culpabilité. Maîtrise absolue de Germi à la mise en scène : pas un regard de trop, les gestes qu’il faut, une partition d’une rigueur totale. On sent largement l’influence américaine. C’est du mélodrame à la sauce hollywoodienne, voire à la mexicaine. Entre western et drame romantique d’époque qu’affectionnaient les grands studios dans les années 30 et 40. À certains moments (le décrochage du christ), l’utilisation de la musique donnait même l’impression de revoir certaines séquences du Dracula de Coppola (notamment au début). Germi aura touché finalement à tous les genres, et chaque fois avec une même réussite.
Le Témoin, Pietro Germi (1946)
La Tanière des brigands, Pietro Germi (1952)
Scénario un peu trop aride : de la poussière, de la rocaille, de la poudre à fusil, ça manque un peu d’huile et de sang tout ça. La direction d’acteurs est irréprochable, comme d’habitude, devrais-je dire. Amedeo Nazzari, avec ses faux airs d’Errol Flynn est dans la continuité des rôles principaux masculins de Germi que j’ai pu voir ces derniers jours : il n’y a absolument rien qui dépasse. Carré, droit au but, l’œil qui flanche quand il faut pour laisser voir qu’il réfléchit et repartir aussitôt.
Bien qu’adapté d’un roman italien, on y retrouve quelques notes de Men in War. Malheureusement, pas les meilleures. Compliqué de se passionner pour une telle quête aux enjeux assez flous pour qui ne maîtrise pas l’histoire italienne (poursuite de brigands du Sud).
Tout semble en place pour que le pays lance ses propres westerns. Mais si l’on s’ennuie tellement, en revanche, et paradoxalement, c’est un peu parce que l’exposition est ratée et qu’il aurait bien fallu allonger le film de quelques minutes pour développer le personnage principal, voire celui de son futur allié et subalterne. Germi sait probablement rendre humains ses personnages à travers sa mise en scène, mais son adaptation paraît bien manquer le coche dans l’introduction pour lancer une forme d’identification. Il rentre trop vite dans le vif du sujet, et c’est sans doute ça qui donne au film cet aspect extraordinairement sec et sans vie.
Jeunesse perdue (1948) et Traqués dans la ville (1951), Pietro Germi
Deux films noirs d’assez bonne facture. Comme d’habitude avec Germi, si l’histoire est au point, la plus-value est clairement du côté de la direction d’acteurs. J’ai tendance à dire que quand l’ensemble de la distribution joue parfaitement sa partition, c’est que le maître d’œuvre est un bijou de directeur d’acteurs. Une habitude, là encore, quand c’est un acteur à la manette. Et si ce n’était que pour servir platement des histoires, cela n’aurait pas grand intérêt. Comme dans les autres films, savoir diriger des acteurs permet à Germi d’insuffler une bonne dose d’humanité à ses histoires.
C’est d’autant plus marqué dans Traqués dans la ville où l’intrigue prend à revers les impératifs du code Hays auquel bien sûr Germi et ses potes à l’écriture (que des pointures) ne sont pas contraints. Dans un film noir américain, les braqueurs auraient été invariablement montrés de manière négative. Tout le contraire ici. On sent la claire intention de se pencher sur des destins fragiles, des criminels poussés par la misère plus que pour l’appétit du gain. Chez leurs cousins américains, ces personnages auraient été des psychopathes. Ici, ils sont vite, pour la plupart, rongés par la culpabilité. Germi prend ainsi exagérément son temps pour faire peser sur eux tout le poids des conséquences tragiques qui ne manqueront pas de s’abattre sur eux. Dans cette manière de ralentir ostensiblement le rythme, on serait presque déjà dans du Visconti. Dernière possibilité : sauver le plus fréquentable des braqueurs. Ne pas le tuer sommairement ou symboliquement, mais le laisser beaucoup plus sagement entre les bras de la justice des hommes.
Jeunesse perdue dévoile une intrigue plus classique, mais on y voit un peu la même intention que dans Les Vaincus d’Antonioni de socialiser la criminalité dans ces années d’après-guerre en indiquant qu’elle peut tout aussi bien provenir des classes aisées. On sent que Germi dirige son acteur franco-lituanien sans lui laisser le moindre espace de liberté : pour être crédible, le malfrat doit être d’un stoïcisme à toute épreuve. Les deux hommes ont effectué un travail exceptionnel sur ce personnage. Sernas en arriverait presque à éclipser le toujours excellent Massimo Girotti.
La Zone d’intérêt, Jonathan Glazer (2023)
Passé les premières minutes de découverte du dispositif et de la proposition tenant en deux phrases, l’exercice de style se révèle vite être une impasse. Faute de matière pour illustrer un projet stérile, Glazer tourne en rond. Les dernières minutes tentent de s’extirper de cette impasse en prenant un peu de distance géographique et temporelle, mais sauf à vouloir forcer une explication à ce tournant sans intérêt, on achève le film avec une jolie moue dubitative. La mise à distance produit toujours un effet bénéfique aux choses qu’on cherche ainsi à montrer autrement ; mais quand on érige cette distance en système et qu’aucune matière (qu’elle soit dramatique ou non d’ailleurs, la chronique n’ayant pas forcément à développer des axes thématiques ou dramatiques, elle ne peut être qu’illustrative) n’est propre à être montrée, cette distance ne servira qu’à mettre un peu plus en lumière ce grand vide. Dans Under the Skin, j’avais, perso, été séduit par le croisement des genres et par l’étrangeté de la proposition de départ, elle aussi basée, en grande partie, sur une mise en scène particulièrement distante. Ici, on en est réduit à guetter le moindre élément sordide et familier en arrière-plan venant contenter une curiosité déplacée qui aurait pu tout aussi bien être appliquée à une séquence dans laquelle un téton pointe le bout de son nez… La distance n’interdit pas le voyeurisme. Proposition intéressante, peut-être une des « moins pires » en ce qui concerne une des pires horreurs du siècle précédent, mais résultat en deçà des attentes. Parfois, l’art, c’est un peu comme la science. Il faut bien que quelqu’un avance des propositions et les expérimente pour que l’on voie collectivement si elles fonctionnent ou non. Maintenant, on sait.
Mademoiselle la présidente, Pietro Germi (1952)
Je n’attendais pas vraiment Germi dans le registre du vaudeville. Exercice le plus compliqué qui soit, surtout pour un étranger. Les exemples d’adaptations ratées ne manquent pas, et il y aurait tout un pan du cinéma français des années 30 qui serait à explorer : les adaptations des grands succès du vaudeville ou du théâtre de boulevard. Fanfare d’amour, Mademoiselle ma mère, Le Veau gras, Arlette et ses papas, L’Hôtel du libre-échange, et Enlevez-moi, semblent correspondre à des adaptations réussies, si j’en crois mes notes… Parce que le vaudeville, c’est une mécanique, et c’est une tonalité très spécifique, avec des lazzi qui ne sont pas forcément ceux du théâtre italien (d’autant plus que le cinéaste ne semble pas être issu de ce milieu). Aucune idée où Germi aurait pu piocher tout ça, mais il maîtrise manifestement tous ces codes.
Mademoiselle la présidente est un vaudeville des années 10, déjà adapté avec la Popesco en 1938. Connaissant mon amour modéré pour l’actrice roumaine, mieux vaut se garder de le voir. C’est que Gobette est censée séduire toute la haute magistrature française, difficile de concevoir un tel personnage avec la Popesco.
Les quiproquos s’enchaînent et toute la mécanique s’agence délicieusement. Les acteurs sont parfaits. Et le message politique serait presque encore d’actualité : comme souvent dans les vaudevilles, ce sont les filles en petite tenue (actrices de music-hall) qui tournent en bourrique les bourgeois, présentés comme de vulgaires arrivistes quémandant d’une manière ou d’une autre des postes dans la haute fonction publique en jouant du réseau ou d’entourloupes coquines. En prime ici, le leitmotiv du fonctionnaire maltraité par le ministre, obligé par huit fois de modifier un décret, et le serviteur mesquin décidé à pourrir la vie du ministre. L’époque avait quelque chose de bien plus révolutionnaire que la nôtre…
L’Homme de paille, Pietro Germi (1958)
commentaire :
My Dinner with Andre, Louis Malle (1981)
commentaire :
L’Inondation, Louis Delluc (1924)
commentaire :
Le vent nous emportera, Abbas Kiarostami (1999)
Jeu de piste absurde dont la finalité m’échappe. L’explicite peut parfois vous mener en prison en Iran, mais quand tout devient brumeux, c’est à se demander si l’on ne prend pas le risque d’être compris de travers. Quelques allusions à la condition de la femme, au temps qui passe et à la beauté de la nature, mais guère plus. Pourquoi attendent-ils si longtemps la mort de la vieille ? Pourquoi ce puits dans le cimetière ? Quelle signification derrière cette scène étrange avec l’adolescente tirant le lait pour l’ingénieur ? Opposition éventuelle entre le rapport aux choses, au temps et à la mort depuis la capitale, et celui à la campagne.
Chez Kiarostami, comme d’habitude, quelques sophistications scénaristiques servent d’amuse-gueule aux spectateurs égarés : le comique de répétition (appel sur la colline, rencontres avec le gamin qui court cinquante écoles à la fois – au contraire des adolescentes, donc) et l’invisibilité de certains personnages qui demeurent hors-champ tout au long du film.
Page :
Fin de ma longue liste sur l’histoire des transparences dans le cinéma américain.
Carnet de notes pour une Orestie africaine, Pier Paolo Pasolini (1970)
Pasolini rend en images ce qui très généralement n’est jamais rendu public : les notes d’intention d’un film. Au-delà de l’exercice de transparence qui pourrait s’assimiler à une forme archaïque et chaotique de making of, ces notes d’intentions filmées révèlent surtout tout le malentendu qui flotte comme un brouillard que personne ne veut voir entre les auteurs et ceux qui sont amenés à commenter leur travail. Ce film existerait, chacun y irait de son interprétation parce que de ces intentions premières, il n’en resterait plus grand-chose dans le film. Les notes ont au moins le mérite d’être claires : désireux de s’aventurer dans une quête un peu vaine d’émancipation à la modernité, le cinéaste italien s’essaie à un rapprochement hasardeux entre le monde de la Grèce antique et le monde africain, y voyant, forcément, une même forme d’authenticité encore préservée du capitalisme. Mais presque intuitif, ce rapprochement révèle surtout les maladresses de l’étranger venant dans un pays avec ses préjugés et cherchant à les consolider en les mettant à l’épreuve des habitants. Le résultat, pour un œil contemporain habitué à se méfier de ces facilités culturelles, ressemble plus au comportement d’un amant éconduit venant chercher chez d’autres femmes choisies pour leur vague ressemblance avec cette ancienne conquête perdue en leur expliquant comment se comporter pour se conformer à l’image de son fantôme. Voir de la Grèce antique partout en Afrique, c’est le meilleur moyen d’invisibiliser l’Afrique, ne pas la voir, lui refuser le droit d’exister. La rencontre organisée par le cinéaste avec quelques étudiants parlant sa langue illustre cette déconnexion entre les attentes d’un homme bercé d’illusions antiques et une population semblant agiter leurs mains devant ses yeux pour lui faire comprendre qu’il divague et qu’il serait temps qu’il les regarde enfin. Une Orestie africaine ? Et pourquoi pas un récit authentiquement africain ?
Quelques années auparavant, Pasolini avait réalisé son chef-d’œuvre : L’Évangile selon saint Matthieu. Si le rapprochement de la vie du Christ dans le sud de l’Italie avait un sens, c’est que depuis deux mille ans, l’Europe nourrit sa population d’une appropriation du récit et de l’imaginaire chrétien.
Rematch, série Arte (2024)
Une série coproduite par Arte, Disney+ et l’Union européenne, filmée dans la Hongrie de l’inconditionnel de la construction européenne Viktor Orbán, je ne l’avais pas vu venir…
Peut-être intrigué par une nouvelle série dédiée aux échecs après la réussite du Jeu de la dame, je me suis lancé en dilettante. Et ce n’est pas si mal du tout. Étant vieux, j’ai pu assister dans les médias d’alors (pas d’Internet pour moi, comme pour pas grand monde en 94) au match entre Gasparov et Deep Blue. Et si cette confrontation avait pu se faire, c’est surtout parce que le champion des échecs jouissait d’une renommée dont on peine à imaginer aujourd’hui. Dans ma cour d’école dans les années 80, on parlait de ses matchs légendaires avec Karpov. Il est probable que la télévision évoquait ces rencontres régulièrement dans ses programmes. Tout ce qui passait dans le petit écran était alors vu par des dizaines de millions de personnes. De quoi forger tout un imaginaire commun. Karpov/Kasparov, c’était à l’époque dans mon esprit aussi connu que Marilyn, Alien, Michael Chang, Bruce Lee, ou la Joconde.
Les échecs font partie de ces jeux dont personne ou presque ne comprend les règles ou les subtilités, mais tout l’univers lexical riche et varié permet dans une histoire les envolées presque lyriques et surréalistes. On en rit même dans la série, un des joueurs inventant le nom d’une ouverture pour troller la directrice IBM (son collègue, concepteur de la machine, trollera de la même manière le grand patron en lui envoyant à la figure tout un jargon pour expliquer le coup de chaud de Deep Blue). Les références fusent également pas mal avec la satisfaction d’évoquer pour le spectateur des outils du domaine informatique devenus communs pour lui (même si l’on peut douter du respect de la vérité historique).
Rien de bien original dans le traitement de cette histoire connue. Mais elle était à raconter. Un regret malgré tout : la relative fadeur de l’acteur principal. Le charisme de Kasparov est assez mal rendu.
On peut espérer un joli succès à la série, développée selon toutes vraisemblances pour percer à l’international.
septembre 2024
La Femme du dimanche, Luigi Comencini (1975)
La satire de la société italienne est tout à fait savoureuse. Tout le monde en prend pour son grade : les aristos qui méprisent leurs domestiques, les domestiques qui se ruent à la police pour dénoncer leurs employeurs, la police qui ne trouverait pas la lune dans le ciel, les bureaucrates voyeuristes, les « boomers » obscènes, le flic désinvolte qui laisse les suspects faire les questions et les réponses, les artisans grossiers, les homosexuels entretenus qui cherchent à prouver leur valeur, les vieilles filles riches, grasses et nunuches, les prostituées avec la langue bien pendue… Ça pique beaucoup et c’est plutôt bien vu. En revanche, le mélange des genres avec le thriller qui s’invite tout à coup à la fête, et même l’intrigue très agathachristique, pour reprendre une interjection idiote d’un vendeur de disques aux puces : « Boh ! ».
The King of Marvin Gardens, Bob Rafelson (1972)
Après Cinq Pièces Faciles, Rafelson remet le couvert avec les mêmes ou presque pour une nouvelle histoire d’un paumé allant retrouver sa famille, en l’occurrence son frère, à Atlantic City. La réussite n’est en revanche pas vraiment au rendez-vous. Là où dans le précédent film, l’inaction du personnage principal pouvait se comprendre par la situation, ici, on a du mal à comprendre comment un personnage pourrait rester ainsi auprès d’un crétin de frère alors que rien ne le retient. Dans Cinq Pièces Faciles, la peinture familiale bourgeoise et cultivée avait un intérêt. Ici, j’avoue rester dubitatif face aux trois personnages auxquels rend visite cet auteur de radio nocturne. L’environnement n’est pas beaucoup plus stimulant : la ville est déprimante. Et l’angle mafieux fait surtout encore plus passer le frangin pour un indésirable. Seul atout du film : le talent d’Ellen Burstyn. Dans un personnage pourtant lui aussi pas cadeau, elle arrive à en tirer le meilleur, grâce à sa sensibilité, son intelligence et son imagination. On voit rarement une actrice être aussi impliquée dans une situation, montrer à voir une infinité de variétés dans son interprétation (tout en ruptures douces, naturelles et spontanées) et proposer des tonalités dans son personnage laissant à voir un caractère à la fois tourmenté et complexe alors que le scénario ne semble pas bien dire grand-chose.
A Bill of Divorcement, George Cukor (1932)
commentaire :
Civil War, Alex Garland (2024)
commentaire :
Zaza, George Cukor (1938)
Intrigue romantique plus que limitée et qui joue sur des archétypes de relations extraconjugales à la française. Pas sûr qu’un tel sujet convienne à Cukor qu’on verrait plus adapté à un Ophüls et bien trop centré sur son personnage féminin. La fadeur de l’acteur interprétant le mari n’aide pas beaucoup les choses, mais rien n’est fait pour opposer à Claudette Colbert une figure masculine qui vaille au moins la peine. Il y a une constante dans les histoires : un personnage passif n’a aucune chance de se faire respecter et aimer du public.
L’intérêt viendrait plutôt se cacher dans quelques détails : les numéros d’actrice de la mère alcoolique (parfois pénible, mais joli tour de force) et de la toute jeune gamine donnant la réplique à la star et qui est époustouflante de justesse. Les décors sont également une grande réussite : si l’on peut regretter l’absence de plans extérieurs pour contextualiser les événements, les intérieurs parisiens étonnent par leur authenticité. L’actrice, qui ne manque pas de faire les deux bises à tout le monde, était peut-être là pour veiller au grain.
Car sauvage est le vent, George Cukor (1957)
Le film obéit tellement peu aux standards qu’il nous laisse très vite sur le bas-côté. J’ai dit il n’y a pas si longtemps que j’appréciais les films hybrides, je suis servi. Problème, les hybridations ont cela en commun avec les générations spontanées d’être rares. Il ne suffit pas de glisser en douce un ananas dans une pizza pour en faire une réussite. Et le plus étonnant, c’est que j’ai beau chercher, le film comporte assez peu d’impairs. Mise en scène parfaite, même si on n’image pas Cukor dans un registre naturaliste (le western non plus, et il faut croire qu’il y prendra goût, comme aux actrices italiennes, parce qu’il réalisera trois ans plus tard le tout aussi étrange et singulier, voire raté, La Diablesse en collant rose). Les acteurs ne sont pas mauvais. L’alchimie ne prend juste jamais. Pris séparément, tous les éléments du film n’ont en plus pas réellement de grand point d’intérêt : la carrière d’Anthony Quinn étonne par son éclectisme, mais à la fois les personnages interprétés (des gens simples, pour ne pas dire parfois bêtes, bêtes, comme « étranger », à une époque où la mondialisation n’a pas encore permis à chacun de prendre la mesure de l’altérité humaine) et sa présence massive, virile, ne m’ont jamais réellement bien séduit (à l’exception de Barrabas, allez). Le sujet, surtout, me parait loin d’être une matière idéale pour une adaptation à l’écran. L’argument est tellement singulier, inattendu, presque en dehors des sentiers battus qu’une étrange impression de malaise et d’incrédulité ne nous quitte pas tout au long du film. Certaines histoires vraies auront beau être parfaitement ancrées dans le réel, si ça ne répond pas à une certaine préconception du monde que l’on se fait, on peinera toujours à y croire. C’est l’histoire du Noir affranchi et du Suédois ne parlant pas un mot d’anglais apparaissant soudain dans une scène de western : on y voit quelque chose de forcément improbable alors que ces rencontres étaient la norme au Far West.
La Diablesse en collant rose, George Cukor (1960)
Nouvelle histoire sur des saltimbanques pour Georgie, cette fois, dans un contexte de western. Le moins qu’on puisse dire, c’est que rien ne marche. L’histoire tient la route, certains effets suggérés dans les dialogues ne semblent pas si mauvais, mais c’est comme si Cukor et ses acteurs ne parvenaient jamais à trouver le bon rythme et la bonne tonalité. Il y a un souci quand on mêle ainsi divers genres, surtout des genres très codifiés, et plus encore quand la comédie côtoie le plus grave. Eh bien, ça finit par ne plus ressembler à rien. C’est une bonne manière parfois pour révolution un genre ; ironiquement, on voit là pour la première fois une passerelle entre western américain et italien (produit par Carlo Ponti pour la Paramount) ; c’est aussi le meilleur moyen de se planter, tant parce que sur le plateau personne ne sait où donner de la tête, que dans la salle où trop de codes explosés désarçonnent.
Je n’ai pas forcément souvenir que les grands films de Cukor, les comédies surtout, possèdent un rythme frénétique. En dehors de Comment l’esprit vient aux femmes (et encore, j’ai peut-être un souvenir tronqué du film), je ne me rappelle pas de grandes comédies loufoques et endiablées. Cukor a-t-il seulement réalisé une screwball ? Je n’en ai pas l’impression. Remarquable directeur d’acteurs, c’est évident, on le voit à la précision de la mise en place des acteurs, dans chacun de leur geste. Mais question rythme et à-propos, ce n’est pas son registre. Il était probablement meilleur à diriger de grands acteurs en insistant sur le point fort des grands acteurs : leur capacité à comprendre une situation et à être sincère dans ce qu’ils font. C’est bien pourquoi ses comédies sont des comédies bourgeoises : c’est la situation qui amuse et quelques bons dialogues. Or, il y aurait presque parfois un côté très enlevé dans La Diablesse en collant rose ; le rythme devrait s’appuyer sur un enchaînement rapide des actions, les personnages seraient animés par un sentiment d’urgence et ne seraient pas étrangers aux outrances absurdes et loufoques. Je veux bien croire Sophia Loren capable de cette folie ou de cette fantaisie (elle l’a démontré par exemple chez Risi) ; Anthony Quinn, un peu moins. Personne ne semble donc jamais s’accorder. Il n’y a guère que les seconds rôles qui tiennent la baraque, notamment le couple savoureux que forment une mère et sa fille dans la troupe. J’ai rarement vu autant d’argent dépensé dans des décors pour un film aussi médiocre, ruiné principalement par ses stars et son metteur en scène.
Un Cukor mineur et, à raison, méconnu.
Je retourne chez maman, George Cukor (1952)
Mélange des genres inopportun et raté pour un chef-d’œuvre du cinéma puritain. Le Hollywood des années 50 n’a aucun souci pour montrer que quand il est question des personnes aisées, un divorce en deviendrait presque quelque chose de sophistiqué, de distingué (« Oh ! J’en suis à mon troisième mari ! ») ; en revanche, quand on s’adresse aux pauvres, attention, on fait la leçon.
Pendant une heure, le film nous décrit ainsi la mésentente profonde d’un couple, on assiste aux disputes sous tous les angles au point que cela en devient pénible ; et à la fin, la juge chargée de prononcer le divorce les prend par la main et leur fait comprendre que ce n’est pas sérieux, ils ne peuvent pas divorcer ! Mais, ta gueule.
Dans le Hollywood de l’après-guerre, quand on montre les classes laborieuses, c’est soit pour en faire des films noirs, soit pour leur faire la morale afin de leur dicter la bonne conduite à suivre. Mais allez vous faire foutre. Le petit peuple aussi a droit à ses petits divorces pour éviter que la situation s’envenime ou parce qu’il a envie de prendre la tangeante. Les raisons ne regardent personne. Qu’est-ce que c’est que ce paternalisme déplacé ?
Le générique fait assez peine à voir. Il illustre la manière grossière avec laquelle les studios lançaient les « stars » à l’époque : on l’associe dans un film mineur à une actrice qui vient de se révéler et qu’on tente de mettre sur le devant de la scène, et à la fin, on dépose, là, l’air de rien, une incrustation avec le placement produit assis sur un lit qui dit en gros : « Vous avez apprécié Aldo Ray ? Nous espérons que vous irez voir ses prochains films. On vous promet une réduction de 20 % sur les dialogues. » Mais, ta gueule. « Tiens, j’ai créé une star de a à z, je la mets là, j’espère que tu l’adopteras. » Et le public : « Tu veux pas en faire un acteur d’abord ? Et puis, moi, j’aime cet acteur, là, c’est lui ma star. » « Oui, non. C’est pas prévu. Mange encore un peu d’Aldo. Il a un contrat longue durée, lui. Donc tu dois l’aimer. C’est une star. » « Oui, mais il est nul. C’est pas une star. » « Si, c’est une star de la Columbia. On le paie très cher. » « Je m’en fous de son salaire. Tu t’es fait niquer. Il est nul. » On est plus subtil aujourd’hui.
Une femme qui s’affiche, George Cukor (1954)
commentaire :
Les Quatre Filles du docteur March (1933) et Édouard, mon fils (1950)
Là encore, une séance après l’autre. Les deux films n’ont rien à voir, mais je me disais que le premier manquait sérieusement de vice avec ces personnages tous modèles de catéchisme, et patatras, le second offre un salaud comme on en a rarement vu au cinéma. Les deux films sont surtout marqués par une excellente distribution et une excellente mise en scène (ça aide l’une quand on s’est facilité la tâche avec l’autre). Si le film de 33 possède donc certains aspects franchement pénibles à vouloir dépeindre des personnages si « parfaits », lui restera toujours la fantaisie et le désordre proposés par Jo. Je travaille actuellement si une liste de films mettant en scène des femmes indépendantes et étrangères à la romance, je suis servi (le film de Greta Gerwig, au contraire de toutes les autres, s’était fait remarquer, dans mon souvenir, dans son refus de montrer Jo revenir dans « le droit chemin » et d’assumer son indépendance jusqu’au bout).
Édouard, mon fils, en revanche, en dehors de ses acteurs donc (et malgré les excès imposés par le scénario), il n’y a pas grand-chose à sauver. Pour pimenter la chose, j’essaie d’imaginer un Edward G. Robinson à la place de Spencer Tracy qui a toujours tendance à arrondir le caractère de ses personnages, même si ce sont des crapules. J’ai du mal à trouver du sens à cette histoire rocambolesque digne d’un mélo des années 20 (façon Sarah and Son, même le titre semble être un hommage…). Un « nouveau riche » (tel que joliment défini en français dans le texte par le directeur de l’école) gâte son gamin jusqu’à l’absurde. Le film présenté en flashback par le père semble vouloir insister sur une morale, mais cela paraît tellement crétin que je préfère ne pas aller au bout de la logique… Certains films vous rendent meilleurs en vous faisant réfléchir, d’autres vous imposent de brider votre intelligence de peur de comprendre où on voudrait vous mener… Film largement méconnu malgré la distribution, parfois, il ne faut pas chercher bien loin. Si le papier cadeau est joli, mais qu’on n’a jamais pris le temps d’ouvrir le paquet, c’est qu’on a déjà une idée de ce qu’il cache. Certains imbéciles persistent à vouloir imaginer qu’un trésor n’est jamais impossible. (Et je continue à le penser.)
Comme le film m’ennuyait, je me suis mis à divaguer : à force de voir les anniversaires fêtés (moyen faussement futé de montrer le temps qui passe), je me suis demandé pourquoi c’était les gosses qu’on honorait et pas les mères. Tous les ans, ils apprennent depuis le plus jeune âge à recevoir des biens matériels dont ils n’ont rien à faire, et ça se perpétue ainsi jusqu’à ce que eux offrent des colliers de nouilles à leur mère pour la fête du même nom. Qui faut-il féliciter pour la naissance d’un gosse ? Le gosse qui n’a rien demandé, qui n’a eu qu’à brayer et qui, l’instant d’après, aura oublié par quoi il est passé ; ou la mère qui a vidé ses tripes pour voir sortir de son ventre un monstre qui lui pourrira la vie ? Je sais pas, les gosses devraient plutôt apprendre à se faire tout petits aux anniversaires… de leur mère. Et celle-ci devrait recevoir une double ration de colliers de nouilles.
Le Premier Champ de bataille d’Europe, David Starkey (2024)
Le retour des bonnes vieilles soirées sur Arte de L’Aventure humaine. Marre des rediffusions ou des documentaires sur les druides. Un documentaire sur une réelle avancée archéologique de ces dernières années sur une période de l’histoire méconnue. L’occasion d’apprendre plein de choses quand on connaît si peu de choses en histoire. Sur l’âge du bronze en Europe, et apprendre que l’on pensait alors que c’était une période relativement paisible en Europe. Mais comme le dit l’adage : l’absence de preuves n’est pas la preuve de l’absence. C’est donc une immense bataille dans la vallée de la Tollense opposant plusieurs centaines de combattants aguerris qui se découvre peu à peu dans la terre tourbeuse. De quoi contrarier les spécialistes qui pensaient que les premières grandes batailles viendraient plus tard et que la région était relativement isolée des premières grandes civilisations de l’époque (Mycènes, surtout). J’ignorais également que cette époque avait d’abord connu une longue prospérité marquée par la preuve des premières grandes routes commerciales avant de disparaître dans ce qui a été appelé l’effondrement de l’âge du bronze récent. Les archéologues pensent donc désormais que le nord de l’Allemagne était alors connecté au sud de l’Europe et que cet effondrement aurait créé des tensions jusque dans cette région éloignée des civilisations méditerranéennes (d’où la bataille). Reste un détail révélé par les fouilles et qui posent de nouvelles questions : il y avait dans cette vallée non pas seulement un simple pont, mais une sorte de chemin en bois. On ne construit pas un tel ouvrage loin de toute civilisation. La région était connectée au sud de l’Europe, d’accord… mais quelle était sa destination (ville ou civilisation) et sa richesse (on pense à l’ambre, mais le documentaire n’évoque rien et peut-être que je me trompe de région et d’époque) pour justifier une telle interconnexion. Cette fin de la préhistoire a sans doute encore beaucoup de trésors en attente d’être explorés.
août 2024
Deux films de George Cukor (The Royal Family of Broadway, 1930 & Girls About Town, 1931)
comparatif et évolution rapide des codes du cinéma parlant :
Albator, corsaire de l’espace (2013)
commentaire :
Le Rêve, Bae Chang-ho (1990)
Film extrêmement brutal. On se conforte comme on peut face à un tel déchaînement de violence, notamment en se convainquant que le titre annonce une fin en forme d’échappatoire attendue et finalement espérée. Parce que plus qu’un rêve, c’est un cauchemar, cette suite ininterrompue de crimes à l’insu de son plein gré, de tragédies en cascade, de violences infligées et subies. On frôle le baroque ou le grand-guignol dans les exagérations, mais une fois qu’on a accepté les excès et la surenchère allant crescendo, on en tolère gentiment le style décalé et onirique (beaucoup d’indices et d’incohérences grossières nous mettent sur la piste). Tous ces raccourcis et ces bascules dramatiques, propres au rêve, laissent également en bouche une jolie saveur de fable ou de conte (avec une morale identique aux films interprétés par Ayako Wakao). Le film repose sur la beauté tragique d’une femme. Il faut dire que l’actrice avait de quoi faire tourner quelques têtes. Songez que les Coréennes comptent parmi les femmes les plus belles du monde ; si parmi elles, vous en choisissez une plus magnifique encore que les autres, il y a des chances que votre histoire tienne la route (au moins sur cet aspect). Hwang Shin-hye, j’écris ton nom.
Le film est disponible sur la chaîne des Archives coréennes sur YouTube avec des sous-titres français (que demande le peuple ?) : lien.
Le peuple demande les preuves du délit.


Incroyable mais vrai, Quentin Dupieux (2021)
Nouvelle idée de court-métrage absurde gonflée en long. Je me répète comme Quentin : une bonne idée, surtout dans l’absurde, il faut qu’elle puisse amorcer une cascade d’événements qui sera le cœur du récit, et surtout, une bonne idée contient, en elle, les prémices de sa conclusion. Dupieux se trouve tellement incapable d’achever son film et de trouver donc une réponse à l’idée absurde proposée qu’il termine son film avec cinq minutes de montage-séquence indigestes qui peinent à trouver un point final.
The Last of Us, série (2023)
Plaisant, sans plus. HBO fait dans le recyclé et s’évite les mauvaises surprises en composant avec des éléments de succès passés. On pourrait espérer plus d’initiatives et de prises de risques. Pedro Pascal en père de substitution (avec quelques clins d’œil ironiques au Mandalorian) et Bella Ramsey en élue, pourquoi pas donc. J’imagine que l’originalité est loin d’être la qualité principale d’un jeu vidéo : au rayon zombies de l’apocalypse, en dehors d’une nuance fongique, rien que du classique. Cela aurait pu proposer justement une variante lente de la propagation de la maladie, après tout, on n’est que trois ans après l’épidémie du siècle. Il faut supposer que HBO a succombé plutôt à l’épidémie de l’image attendue des cadavres ambulants. Il y avait quelque chose à creuser. Occasion manquée. La danse des corps répond peut-être à un passage obligé du genre, mais on perd en intérêt. L’intérêt, on le trouve ailleurs : essentiellement la qualité d’écriture et la fascination, pour le coup, jamais éteinte, pour les villes dépeuplées, détruites et mangées par la végétation. Je venais de voir Finch avec Tom Hanks, donc le voyage vers l’ouest au milieu d’une apocalypse sentait pour moi un peu plus le réchauffé.
Un héros, Asghar Farhadi (2021)
commentaire :
juillet 2024
My Young Auntie/Lady kung fu, Liu Chia-liang (1981)
commentaire :
Cinq Venins mortels, Chang Cheh (1978)
Histoire rocambolesque et accessoire. On a beau suivre une enquête de jeu masqué assez étoffée, dans les grandes lignes, on frise la crédibilité du jeu Kung Fu Master : il faut rechercher cinq maîtres des arts martiaux qui se cachent et qui pourraient, pour reprendre les termes du disciple chargé de les dénicher, se trouver n’importe où sur la planète ; et très étonnamment, les cinq se trouvent non seulement dans la même ville, le même district, mais se fréquentent en plus tous plus ou moins… Effet boule à neige garanti.
L’intérêt est ailleurs. Il faut voir ça comme un exercice de style. Comme pour le patinage artistique, on note surtout les idées et l’exécution acrobatique. L’idée de départ est séduisante (trouver le maître parmi les cinq qui est honnête pour s’allier avec lui afin de vaincre tous les autres). On y trouve ici et là quelques géniales inventions à la limite du sadisme pour tuer « proprement ». Pour le reste, les chorégraphies sont plutôt décevantes. Je sortais émerveillé de Mad Monkey Kung Fu et des arabesques folles composées par Liu Chia-Liang et par son acolyte. On en est bien loin ici. Les acteurs sont également moins convaincants que Liu.
Je suis toujours aussi allergique aux photographies de la Show Brothers. Pas une ombre permise à l’écran, beaucoup de toc et des panoramiques en écran large qui donnent la migraine…
The Acolyte, Disney-Leslye Headland (2024)
L’émancipation espérée n’est pas au rendez-vous. Les thèmes habituels réapparaissent comme par magie, et l’on n’explore très peu voire aucun aspect nouveau qui aurait pu nous en apprendre davantage sur les usages différents faits de la Force et de la « police des Jedi » au cours de l’histoire de la fable. On recycle finalement les quelques éléments évoqués dans Tales of The Jedi sans en apporter d’autres. À côté de ce manque de prise de risques ou de créativité, on pourra au moins se satisfaire de quelques détails renouant encore et encore avec les forces de la mythologie : les luttes au sabre sont pas mal du tout et s’agrémentent de beaucoup d’arts martiaux ; les costumes sont au top. Mais quand on regarde les décors, c’est bien que l’essentiel ne suit pas. Parmi les resucées désespérantes : les jumelles aux destins contraires, le casque et le souffle qui va avec, les apprentis attirés par le côté obscur (ou le maître qui échoue), et même Yoda (même si l’on pouvait mal échapper à sa présence – mais de là en faire un événement pour annoncer la saison suivante, c’est un peu nous prendre pour des imbéciles). L’idée apparue dans Tales of The Jedi à propos de la corruptibilité des Jedi était à la fois logique et bien trouvée, c’est bien de développer cet aspect, mais on n’était pas obligé d’invoquer toujours les mêmes outils de la mythologie pour s’assurer de l’adhésion des fans. Les fans s’attendraient sans doute plus à quelque chose d’enfin novateur pour une série prenant place un siècle avant Skywalker. Autrement, quand il faudra évoquer l’histoire de Palpatine, que restera-t-il à dire ? Enfin, sur l’exécution, on retrouve les mêmes défauts que dans Ahsoka : rythme mal assuré et acteurs souvent exécrables (quelle logique y a-t-il à voir un acteur coréen non anglophone jouer un Jedi qui par définition est arrivé enfant sur Coruscant et devrait en conséquence parfaitement parler le « basic » ?). (Chronologie sélective de Star Wars.)
Dillinger, John Milius (1973)
On reconnaît un style viril et verbeux, crâneur et cool, violent et lyrique qui sera celui de John Woo ou de Quentin Tarantino. Peut-être même que c’est une tonalité commune à beaucoup de films du Nouvel Hollywood. Et s’il faut reconnaître à Milius un sacré talent pour écrire les dialogues et jouer sur quelques leitmotivs qui ont la même fonction qu’une arme pour un être humain (un accessoire, pas une finalité), je suis plus dubitatif quant au talent du bonhomme à diriger des acteurs ou à jouer de la caméra ou du montage. Dommage de saboter une si belle écriture avec des acteurs qui n’apportent aucune nuance ou profondeur au texte et tombent par conséquent inévitablement dans le ton sur ton ou la trivialité (au moins, Tarantino aura compris la leçon : quand on veut jouer des répliques qui font mouche, mieux vaut prendre son temps et trouver l’approche idéale, souvent non frontale et souvent robotique, mécanique tout en restant sincère).
Pour le reste, c’est malgré tout assez mal construit ou sans grand intérêt. Milius est bon pour les dialogues, beaucoup moins pour rendre ses personnages intéressant, voire attachants. Il ne prend jamais le temps de mieux les personnaliser, insister sur leurs relations. Il rentre par exemple dans le vif du sujet entre Dilinger et sa poule, mais vu qu’il ne passe qu’à travers le verbe brutal et l’action, on a du mal à croire en la sincérité de leur « amour ». Trop de personnages secondaires, trop d’action, c’est très clinique finalement. Manque le cœur, la sensibilité.
Le film a été vendu par Jean-François Rauger en présentation comme un road movie. C’est lui qui aurait proposé le film à celui qui était chargé de la programmation, et on lui aurait répondu en gros : « Tu le veux ? Eh bien, présente-le. » Très bien présenté, on sent que Rauger apprécie le film (j’ai le vague souvenir qu’il ait pu avoir présenté aussi Big Wednesday lors d’une séance où il aurait présenté le film comme un film un peu idiot, mais attachant ; on sent le goût des films de couilles entre elles, perso, j’avoue que l’adore du scrotum ou l’ambiance de vestiaire, c’est loin d’être mon truc). Pour autant, Rauger, ce n’est pas un road movie. Benoliel t’a fait une farce en t’envoyant le présenter et ta mémoire t’a joué des tours… Un road movie, c’est un film où on passe du tout sur la route, où c’est le parcours, le voyage qui compte. Un indice : quand, à chaque nouvelle séquence, une incrustation indique la date et les lieux, c’est qu’on passe d’une destination à une autre. Ici, c’est la destination qui importe, pas le trajet. Trajet qui, par conséquent, est presque toujours éludé. Et le principe, c’est bien de ne pas tourner en rond. Bref.