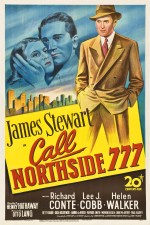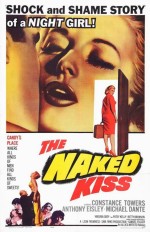Qualité Schrader. C’est-à-dire scénario qui tient la route avant tout. Le début est une leçon d’écriture pour exposer des personnages et des situations. On apprend les noms des personnages en situation, à connaître les caractéristiques des personnages… en situation (par exemple, Vandorn, on montre son exigence, son obstination, dans une scène au boulot où il n’est pas satisfait d’une affiche). Le rythme des scènes se succède à une vitesse folle. Le but toujours étant de délivrer une information, même si bien sûr, on ne sait pas encore où on nous embarque. Une fois que tout est mis en place, le récit peut enfin déraper avec la disparition de la fille de Vandorn. Ensuite, c’est plus classique, plus linéaire, mais pas moins difficile à écrire sans doute.
On pense inévitablement au Taxi Driver que Schrader avec écrit deux ou trois ans plus tôt. Les deux films étant eux-mêmes inspirés de La Prisonnière du désert. Ici, c’est plus évident que dans Taxi Driver puisque le sujet, c’est un père qui part à la recherche de sa fille, enlevée (ou pas) alors qu’elle entrait à peine dans le milieu du porno (version hard, genre snuff movie). Le personnage est toutefois moins intéressant que celui de Taxi Driver (ses relations avec la prostituée qui l’aide sont à peine esquissées, et sans doute à juste titre ; il est moins fou, moins ambigu). On retrouve l’attrait de Schrader pour les mondes opaques, dangereux dans lesquels le héros doit s’infiltrer. Toujours avec ces mêmes travellings latéraux filmés depuis la voiture sur des trottoirs fréquentés par des rabatteurs, des prostituées et autres personnages louches. Et que ce soit à LA, San Francisco ou San Diego, tout fait penser aux rues de NY : grosses enseignes lumineuses, des entrées avec des escaliers qui remontent vers un peep-show (pas loin du bar d’Hideko dans Quand une femme monte l’escalier). L’univers, l’époque, ça fait aussi penser un peu à Boogie Night, le côté fun en moins (le porno glauque, insouciant, des 70’s).
Il y a des images assez cocasses dans le film, comme quand George C. Scott (le Patton de Coppola, et avant ça le général maboul chez Kubrick) jouant ici un père veuf (ou presque) issu de la classe moyenne du trou du cul des États-Unis, très religieux, enfile fausse moustache, perruque, chaîne en or et jean à la mode pour se faire passer pour un producteur de films pornographiques. On y croit moyen, le personnage aussi, donc ça marche.

À noter aussi le personnage assez peu convaincant de la pute au grand cœur, qui s’enfuit avec le père quand il lui demande de l’aider à retrouver sa fille moyennant une semaine de salaire. Schrader ne s’attarde pas sur la relation, c’est à la fois la qualité et le défaut du film. Un personnage quand il vise un objectif (sa fille ici) doit trouver autre chose en chemin (la tradition du truc initiatique, etc.), donc là ça tombe sur elle, sauf qu’un tel personnage est à la fois fascinant au premier coup d’œil (pour un spectateur mâle, je suppose), mais on s’égare très vite dans les clichés. Un peu à l’image des lunettes fumées qu’elle porte sans cesse qui nous laisse seulement entrevoir son regard… En gros, on veut la voir, on nous la montre à poil au début (les seins les plus laids de toute l’histoire du cinéma) et hop, elle se rhabille ; on ne verra même pas ce qui pourrait la rendre plus intéressante, les yeux, son regard, son histoire… Comme si Schrader ne voulait pas tomber dans le piège du héros qui tombe amoureux de la prostituée. Trop grossier, trop cliché. Trop tard, Paul… Vandorn lui-même lui dit clairement que son histoire ne l’intéresse pas avant de changer brièvement d’avis, mais ce sera trop tard, elle filera… Pourtant, c’est bien lui (Schrader) qui a voulu aller dans cette direction… S’il ne voulait pas jouer avec les stéréotypes, il ne fallait pas décrire ce milieu. Peut-être également n’était-il pas satisfait de l’actrice (qui fut madame Kurt Russell pour la petite histoire) : si elle s’en tire pas mal sur le côté physique du personnage (les moues insolentes, la démarche de traviole), il n’y a aucun charme quand elle parle, c’est presque récité… Pas facile de trouver une bonne actrice pour jouer un tel personnage (topless), encore à la fin des 70’s. Surtout si le scénario ne l’a pas développée comme il l’aurait dû. On ne peut cesser de penser qu’il y aurait eu une relation intéressante entre les deux personnages, un jeu de substitution père-fille. Peut-être trop évident pour Schrader, trop éloigné du thème principal (en bon amateur de la ligne stricte à la Bresson).
Pas un grand film donc, mais à découvrir parce qu’il est l’œuvre d’un des meilleurs raconteurs d’histoire de cette fin du XXᵉ (The Yakuza, Taxi Driver, Raging Bull, À tombeau ouvert, La Dernière Tentation du christ, Mosquito Coast, City Hall, Obsession, Affliction, American Gigolo).


Ça m’étonnerait que le film ait rencontré un franc succès. Pas de star, un film assez sombre, pas d’action… L’année d’après, il continuera les adaptations déguisées. Fini la Prisonnière du désert, place à l’esprit de Bresson. Et un Richard Gere pour rendre tout ça un peu plus sexy. Désormais, les balades en voiture ne se font plus en première à mater les néons des peep-shows la nuit, mais en accompagnant une décapotable filant à toute allure sur une route ensoleillée avec une musique pétaradante. On change légèrement d’angle, mais au fond ça reste un peu la même chose et en prime le film a du succès… Au lieu de voir un personnage qui cherche, on a plutôt affaire à un personnage traqué, qui est victime d’un coup monté. On sort de la bagnole et on regarde autour de soi pour se demander qui va nous foncer dessus… Le monde, qu’on le regarde depuis sa voiture ou en piéton traqué, il est le même. Dangereux. Et il tend pas mal à se propager comme une tache d’encre sur un buvard, prêt à imprégner la vie fragile de nos « héros ». La fille de Vandorn, même perdue au fin fond du Michigan, ne pouvait pas échapper au monde cruel et pervers de la société : les Indiens sont partout.
D’ailleurs, il est intéressant de remarquer dans la bio de Schrader que Grand Rapids, la ville du Michigan où se déroule le début du film (où on y décrit les pratiques religieuses strictes) et d’où partent les élèves dont la fille de Vandorn pour la Californie pour un voyage scolaire, eh bien, c’est sa ville natale. Lui-même a reçu une éducation calviniste stricte… Quand on regarde les personnalités issues de cette ville (sur Wiki), en dehors de Schrader on peut y trouver Chris Kaman et Gillian Anderson, ça fait rêver.
En bonus : Vandorn décide donc de se faire passer pour un producteur de films de cul pour retrouver l’acteur qui a joué avec sa fille. Il tombe sur un Noir qui n’est évidemment pas le « type recherché », alors le mec s’énerve : « C’est parce que je suis noir que tu ne veux pas de moi ? Mec ! Tu ne sais pas qui je suis ? Je suis Big Dick Blaque. J’ai fait plus de films porno que tu n’en verras jamais ! » Et en face, c’est Patton déguisé comme Burt Reynolds dans Boogie Nights.

Hardcore, Paul Schrader 1979 | A-Team, Columbia Pictures


 Année : 2008
Année : 2008







































 Année :
Année :