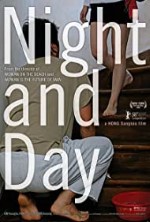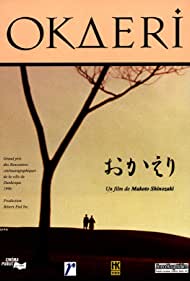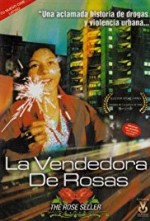S’il y a quelque chose d’agaçant chez Claire Denis, c’est de voir à quel point, l’évidence de son talent saute aux yeux, mais qu’elle ne cherchera toujours plus au fil de sa carrière qu’à s’enfermer dans ses défauts qui paradoxalement ont été aussi à ses débuts ses principales qualités.
On y retrouve toujours ce savoir-faire pour l’écriture d’un récit elliptique, bref, concis, censé souvent aller à l’essentiel, mais chez Denis, il y a le choix, qui peut se comprendre au départ, de flirter avec la distanciation. Certains éléments sont introduits dans le récit, et on les comprend, ou pas, vers la fin à mesure que le puzzle se reconstitue. Cela ne réclame aucune explication, et à ce stade, c’est encore une qualité. Ici c’est bien perceptible avec ce qu’elle fait avec les éléments épars du thème de l’arnaque aux cartes téléphoniques.
Seulement, une fois compris, il faut aussi se rendre un peu à l’évidence, c’est un motif amusant à repérer entre les lignes énigmatiques du scénario mais ç’a autant d’intérêt que de jouer à un jeu des sept erreurs. Dans le récit d’ailleurs, c’est accessoire. Comme beaucoup trop d’éléments on serait même tenté de dire. Les deux protagonistes ne sont pas concernés.
Dans les films suivants (à des exceptions, Vendredi soir est un film toujours concis, allant à l’essentiel, simple et clair), Denis ira vers encore plus de concision, se refusant à expliquer les situations, montrer les sources des conflits, jusqu’à en devenir franchement pénible, son cinéma nous interdisant le plus simplement du monde ce que Denis oubliera le plus souvent par la suite, une histoire, ne devenant plus qu’une exposition de situations évanescentes, d’évocations, d’atmosphère, dans lequel on voudrait bien chercher à comprendre quelque chose, mais où finalement on y renonce assez vite comprenant qu’on se fout un peu de notre gueule. Une chronique sociale, même personnelle, c’est déjà une mise à distance d’une histoire, les situations prennent souvent sens dans leur globalité, mais quand on s’écarte du genre et qu’on tente de proposer autre chose tout en tombant inévitablement dans certains clichés pour se rassurer face aux risques entrepris, on peut légitimement douter de l’intérêt d’une telle démarche.
Une fois encore, un autre des gros défauts du film récurrents dans les films de Claire Denis, c’est la mise en lumière de personnages antipathiques, en particulier masculins. L’actrice qui joue Nénette est formidable (Alice Houri, qui sauvait déjà — même pas en fait — U.S. Go Home), parce que pour rendre sympathique un personnage foncièrement stupide, buté, agaçant et vulgaire, c’est qu’il en faut du talent. Or, elle lui apporte, comme ça, l’air de rien, et donnant l’impression d’être la seule à ramer dans cette galère denisienne, intelligence, douceur et sensibilité. Même chose pour Valeria Bruni Tedeschi, qui malgré un physique moins facile que la frangine, arrive à rendre belle sa boulangère amourachée d’un vampire au beurre (Vincent Gallo, forcément), elle aussi vulgaire et stupide (je ne le dirais jamais assez, c’est toujours un exploit pour un acteur de rendre sympathique et crédible un personnage stupide), grâce à sa voix et à son sourire à faire fondre des montagnes. Pour trouver les personnages féminins sympathiques par la suite chez Claire Denis, il faudra se lever de bonne heure. Car ses choix iront presque systématiquement vers les hommes, pour lesquels les rôles écrits sont presque toujours grossièrement antipathiques, et dont les habitués sont d’épouvantables acteurs incapables à la fois de composer un personnage et de retranscrire justement un dialogue (on enlève Cluzet et Lindon, et on garde Colin — qui n’est encore pas si mauvais ici malgré un personnage, là encore, insupportable — ou Alex Descas, par exemple — qui, en plus d’être mauvais acteur, a une personnalité fade, polie, digne des gendres idéaux, bons élèves, qu’on peut repérer dans les séries et téléfilms français). C’est dire si Claire Denis, directrice d’acteurs est épouvantable.
On peut suspecter Claire Denis d’avoir incité le plus souvent les acteurs à improviser dans son film, mais face à la difficulté des situations trop complexes à rendre ou face au manque de talent de ses acteurs (Jacques Nolot se paie les séquences les plus mal jouées du film), on peut imaginer que la cinéaste ait proposé alors des dialogues à ses acteurs. Le résultat est horrible. Au lieu d’insister sur une direction d’acteurs basée sur une improvisation dirigée, elle va au plus simple et balance des tunnels de répliques impossibles à dire pour des acteurs médiocres. Sans doute consciente de ce défaut, et encore au lieu d’insister sur l’improvisation ou sur le choix d’acteurs plus compétents (encore une fois Alice Houri ou Valeria Bruni Tedeschi, pas besoin de leur foutre quarante répliques entre les mains, elles semblent être capables d’improviser et de respecter certaines orientations de jeu pour la séquence avec une spontanéité déconcertante), elle choisira de gommer le plus possible les séquences dialoguées (ou bavardes) de ses films. Alors il y a certes une logique parce qu’elle tend c’est vrai à virer tout ce qui est explicatif dans ses récits, mais là encore ce sera une manie qui ne servira pas vraiment ses sujets. Restera donc ces films d’atmosphère où on nous demande de jouer au jeu des sept erreurs, mais dans un tel brouillard qu’on renoncera bien vite à adhérer à cette distance que Claire Denis nous impose.
Pourtant le film a ses petits miracles. Comme cette séquence avec la fille du planning familial d’une laideur repoussante mais dont le talent tout simple la rendrait presque jolie, où tout à coup la scène bifurque vers complètement autre chose à la faveur d’un coup de fil (on retrouve les éléments de notre thème dispersé façon puzzle dans le récit). Tout repose ici sur le talent de l’actrice (Pépette… qu’on peut lire au générique).
Un autre moment rare, c’est la rencontre entre Nénette et la sage-femme. La beauté du malentendu. Un instant fugace de vie que le cinéma parfois est capable de nous rendre. Tout se joue (là encore, paradoxalement, parce qu’on est bien chez Claire Denis) dans les dialogues. Nénette, toujours aimable, précise qu’elle ne veut surtout pas souffrir. La sage-femme lui répond un peu sèchement que ça, elle aurait dû y penser avant. Nénette réagit au quart de tour, pensant y voir là un reproche quant au fait qu’elle ait décidé d’accoucher sous X. La sage-femme, comprenant immédiatement le malentendu, prend alors soin de lui expliquer ce qu’elle voulait dire, tout en lui montrant par la suite une bienveillance forcée mais nécessaire. C’est peu de chose, mais ce sont des détails qui font la force et la justesse d’un certain cinéma. Dommage que Claire Denis n’ait pas insisté sur cette voie.