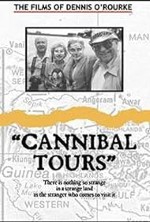Puzzle narratif pour un thriller en quasi-huis clos dans une production à la fois cosmopolite et familiale. Rien de particulièrement bien prometteur, mais il faut saluer, quand elles se présentent, les tentatives visant à réanimer en France un genre qu’on n’associe guère plus aux productions de l’hexagone depuis… Jean-Pierre Melville ? Le Trou ? Clouzot ?… Depuis… la Première Guerre mondiale et les serials… ? (On a connu quelques tentatives laborieuses au cours de ce siècle, avec les mêmes moyens, et je n’ai pas souvenir qu’aucune d’entre elles n’ait jamais été couronnée de succès. J’ai un triste souvenir de 13 Tzameti par exemple.)
Les intentions dans le sujet et l’argument pour un film au format si particulier (trente minutes) ne brillent pas pour leur originalité, mais c’est rarement, voire jamais, ce qu’on réclame à un film de ce type. Pour des raisons de coûts, on peut facilement deviner que le quasi-huis clos s’impose de soi (le tournage de nuit et le château — sauf si laissé à disposition par des amis — un peu moins), et on peut voir ça comme un exercice de style auquel tout jeune réalisateur ou scénariste devrait se plier.
À ce stade, et de ce que je peux en juger pour être loin de pouvoir prétendre être un expert en écriture de thriller, la structure en puzzle apporte du dynamisme et du mystère à un récit forcément condensé en trois fois dix minutes. Le principe permet de délivrer des informations au compte-goutte, passer d’un temps de récit à un autre, jouer de la voix off, avancer, pas à pas, pion après pion, jusqu’au basculement final qui aura vocation à vous casser les reins. Après une entrée en matière convenable (je parle de l’écriture uniquement ici ; je reviendrai plus en détail sur la mise en scène des premières secondes), le reste de l’exposition n’avance pas idéalement. Peut-être que c’est aussi une impression laissée par les autres défauts du film. Une fois qu’on entre plus avant dans le récit et que l’action se met en place, que les zones d’ombre s’éclairent (comme cela était à craindre dans ce genre d’exercice), ça se gâte. Je passe sur les incohérences éventuelles qu’un tel récit (jouant sur différents niveaux de réalité) provoque inévitablement (je mets rapidement de côté les défauts structurels et de cohérences quand mon attention est accaparée par ce qui m’est plus familier et évident), mais certains éléments du dénouement sont loin d’être convaincants. Premier twist : « c’était pour ton anniversaire ! » (pourquoi pas, ça vaut « ce n’était qu’un rêve », mais soit), suivi du second : « je me venge et je fais tout exploser ! ». Le double twist, c’est comme les biscottes qu’on tartine de beurre des deux côtés. Si tu tiens bien la tranche : bon courage, et assume le cholestérol. Mais au moindre écart, tu es dans la sauce. Et pour le coup, une incohérence est difficile à avaler, quel que soit le niveau de réalité qui rentre en jeu : non, on ne peut pas en deux minutes exploser tout un château en ouvrant… le gaz. À moins d’avoir une arrivée de gazoduc en guise de gazinière dans sa cuisine. Et encore.
Passons les incohérences, c’est le genre de détails qui sont susceptibles d’être gommés quand on s’entoure de scénaristes ou de relecteurs, si toutefois, on met les moyens pour ce faire, et si on accepte surtout de déléguer, de recevoir des critiques et faire siennes les propositions des autres. Ce n’est, par définition, pas une priorité dans une boîte de production familiale et indépendante. Quels que soient les moyens dont on dispose au départ, savoir et vouloir s’entourer de professionnels plus compétents que soi, réfréner ses envies de faire plaisir à son entourage n’est sans doute pas donné à tout le monde. Même l’indépendance a un prix. On peut même supposer qu’elle a un coût, car les investissements de départ ne seront alors jamais rentabilisés. On peut supposer ici que la réussite est ainsi la combinaison de cinq facteurs : la volonté, l’asset (les fonds propres), le talent ou le savoir-faire, l’exigence et la chance (souvent « conditionnée » par l’épaisseur du carnet d’adresses). La majorité des productions indépendantes ne remplissent pas plus d’un de ces critères.
Restons sur le savoir-faire : ce qui saute aux yeux dès les premières secondes du film, c’est son manque de maîtrise sur le plan de la mise en place et de la direction d’acteurs. Le découpage technique est globalement propre (peu créatif, mais propre), mais comme c’est souvent le cas, la gestion des acteurs réduit tous les efforts de la mise en scène (avec la caméra) à pas grand-chose. Réaliser un film, ce n’est pas seulement décider du cadre, c’est ainsi contrôler ce qu’on veut y mettre à l’intérieur. Et ça me paraîtra toujours aussi cocasse de voir des réalisateurs se lancer dans le grand bain sans n’avoir jamais appris à travailler avec un acteur. C’est une chose de maîtriser l’emplacement de la caméra, décider quand et quel type de musique d’ambiance adopter, c’en est une autre de savoir choisir, diriger, corriger des acteurs, et éventuellement, amender ses propres idées en fonction de ce que proposent les acteurs, les circonstances, en fonction de leurs possibilités ou, plus souvent encore, en fonction des fausses bonnes idées qu’on identifie au fil d’un tournage, ou les bonnes qui seront trop difficiles à mettre au point sur un plateau (ajustement de la distance, de la lumière, du rythme, du positionnement des acteurs entre eux, etc.). Au bout d’un troisième court, on devrait avoir appris de ses expériences passées. Sauf si comme souvent, on n’a que des retours positifs de la part d’un public déjà acquis à son talent ou si on pense que courir les festivals donne un quelconque gage sur la qualité d’un film. Il en va de même des films et des « hyperdocteurs » : multiplier les apparitions à des festivals sans jamais décoller comme d’autres multiplient les « doctorats » sans jamais rien publier, ce serait plutôt indicateur qu’il y a anguille sous roche.
Voici comment débute donc le film : plan fixe sur le sol dans un intérieur, bruits de pas jusqu’à présent hors-champ, voix off traînante d’un personnage qui parle du passé (code bienvenu évoquant le film noir), jeux sonores, puis la caméra s’élève. Une femme apparaît à l’écran. Et là, tout s’écroule. On devine un plan en vue subjective (confusion, à mon sens, plutôt malhabile parce qu’on peut être amené à penser que la vue, comme la voix off, est celle du personnage principal) : la femme file droit sur la caméra. Problème : quelque chose cloche dans sa démarche, dans sa présence, dans son mouvement. Ce n’est pas seulement que sa démarche paraît trop peu naturelle, c’est surtout qu’on sent que c’est précisément ce qu’on lui demande. Marcher à un certain rythme. Et que ça ne lui est pas naturel. On devine l’intention : marcher lentement, ça participe à l’ambiance générale.

Ça peut aussi la casser net.
Ce qu’on espère se matérialiser à l’écran en l’imaginant et en en écrivant la description précise dans un scénario, si ça ne marche pas lors du tournage, c’est fichu. Surtout si on ne s’y est pas préparé.
En l’occurrence, dans ce genre de situation, je dirai que neuf fois sur dix, c’est une question de choix d’acteur et de direction. Les mauvais acteurs… ne savent pas marcher quand on leur demande de marcher. On le comprend en assistant à un premier cours de théâtre : aller d’un point A à un point B sur un plateau ou une scène, cela n’a rien d’évident. Il y a des acteurs plus habiles que d’autres qui vont comprendre les intentions à ce moment de leur personnage. D’autres auront besoin qu’on les conditionne, qu’on essaie dix fois, en adoptant tel ou tel subterfuge pour tirer d’une manière ou d’une autre ce qu’on attend d’eux… Et puis, il y en a d’autres qui, mal guidés, perdus, n’arriveront à rien, ne serait-ce qu’avancer vers une caméra. D’autant plus qu’un acteur a besoin d’un cadre, d’un contexte : une femme qui marche vers un homme et lui tourne autour, ce n’est pas une situation. Si c’est une forme de danse, il faut alors insister.
Et puis, une fois sur dix, c’est plus qu’une simple question de direction d’acteurs. Disons que le cadre est posé, on sait dans quelle ambiance on veut que le spectateur se trouve dans les premières secondes du film, on a la chance d’avoir les meilleurs acteurs du monde, on lui demande d’agir, en apparence, de manière anodine, mais qui ne l’est pas (marcher), et là, patatras, ça ne marche toujours pas (supposition). Pourquoi ? Parce qu’on montre rarement les acteurs en pied. C’est une des premières astuces qu’on a inventées pour éviter d’avoir l’impression d’être au théâtre au cinéma. On montre les acteurs en pied quand ils évoluent en plan général et quand ils sont en mouvement en dehors de l’axe de la caméra, mais quand ils « passent à l’action » et que le plan cesse d’être purement illustratif, on préfère passer alors, au minimum, au plan américain. On coupe les pieds, et avec ça, les maladresses des acteurs. Le cinéma avait une de ses premières astuces qui fera illusion et amassera les foules dans les salles. (Bien sûr, on trouvera toujours des exceptions comme dans les films de Rohmer pour trouver des contre-exemples.)
« Ah, oui, mais, je veux jouer sur les pas ! C’est le sens de mon introduction ! »
On les entend les pas. Pas la peine de la voir si longtemps marcher vers la caméra si l’actrice n’est pas à l’aise et si le rendu est si peu cinématographique. L’image ne fera qu’écho avec la piste sonore. Le cinéma est parcimonieux : le spectateur n’apprécie guère qu’on lui répète une information (mes lecteurs adorent). Insister ? Pourquoi ne pas le faire autrement ? On entend les pas, on voit la femme arriver, s’avancer vers la caméra, et très vite on propose un autre angle, plus rapproché. Les gros plans, voire les inserts (et on ne peut pas dire qu’un insert sur des pieds qui marchent n’appartient pas au code du genre), c’est restrictif : montrer une chose, c’est souvent cacher le reste. La puissance du hors-champ. Fond sonore + image, plein pied, d’une femme, plein cadre, qui avance vers la caméra ? Trop d’informations qui se répètent trop longtemps, trop d’informations anodines. Alors, si en plus, l’actrice donne l’impression d’enfiler pour la première fois de sa vie des chaussures à talon… (À la limite, plein pied, il aurait fallu tenter un flou, autre chose qu’une vue subjective ou apparentée, multiplier les gros plans et choisir au montage ceux qui, combinés, marchent le mieux. Se donner la possibilité de faire des erreurs, revoir sa copie, ce n’est pas la même facture… Mais c’est malheureusement sur ces détails que se joue tout le reste.)
On comprend ensuite dès le plan suivant (même situation, on sort de la vue subjective et la femme tourne autour d’un homme, on ne sait pas bien pourquoi) que ce genre de manque de maîtrise se retrouvera pendant tout le film. On se rapproche des acteurs (on ne voit plus les pieds !), mais l’homme esquisse un geste vers la femme qui s’éloigne. Une nouvelle fois, rien de naturel dans ce geste. Vu que c’est une sorte de danse, rien n’oblige à forcer le réalisme, le naturel, la spontanéité, mais dans ce cas, si on joue sur le caractère mystérieux, comme une sorte de parade mortuaire ou comme des souvenirs épars qui s’agitent dans la tête du narrateur, ça se dirige, ça s’accentue, et malgré le fond sonore, malgré la voix off, il me semble difficile de faire l’économie, soit de plans plus rapprochés habilement intégrés à la situation au montage, soit d’un ou deux plans jouant beaucoup plus sur la lenteur ou la difficulté d’appréhender les motifs agissant dans le cadre (l’information majeure est donnée en voix off, tout le reste n’est qu’illustration). Dans tous les cas, quand un acteur intègre à son jeu un geste censé être spontané et qui ne l’est pas (peut-être pensé par le réalisateur, c’est souvent le cas quand un mauvais acteur manque d’aisance), soit on refait une prise, soit on propose autre chose (en l’occurrence ici, il n’y avait pas grand-chose à faire).
Tout le reste est du même niveau. Les acteurs sont loin d’être au point, mais ils ne sont pas forcément bien aidés non plus par la mise en place ou les éventuelles indications de celui qui est aux manettes. Autre signe d’un manque de maîtrise globale au rayon de la direction d’acteurs (récurrent dans les films de genre) : le ton sur ton. Un acteur, c’est bête et docile. Le plus souvent, il comprend des intentions des personnages et de la situation à travers les lignes de dialogues qu’on lui donne. Résultat : tout est joué au premier degré et toutes les expressions faciales s’alignent sur ce que le personnage exprime à travers les mots au moment où il les dit. Même principe qu’avec les bruits de pas : on les entend déjà, il est inutile de perdre son temps à nous les montrer. Ou, au contraire, on insiste. Parce que c’est un point qui mérite d’être mis en avant. Réaliser, jouer, c’est faire des choix. Et un acteur qui exprime deux fois la même chose, c’est un acteur qui fait le choix de la médiocrité. Il ne choisit pas, il balance. Certains acteurs médiocres peuvent s’en sortir et faire illusion à l’écran : quand ils sont bien dirigés. Mais un directeur d’acteurs peut difficilement faire illusion (avec un bon casting, peut-être) : c’est à lui de savoir quoi dire à un acteur pour qu’il n’en rajoute pas, d’identifier les moments où l’acteur ne comprend pas ce qu’il fait, se trompe ou quand les indications qu’on lui donne ne mènent nulle part et nécessitent qu’on revoie l’angle sous lequel on voulait d’abord montrer la situation pour en trouver une approche, parfois après plusieurs essais, qui soit enfin convaincante.
Je suis un spectateur difficile, comme d’habitude. Mais très vite, on repère les petits défauts qui illustrent d’un manque de maîtrise. Le jeune réalisateur peut manifestement compter sur sa famille qui possède un restaurant en plein Paris. C’est une bonne chose. Comme aux belles heures du cinéma d’avant-garde où la bourgeoisie (pour ne pas dire « l’aristocratie ») jouait les mécènes dans le cinéma français. Les familles des beaux quartiers auront toujours mon soutien de spectateur sans-le-sou si elles préfèrent monter des boîtes de production de cinéma indépendant et si tous les passionnés de la famille, éventuellement les amis, en profitent pour assouvir une passion. C’est une situation bien plus préférable (et a priori rare) que celles où il suffit « d’en être » à des familles déjà installées dans le milieu pour se voir ouvrir toutes les portes (sauf peut-être celles… des cinémas). On est peut-être loin des ambitions de l’avant-garde, mais adopter un type de film qui ne fait pas recette en France (le thriller), c’est déjà une belle ambition. Surtout que choisir une distribution cosmopolite parlant invariablement anglais dans un château français comme dans un monde parallèle, voilà qui pourrait bien faire écho un siècle plus tard aux velléités surréalistes de leurs aînés… Ma foi, why not ?