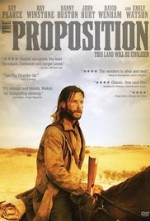Quelle horreur de film… Je me trompe ou, non seulement, ce film a vingt ou trente ans de retard sur son époque, mais en plus, le point de vue qu’il adopte n’est pas sans rappeler l’insipide et vulgaire Call Me: The Rise and Fall of Heidi Fleiss ?
Scorsese ne cesse de s’imiter lui-même en alternant les séquences « dans le milieu » et « dans la famille ». Les scènes de jalousie hystérique à la New York New York, à la Casino ou à la Raging Bull, la caméra qui virevolte entre les lignes pour nous présenter les personnages de la boîte (dont finalement on ne saura jamais rien) ; mais à force de vouloir tout dire, de tout montrer, Scorsese, pourtant avec trois heures de film, ne montre rien. Terence Winter n’est pas Paul Schrader, et même Schrader aurait eu du mal à trouver un sens à cette autobiographie (ou autohagiographie, devrait-on dire). Terence Winter, c’est le scénariste de Xena la guerrière, et ça se voit, il n’y a absolument rien à sauver dans ce film. Les cinq minutes passées avec Matthew McConaughey à la rigueur. Une belle ironie d’ailleurs. Parce que son personnage est typique des golden boys des années 80. On se dit que Belfort changera de méthode. Absolument pas. À quoi bon revenir vingt après sur le Wall Street d’Oliver Stone ? Une suite ne suffisait pas ? Mais Belfort est plus trash, me direz-vous… Et alors ? Un petit gars de la classe moyenne qui se prend pour Tony Montana… mais Belfort, c’est Baby Face, pas Scarface. Belfort…, rien que le nom, on a l’impression de voir un Channel jouer les caïds.
Casino était déjà pas mal passé de mode comme un western des années 80. Y rajouter une couche, quel en serait l’intérêt ? Parce que si l’époque est bien, à nouveau, aux crapules de la finance, elle est moins à ces petits cons cocaïnomanes des années 80 qu’aux escrocs de haute volée sachant parfaitement s’immiscer aux affaires au point d’arriver à en changer les règles et de mettre les politiciens dans la poche. On l’a souvent entendu dire ces dernières années, la crise de 2008, c’est une crise systémique. Ce n’est pas l’affaire d’un petit truand s’ouvrant tout seul les portes de Wall Street. L’idée du Loup de Wall Street, c’est l’idée d’un loup entrant dans la bergerie. Wall Street serait donc cette bergerie. C’est le point de vue de Belfort. C’est son eldorado. Cinq ans après, c’est ça la vision critique qu’on peut avoir sur Wall Street ou sur le milieu de la finance ? Wall Street est une bergerie ? Désolé, Martin, tu n’as rien compris à l’histoire. Mettre en scène l’hagiographie d’une petite crapule (même pas une grosse, un psychopathe pour lequel on pourrait au moins s’intéresser parce qu’il est un monstre ; parce qu’ici, Belfort n’est rien de plus qu’un gars ordinaire, c’est presque toujours le mythe du rêve américain, la réussite à tout prix, et c’est là qu’on est plus proche d’Heidi Fleiss que de Scarface…) quand c’est toute la finance qui est pourrie de l’intérieur, ça sonne comme une tentative de diversion. Ce n’est évidemment ni l’intention de Scorsese, ni celle de Belfort, qui lui ne cherche qu’à nous vendre sa vie de merde comme parfaitement honnête comme il vend des stylos (la drogue et la baise, ça permet, entre deux tranches de vérités, de mieux faire passer le reste).
Le film souffre pas mal de personnages à la fois antipathiques et trop brièvement esquissés. Belfort, pour commencer, a autant de charisme et de remords qu’un vendeur de voitures, et le trio Belfort-Winter-DiCaprio n’arrive pas à la cheville du duo Baldwin-Mamet dans Glengarry Glen Ross. Belfort est un connard, mais il n’a même pas la politesse d’être un génie, ni même un sadique. En quoi serait-il fascinant ? Un vendeur de voitures qui cherche à se faire du fric, rien de plus. Tout est dit quand il demande aux autres de lui montrer comment vendre un stylo. Il se contente, le reste du temps, de convaincre, micro à la main, tel un prêcheur devant sa paroisse. Mais Belfort n’est pas non plus Elmer Gantry. Sans parler que Scorsese, comme à son habitude, choisit un des acteurs les plus insipides de sa génération, convaincant, seulement, quand lui aussi, doit refaire du réchauffé, à savoir s’imiter dans Gilbert Grape. Le personnage de la première femme de Belfort passe globalement à la trappe, alors que Scorsese la traite dans une ou deux scènes comme si elle était au centre de l’histoire. Le meilleur pote est tout aussi ridicule, comme le personnage de Jean Dujardin, toujours aussi peu convaincant dans tout ce qu’il fait…
Le film n’échappe pas non plus à la vulgarité. Orgie de nibards, de coke, de fellations ou de baise… Quel intérêt, sérieux ?…
Est-ce que Scorsese dénonce la vulgarité de son personnage ? Certainement pas. On pourrait douter de ses intentions, mais celles-ci ne se voient jamais à travers un récit. Il est donc dangereux de vouloir traiter un tel sujet en prétendant ensuite jouer le second degré, à l’image de Tueurs nés. Quand on fait un film sur la violence, on prend le risque de faire juste un film violent. Quand on fait un film sur la vulgarité, on prend le risque d’être juste vulgaire. Question de mesure, d’interprétation. Mais Martin Scorsese ne cesse jamais ici d’être dans l’excès. Difficile de penser qu’il ne se serait pas laissé prendre à son propre jeu…
Même épandage grossier dans les images, le montage, les extérieurs, pour en foutre plein les yeux aux spectateurs. On pourrait y attendre au bout d’un moment un petit regard cynique, désabusé, critique, quoi… non, non, tout ça était bien au premier degré. Quand je dis qu’on est resté aux années 80, c’est bien ça. La référence ultime du film, c’est même la Ferrari blanche de Miami Vice… Oui, désolé, c’était déjà bien ringard à son époque, mais vingt ans après, rester à cet étalage puant et grossier, ça n’aide pas à me rendre le film sympathique. Je crois même qu’à la fin du film sur la vie de la Madame Claude d’Hollywood, Heidi Fleiss, elle arrivait au moins à attirer la sympathie. Ici même pas. La fin est claire : je n’ai aucun remords, et l’on me paie même pour donner des séminaires et continuer à prêcher la bonne parole. On aurait tort d’y voir une conclusion cynique. C’est bien un happy end qu’on nous présente là. Non seulement le message est puant, mais Scorsese n’y apporte même aucun second degré pouvant laisser place au doute. Si ce n’est de la maladresse, c’est de la connerie. Et c’est en tout cas bien ce qu’est le film : con, très con.
Quand j’y pense, depuis Casino, ce qui est le plus vulgaire chez Scorsese, c’est son casting. Charron Stone déjà… Ensuite, continuer toute sa filmographie avec un Pseudo-Rital de Los Angeles, je le peux encore moins. C’est comme si Spike Lee décidait de supporter du jour au lendemain les Lakers ou Woody Allen mettait en scène un film sur Sunset Boulevard. Dès que je vois Di Caprio, je ne vois pas un adulte, encore moins un dur, encore moins un Rital, encore moins un homme. Je vois un bellâtre sorti de Santa Barbara après avoir passé l’âge de jouer les jeunes premiers. (Pas un plan où l’on peut respirer, c’est gavant.)
Une raison supplémentaire de ne plus m’aventurer dans ces films merdiques qui, non seulement, sont incapables d’inventer quoi que ce soit, mais qui, en plus, ne savent faire qu’une chose : reproduire en vrac les vieilles recettes d’autrefois.
Le Loup de Wall Street, Martin Scorsese 2013 The Wolf of Wall Street | Red Granite Pictures, Appian Way, Sikelia Productions

 Année :
Année : 















 Année : 1985
Année : 1985