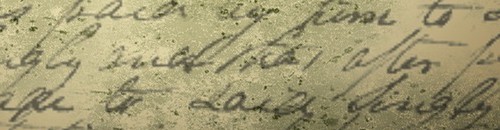Proposition de départ intéressante : dézinguer les super-héros en se demandant ce qu’ils pourraient devenir s’ils disposaient réellement des pouvoirs dont ils sont supposés avoir. Ils en abuseraient allègrement bien sûr : autoritarisme, violence gratuite et sexuelle, mégalomanie, absence d’empathie pour des êtres inférieurs (ou même pour leurs congénères pouvant apparaître comme des rivaux dans un environnement où la popularité garantit certains privilèges et où tout le monde semble vouloir se tirer dans les pattes), tendance au sadisme et à la violence gratuite, l’impression justifiée ou non par leur statut de super-héros qu’ils sont au-dessus des lois ou considérant que la loi c’est eux, etc. Bref, cela ressemblerait à une jolie forme de dictature, les puissants décidant le plus souvent pour le reste des individus qui leur sont inférieurs, et une dérive déjà pas mal questionnée dans X-Men et compagnie.
La manière dont les agressions sexuelles sont mises sur le tapis, notamment, dès le premier épisode, sent bon l’air du temps, mais ça s’assagit trop par la suite avec une volonté assumée, et en contradiction avec l’idée initiale, d’en sauver certains parmi les protagonistes surpuissants en en faisant les victimes d’un système qui les dépasse. Le trash sexuel quand il apparaît par la suite n’est plus qu’anecdotique, alors que la fellation de bizutage inaugurale avait un poids narratif et donnait le ton à la série (audace et mauvais goût), un ton qu’on ne retrouvera jamais aussi bien justifié par la suite. Difficile d’introduire de nouveaux éléments obscènes et “intimes” une fois que tous les personnages et leurs relations sont installés ; c’est peut-être ça aussi le problème, la difficulté d’avancer en se séparant de ses personnages initiaux : la série se sent comme obligée de continuer à suivre en filigrane les péripéties de A-Train et de l’Homme-poison, alors qu’on aurait avancé par exemple en reproduisant saison après saison ce qui fait le sel de la série : son irrévérence, ses agressions obscènes, certainement pas ses personnages qui, une fois qu’on a compris que les rôles sont inversés, n’ont plus rien d’original. On entrevoit le paradoxe : s’attacher à des personnages sur la durée (des saisons) alors que dans un même temps, on sabote leur importance, leur dignité, leur probité, et la sincérité de leur héroïsme supposé. Les « méchants » (ici, agresseur sexuel et meurtrier), il ne faudrait pas avoir de remords à s’en séparer.
On tombe alors peu à peu dans la routine d’un univers devenu trop sage et dichotomique, en suivant tous les clichés des films de super-héros, en particulier celui, mis en évidence au fil des révélations sur la manière dont l’univers s’est construit, de l’existence d’un complot fomenté par une société secrète (ou privée, Vought) au profit d’un groupe restreint d’individus contre l’intérêt général de la société… Malheureusement, si l’idée de départ était séduisante, le ton finit piteusement par reproduire ce qu’il était censé dénoncer ou ridiculiser au départ, du moins tel qu’il était compris au début de la série. Au fil des épisodes, il ne cesse de s’édulcorer, soit par habitude, soit par incompréhension, soit par paresse : on réalise qu’au contraire d’une véritable satire du genre, la série ne fait qu’inverser les rôles. Les super-héros deviennent les méchants, et leurs victimes, sorte d’agence tout risques multiethnique pour contenter les spectateurs de la planète entière, deviennent les héros sur qui retombe la responsabilité de les éliminer ou de les révéler tels qu’ils sont à leur public. On inverse les rôles, et le discours habituel sur les héros (censés être les bons ou les vrais), lui, perdure. Blanc bonnet et bonnet blanc.


La déception au fil des épisodes est telle, qu’on se demande en réalité si la proposition de départ de moquer et de faire une sorte de satire des films de super-héros ne repose pas uniquement sur cette inversion des valeurs et des rôles : on se retrouve au final avec une série reproduisant à l’identique toutes les habituelles recettes du genre auxquelles on avait sans doute pensé à tort qu’elles ne seront pas employées au profit des héros révélés que sont les Boys sans proposer en réalité autre chose pour assaisonner la série que de l’humour trash pour nous maintenir faussement dans l’idée qu’on était face à une satire des films de super-héros. S’il s’agit bien d’une satire, la série tomberait alors dans le piège le plus commun du genre : reproduire ce qu’on dénonce. Et si cet aspect est peut-être plus assumé ou évident dans la BD originale (que je n’ai pas lue), il a en tout cas été vite aspiré, largement édulcoré, par les nécessités et les habitudes de production hollywoodiennes.
Sont exploités alors toutes les facilités, tous les passages obligés qui contenteront sans peine le spectateur, et tous les clichés de la construction des personnages du héros américain traditionnel depuis que le cinéma du XXᵉ siècle en a largement répandu le modèle à travers la planète :
— recours récurrent à la vengeance (qu’elle soit celle de super-héros ou de super-normaux, le calque est rigoureusement identique et appliqué à tous les personnages).
— les failles traumatisantes du passé réanimées par le méchant pour faire souffrir le héros (le « boys » ou le gentil « supe »). Passé, identité ou intentions cachées suggérés par petites touches devront ainsi forcément faire l’objet d’une révélation, d’un dévoilement futur…
— posture du héros qui se sacrifie pour ses comparses lesquels ne sont évidemment pas d’accord. Si les super-héros sont trashs, les « supes gentils » et les « boys » récupèrent bien tous les clichés des personnages auxquels on voudrait nous forcer à nous identifier. Ainsi, ces héros ont tous des vices, mais ces vices sont censés être leur fardeau : stratagème habituel pour les rendre encore plus sympathiques. En réalité, sont interdits tous les éléments de caractère susceptibles de les rendre antipathiques ou problématiques, tous contours troubles forçant notre intelligence ou notre suspension de jugement dans un exercice prohibé dans le divertissement à l’américaine : le doute, le questionnement. Tout ce qui dépasse est supprimé, exactement comme dans n’importe quel autre show. Où est la logique de faire une série pour critiquer aussi ouvertement les super-héros si c’est pour refourguer tout l’arsenal habituel des thématiques héroïques propres aux divertissements us qu’ils soient héros super ou non ? On remarquera d’ailleurs l’importance de l’interprétation des acteurs pour s’assurer que leur personnage, même écrit sans ces aspérités, sont capables de ne jamais exprimer le moindre sentiment les faisant basculer de l’autre côté de la force (pour un acteur : devenir antipathique). Si on regarde Butcher, par exemple, en plus des nombreux vices qui forgent son personnage, malgré son caractère bougon et souvent autoritaire, malgré toutes les couilles qu’il fait à ses partenaires, l’acteur parvient à le rendre sympathique en ne le faisant jamais basculer vers la haine, le mépris ou tout autre sentiment qui casserait ce lien qu’il a crée avec le public. Si son personnage peut ponctuellement ne pas tenir ses promesses par exemple, l’acteur a bien compris l’enjeu pour son personnage de se sacrifier pour ses « amis » ou pour mener à bien sa vengeance personnelle. Garder le cap n’est pas forcément évident, et on peut remarquer le manque d’audace de la production et / ou de l’acteur à chercher en permanence à préserver le capital sympathie du personnage principal de la série… Pas si trash ou irrévérencieux que ça finalement.
— le nouveau venu qui dans un camp comme dans l’autre questionne (ou fait mine de le faire) la légitimité du groupe qu’il vient d’intégrer (par la force des choses : Hughie ; ou par vocation : Stella). On remarque d’ailleurs que ce principe ne peut s’appliquer qu’aux premiers épisodes de la première saison, car une fois que la série a établi des personnages récurrents et fabriqué de toutes pièces des vedettes (en reproduisant les systèmes sociaux des élites du monde du divertissement que la série « dénonce »), plus question soit de les supprimer (ou au compte-gouttes : un dilemme de distribution, une saison sur l’autre, similaire à celui auquel est confronté n’importe quel soap opera) soit d’en introduire d’autres. Bref, le ronron habituel des séries qui ne savent pas se réinventer ou assumer les pistes pleines d’audace et de promesses entraperçues dès les premières minutes du show.
— rapport conflictuel à l’autorité et à la force. Est-ce que la puissance est légitime si on pense qu’elle est juste ? mais juste par rapport à qui… ? Dilemme déjà posé dans les récits de super-héros depuis belle lurette, illustré par la fameuse maxime de Spiderman : « de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités », et qui est réemployé dans la série exactement à la même sauce, pas la moindre tentative de proposer le sujet (à défaut de pouvoir en aborder d’autres) sous un angle nouveau.
— la cupidité. En dehors des profits de la société Vought, une caractéristique essentiellement présente chez les “supes” à travers le thème de la popularité avec l’ambition permanente chez eux d’atteindre les sommets de ce qui est considéré comme le gratin social : les 7. Un vice auquel on oppose la vertu des « boys » : eux ne sont animés que par des ambitions soit perçues comme vertueuses, soit sources de dilemmes internes, comme la vengeance. Même le plus puissant des 7, Homelander, n’agit pas en suivant une idéologie, mais par simple nécessité de légitimer son existence ou d’être tout bonnement aimé, ce qui, dans la logique de son personnage constitue une marque de cupidité (ce sujet sera creusé au fil des saisons en se rapprochant là encore des archétypes du genre : solitude liée à son enfance, méchant capricieux et imprévisible, avec peut-être le seul écart par rapport à ses prédécesseurs en le rapprochant plus d’un Donald Trump que d’un méchant psychopathe calculateur ; ce que Homelander peut pourtant être aussi quand il est à l’origine des « super terroristes », signe que le télescopage entre l’époque où a été écrit la BD et les références contemporaines à un leader surtout caractérisé par son idiotie n’est pas non plus cohérent quand on pense la série dans sa globalité).


La série, malgré ce recours systématique à des recettes qu’on a cru dans un premier temps être dénoncées ou moquées, reste agréable à regarder, mais malheureusement encore, il semblerait que la forme peine très vite à intégrer les promesses des critiques du genre (celle-ci, je le pense, bien réelles) faites dans le scénario à ses débuts ou dans la BD, jusqu’aux saisons suivantes qui perdent de plus en plus de vue ces audaces initiales : un peu comme si, à l’image de For All Mankind, la réalisation et la production ne suivaient pas et utilisaient au premier degré toutes les recettes et mise à distance critique des idées soulevées dans la matière originelle de la série.
En plus d’adopter, à l’insu de son plein gré sans doute, tous les sujets caractéristiques du genre, la série est ainsi structurée pareillement dans sa mise en forme comme n’importe quelle série de super-héros ou même comme une vulgaire série us en en reprenant exactement tous les codes :
— cliffhanger et climax obligatoires pour chaque fin d’épisode et de saison.
— effets sonores et musiques d’ambiance qui n’ont pas changé depuis au moins vingt ans et qui interviennent aux mêmes moments cruciaux pour souligner la tension, l’émotion ou ponctuer l’action de l’épisode.
— recours permanent et même systématique à la fibre sensible. C’est même le propre des divertissements hollywoodiens : chaque pause en parallèle de l’intrigue principale sert à développer les relations passionnelles entre les personnages, et ainsi attirer l’empathie du spectateur. Jamais rien de plus profond, de thématiques non émotionnelles/relationnelles, et surtout les méthodes pour y parvenir sont formatées dans ce moule que pourtant la série semblait vouloir éviter dans ses premiers épisodes. Même pour ce qui est de l’atout principal de la série, l’humour trash, sexuel et sanglant, cela se normalise, car cela touche de plus en plus rarement les personnages principaux et leur évocation est purement cosmétique et décoratif : ils ne sont plus essentiels dans la trame dramatique élaborée pour la saison — ce qui n’était pas le cas dans la première quand le viol initial de Stella constituait un élément essentiel du récit ou quand le traumatisme de son futur amoureux face à la mort brutale et soudaine de son ex pesait encore sur la saison. On enlève le passage obligé du vocabulaire et des petites séquences trash, et on a là le calque parfait d’un film de super-héros dont le principal superpouvoir semble surtout être celui d’être super sympathique, même, et souvent grâce, à ses travers. Il serait certes idiot et peu crédible de reproduire certains traumatismes initiaux afin de pouvoir déclencher des nouvelles boucles narratives dans lesquelles les personnages principaux seraient réellement impliqués, mais cette impossibilité de trop toucher à ces personnages rend d’autant plus inutile et futile la nécessité de multiplier les saisons. Dans le serial, on accepte la possibilité de « nouvelles aventures » par le biais de nouvelles missions ou par l’intervention de nouveaux méchants, mais dans une série qui repose essentiellement sur l’inversion des valeurs et le trash, le contrat peut difficilement être le même.
— fibre sensible toujours, avec des amourettes obligatoires pour tous les personnages récurrents avec conflit sur les mensonges des uns et des autres pour créer une tension interne sans forcément de rapports ou de conséquences sur la trame principale (avec là encore les mêmes recettes émotionnelles employées sans fin). Écris une histoire ambitieuse, critique de la société, du divertissement, et cette société à qui tu vendras l’adaptation de ces idées pleines d’audace travestira vite ça en « Supe Opera ».
— conflits toujours et oppositions à l’intérieur du groupe et de la famille qui n’ont pas changé depuis au moins… Alien. On a le même souci dans l’univers Star Wars où à force de vouloir reproduire les mêmes schémas pour chaque relation, on fait vite le tour parmi les personnages principaux, et on en vient à porter son attention jusqu’au moindre personnage d’arrière-plan qui paraissait mystérieux jusque-là justement parce qu’on s’était bien gardé de trouver un sens à sa vie, à lui créer des attaches, une histoire, des sentiments. C’est l’effet Boba Fett : après la tentative de Lucas de faire du chasseur de prime le modèle pour ses clones, Disney se sert à nouveau de son image hiératique, quasiment mutique, pour créer les Mandalorians (et pas qu’une fois d’après ce que je peux voir). À chaque fois avec le même résultat : une coquille vide. On ne sera donc pas étonné si un jour Amazon Prime propose une série à part entière sur Black Noir dont la principale réussite serait de casser et de démystifier (en mal) l’aura que peut encore avoir son personnage après quelques épisodes. Le type est à la fois cool et ridicule justement parce qu’il est impassible et impénétrable ; dès qu’on tente de l’incorporer dans la soupe habituelle du show en en développant l’histoire, il fend l’armure, et son personnage finit d’être drôle ou intriguant (c’est ce qui se passe dans la troisième saison). Etc.
Dans les grandes lignes, reproduire ces recettes, ce serait peut-être pas tant que ça un problème, toutes les séries y ont recours. Mais en réalité, chaque détail et seconde de la série répond au grand cahier des charges du divertissement hollywoodien, et plus particulièrement à celui des films de super-héros. Un comble. Et une déception. Parce qu’au vu des premiers épisodes, on n’en attendait autre chose… Le paradoxe vit mal, et on l’accepte de moins en moins, épisode après épisode. On peut ainsi noter par exemple le symbole et le cynisme presque de voir la série distribuée sur la plateforme de l’une des sociétés internationales les plus en pointe en matière de casse sociale et environnementale… Un modèle typique de multinationales pourtant brandit souvent dans les films de super-héros comme un épouvantail (on retrouve le même paradoxe qui avait fait l’objet d’une ou deux séquences dans le dernier Matrix). Le capitalisme est prêt à avaler n’importe quoi, surtout le plus politiquement incorrect, le plus contestataire, violent, immoral ou indécent pour s’en approprier les caractéristiques ou mérites, y extraire les quelques spécificités afin de séduire son public, avant de le remâcher à sa manière, le répliquer comme on réplique une rente, un dividende, et lui ôter jusqu’à l’absurde ou jusqu’au paradoxe tout ce qui en faisait l’essence. Dénoncez les principes de la société à laquelle vous appartenez, celle-ci arrivera toujours à s’approprier votre critique. Black Hole Noir… Les gros finissent par tout manger, même ceux censés faire leur critique.
Paradoxalement, là où la série réussit peut-être un joli tour de force (du moins dans sa première saison et colle ainsi tout à fait encore à For All Mankind), c’est de voir que pour répondre au politiquement correct général de notre époque, non seulement les femmes se font rarement malmener par les hommes (elles ne se font plus faire, en dehors de l’agression dont est victime Stella lors de son bizutage des 7 : son agresseur se fera lui-même régulièrement tancer, notamment par une femme venant lui fouiller les branchies ; le Frenchie, lui, a une petite amie plutôt du genre tatillonne, et des relations « professionnelles » avec une Russe ne sont pas non plus à son avantage), mais aussi presque la quasi-totalité des postes à responsabilité qui aurait pu tout autant être occupés par des hommes le sont par des femmes : la directrice du FBI, celle qui gère les super-héros et en enfant en bas âge, celle qui avait initié en premier la lutte contre la firme Vought et qui avait constitué ce groupe de bras cassés inspiré de l’Agence tout risque, la politicienne exploseuse de tête, etc. Malheureusement, nombre de ces femmes se feront plus ou moins vite zigouiller (parfois même remplacer par des hommes). Reste que le plus réussi sans doute est que leur autorité n’est pas discutée (tout juste cela fait l’objet d’un léger complexe chez les hommes habitués à se poster comme des protecteurs avec les femmes, ici, plus coriaces qu’eux). Au même poste, elles se révèlent avoir ni plus ni moins les mêmes comportements (vices et autorité) que les hommes.
Ironique de voir que là où la série marche aussi le mieux, c’est précisément dans le politiquement correct…
L’inclusivité marche moins bien, en revanche, avec Frenchie et Kimiko : l’un est essentialisé (par son surnom d’une part, puis par ses talents culinaires, quelle originalité pour un Français ; on remarquera d’ailleurs qu’il est peu probable que l’acteur soit francophone : à en croire ses interventions peu naturelles et sa prononciation par exemple de « mon cœur » assez pénible), l’autre est muette (cliché de l’Asiatique avec qui la communication est impossible, présent dans Lost si je me rappelle, avant que le même personnage retrouve la parole, un peu comme l’indigène dans L’Oiseau de paradis qui apprend peu à peu la langue civilisée des Américains, et un cliché qu’on retrouve encore dans les westerns avec des Indiens). Les deux autres personnages principaux du groupe s’en tirent mieux : le Britannique dans un personnage calqué sur Wolverine, et le Noir robuste mais minutieux et réfléchi. (L’ingénu étant laissé pour une fois à l’Américain : même si on peut considérer que le John Doe, l’Américain moyen, est en soi un archétype assez peu marqué pour son originalité, il y a une logique à l’opposer à l’archétype trumpesque de Superman et à l’inclure dans une série sur les super-héros.)
Après toutes ces promesses non tenues, on en viendrait presque à se demander s’il n’aurait pas mieux valu se contenter de suivre les premiers épisodes en se gardant bien de tomber dans le piège du spectateur devenu attaché aux personnages et soucieux, comme dans n’importe quelle série, du devenir de ses héros… Est-ce que finalement le courage et le sens du sacrifice tant glorifiés dans la série, ce ne serait pas d’arrêter de s’infliger ces conneries quand elles ne font que se répéter ? Allez, j’arrête ? Demain, je mets le costume au placard…