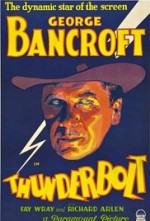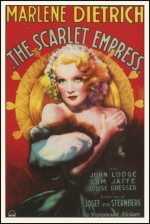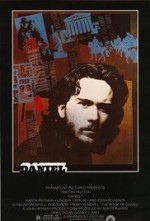Coup de foudre


Les Damnés de l’océan
Titre original : The Docks of New York
Année : 1928
Réalisation : Josef von Sternberg
Avec : George Bancroft, Betty Compson, Olga Baclanova
— TOP FILMS —
Revu à la tek et même plaisir qu’il y a deux ans. On y retrouve un petit quelque chose de Borzage de la même époque. Un pré-noir comme on dirait aujourd’hui. Assez peu de décors, mais une excellente gestion des espaces (notamment dans la taverne et dans la chambre).
J’ai souvent dit que le bon Josef était un directeur d’acteurs médiocre, mais parfois il faut peu de choses. Réunir deux acteurs exceptionnels et attendre qu’une certaine alchimie s’opère. George Brancroft et Betty Compson sont parfaits. Tous deux jouent des archétypes (préférable dans le muet) : le grand musclé au cœur tendre (ou attendri) et la suicidaire tombant sous le charme « de son hommeuh ». Les deux acteurs arrivent à proposer autre chose que ce que réclame leur personnage respectif. Et à jouer la même musique. Si le charme opère entre eux, et nous, c’est bien qu’ils savent créer une connivence essentiellement faite de dérision ; de cette dérision entendue susceptible de vous convaincre que vous êtes embarqués dans le même bateau, parfois seuls contre les autres ou les aléas de la vie.
George Bancroft câline du regard sa partenaire et l’amuse en jouant de son personnage : il en fait trop, fanfaronne, mais l’œil toujours posé sur sa belle, on comprend que c’est pour mieux être attentif à ses réactions. La connivence est là, il pourrait lui dire : « Tu vois ce que je veux dire, Bébé ? Je joue les durs, mais j’ai le cœur tendre. » Muet ou parlant, même musique, c’est l’art du sous-texte, le charme du non-dit, pas de celui qui vous fait suspecter l’autre d’intentions malveillantes, mais celui qui vous convainc que les regards disent mieux que les mots. Et, dans la vie comme à l’écran ou sur les planches, on se met en avant en mettant l’autre en avant. On ne voit que celui qui sait regarder, autrement dit celui qui oublie sa propre présence, ses artifices, ses vaines tentatives de devenir ce qu’il n’est pas, et qui ne voit que l’autre.
Et quand les deux jouent en même temps la même musique, quand l’un rentre dans le jeu de l’autre sans difficulté, dans la vie on appelle ça un coup de foudre, au cinéma, ce sont des miracles. On ne joue plus, on s’amuse, on vit, on se dévore des yeux, on s’oublie pour mieux imprimer l’image de l’autre. Et la connivence, c’est la danse de tâtonnements qui précède la certitude d’être faits l’un pour l’autre : regards en coin ; bouche qu’on plisse pour réprimer un sourire ; œil qui frise que l’on masque en haussant les sourcils ; regard qui fuit pour mieux voir si l’autre se laisse appâter… L’amour, comme la connivence entre deux acteurs, ça se joue là. Deux pêcheurs partis sur les mêmes rives, envoyant des hameçons au hasard, puis en direction de l’autre. On fait alors semblant de se retrouver là, mais on provoque le hasard en attendant un signe de l’autre. Signe après signe. Mais parfois, il arrive que les préliminaires à la séduction se résument à peu de choses tant l’accord se fait aussitôt. C’est ce qui arrive ici.

Betty Compson, la connivence, elle sait y faire. Elle donnait le ton dès leur première rencontre en plaisantant, un peu amère (avec une sorte de défiance pleine de curiosité pour cet animal), sur le fait de l’avoir sauvée. Cette image de la femme d’après-guerre est une révolution : avachie dans le lit d’un autre, c’est elle qui tient la barre. Elle fume, toise, provoque, plaisante, l’allume pour mieux sans doute pouvoir lui résister. Parce que la séduction est aussi un jeu, même quand tout semble joué au premier regard, il faut se remettre en piste. Danse nuptiale sur le quai des brumes. À l’ironie un peu protectrice et naïve du personnage de George Bancroft, elle répond par une effronterie typique des années folles. Pas dupes, ces femmes-là ont pris les commandes du monde. Pas dociles ou farouches pour un sou, ce sont les « it girl », les croqueuses, les femmes qui en ont, les ambitieuses, mais aussi, à l’image du personnage féminin de City Girl, les désillusionnés. Les antihéros n’ont pas de sexe. Alors si le code Hays fera de la femme émancipée une mante religieuse dont les honnêtes hommes devraient se méfier, c’est ici, dans ces images, dans cette insolence, cette autorité, cette aisance, qu’il faut voir l’émergence de la femme moderne. Cette femme n’est pas encore celle du féminisme combattant, mais celle qui n’a pas besoin de lutter, de forcer sa nature, pour nous convaincre qu’elle danse sur un pied d’égalité avec les hommes.
Dans ce jeu de séduction permanent, si le couple marche à merveille, c’est qu’ils ne cessent de s’attirer et de se repousser (on connaît bien le procédé de nos jours avec le couple Leïa-Solo ou Mulder-Scully). L’idée, c’est que si très vite, ils comprennent qu’ils pourraient être utiles l’un pour l’autre, et s’ils procèdent à un mariage express, le charme de l’amour, de l’assortiment des couples, c’est souvent plus une construction de l’après. On séduit, on vit, on s’est trouvés… et l’enjeu est là : continuer de conquérir le cœur de l’autre. Car même une fois accordés sur l’essentiel (se mettre ensemble, se marier), on n’a encore rien vu. La vie de couple est une comédie du remariage permanente, et le film nous condense tout ça en quelques scènes : la séduction, le mariage, la séparation et le remariage. À l’époque, on parlait de mélodrames. Aujourd’hui, on évoquerait plutôt la comédie romantique. Une caractéristique toutefois sépare ces deux notions : la noirceur. C’est au moins là un point que j’attribuerais volontiers à Josef von Sternberg. Le mélodrame est mort, à tel point qu’on refuse même désormais de le considérer comme un genre à part entière. D’un genre autrefois mineur, le mélodrame est passé à la trappe, ou à la guillotine (séparant « mélo » — qui a la même valeur péjorative qu’à l’époque — et « drame » qualifiant le plus souvent le film). Parce que c’est noir, esthétiquement abouti, on en fait un drame, ou un pré-noir… Étrange époque où la pornographie est acceptée de tous et où l’indécence ultime est de parler de mélodrame.


Un exemple pour illustrer le travail de deux acteurs (un « jeu de scène » qui tiendrait plus de la mise en scène, mais comme Josef von Sternberg propose habituellement un travail statique avec les comédiens, y préférant les travellings d’accompagnement, je mets bien ça sur le compte des deux acteurs). À l’instant où le personnage de George Bancroft décide de marier sa belle « sur-le-champ », celui de Betty Compson traîne littéralement des pieds, Bancroft la tire à l’autel improvisé dans la taverne. Et là, si déjà le jeu des corps, loin de la pantomime (c’est du théâtre, du bon, voire de la chorégraphie : les gestes sont théâtraux parce que les personnages le sont et rien n’est excessif dans les postures ou les attitudes), dit tout de la situation, ce qu’il faut voir en réalité, c’est le contrepoint qu’offre l’actrice pendant qu’elle se fait tirer. Son corps « dit non ». Mais son visage trahit son cœur. Elle est heureuse et sourit de ce qui lui arrive. Peu de temps après, on retrouve le même principe, mais inversé : retournant vers leur appartement, c’est elle qui le traîne cette fois sur la passerelle pour profiter des brumes de l’amour…
Ces deux-là étaient faits pour s’entendre. Rarement, on aura vu couple aussi sympathique au cinéma. Sans doute parce qu’ils sont imparfaits, qu’ils sont remplis de failles, et qu’ils font le choix de changer leur plan, sur un coup de tête, et de voir si le destin qui les a réunis avait un projet pour eux. C’est qu’il y a des petits drames, des expériences communes, qui créent des liens. Quand l’un sauve l’autre, c’est inévitable. La ficelle est un peu grosse, mais on est au port et les cœurs qu’on amarre se font facilement la malle. Et mille sabords, ces deux-là, on a envie de les aimer ! Il y a des rencontres improbables qui vous changent la vie. Des affinités forcées. Et des bonheurs auxquels on consent. Finalement.
(Josef von Sternberg avait une affection particulière pour les travellings latéraux, d’accompagnement, avec toujours le petit jeu des éléments de décors se découvrant au premier plan…)




Les Damnés de l’océan, Josef von Sternberg 1928 The Docks of New York | Paramount
Vu le : 6 février 2014 (9)
Revu le 3 septembre 2016 (tek) Rehaussé 10
Listes sur IMDb :
✓
✓
✓
Si vous appréciez le contenu du site, pensez à me soutenir !
Réaliser un don ponctuel
Réaliser un don mensuel
Réaliser un don annuel
Choisir un montant :
Ou saisir un montant personnalisé :
Merci.
(Si vous préférez faire un don par carte/PayPal, le formulaire est sur la colonne de gauche.)
Votre contribution est appréciée.
Votre contribution est appréciée.
Faire un donFaire un don mensuelFaire un don annuel