Belle unité. Le récit est maîtrisé, c’est propre, précis, droit, sans fioritures. Soderbergh donne vraiment l’impression de savoir ce qu’il veut. Jamais il ne dépasse les contours définis du contexte dramatique ; la trajectoire narrative demeure étroite et inflexible ; le cinéaste s’applique à ne représenter qu’un seul sujet, celui, parfaitement défini dans le titre.
Et pour coller à son sujet, Soderbergh emploie des procédés d’identification qui permettront au spectateur d’être comme fasciné par le jeu de dévoilement qui se joue devant ses yeux. L’interprétation hyperréaliste va dans ce sens tout en évitant les écueils de l’insignifiance et de la banalité du quotidien.
Les acteurs s’emploient à composer des personnages justes et cohérents tout en participant à leur offrir, dans l’instant (matière si précieuse chez un acteur), une retenue et un mystère qui poussent le spectateur à s’interroger sur les motivations (quand on n’a rien à cacher, quand nos intentions sont claires, que le sous-texte est inexistant, on ne transmet rien sinon des lignes de textes et une situation préétablie par le scénario et les dialogues comme chez un Bresson ou un Rohmer par exemple). L’empathie — la fascination naturelle du spectateur pour ses « héros » — est facilitée par le sujet même du film.
La sexualité se donne à voir, mais ce ne sera pas sans mensonges, et là où on perdrait sans doute beaucoup à montrer, on gagne à raconter, et à tromper. La sexualité, ce qu’il y a de plus intime en nous, opposée à ce qui l’est le moins, l’exposition, le témoignage, rendue possible par de nouveaux artifices technologiques : ce qui fascine alors, c’est l’espace flou séparant les deux extrémités, la manière dont le point pourra se faire, se focaliser, se révéler, non sans trucage, sans perversion, sans menace de trahison.
Quand on se dévoile, on ne cherche rien d’autre qu’à être vu, mais être vu seulement, c’est un pari qu’on fait, celui de ne jamais être percé à jour ; et celui qui regarde, dirige, scrute, cherche au contraire à opérer celui qui se montre, à le diriger vers des pièges pour le voir toujours un peu plus à nu ; comme un jeu de strip-tease où on ne sait jamais avant la fin qui gagne, de celui qui se montre ou de celui qui regarde. La caméra n’attire jamais notre attention sur ce qu’on voudrait voir et qu’on ne voit jamais. L’espérance jamais assouvie ; l’horizon montré du doigt et jamais à portée de main. La distance, toujours, entre ce qui nous est le plus personnel et qu’on voudrait dévoiler chez celui qui s’expose, et l’incapacité pourtant d’y trouver entière satisfaction. Parce que chacun ment et joue.

Le style de la photographie témoigne de la qualité « indépendante » du film. Une indépendance qui permet sans doute des audaces et une créativité impossible dans un cinéma « commercial ». Cela implique, et suggère déjà à travers la pellicule, qu’on a affaire non pas à un film qui cherchera à satisfaire nos attentes misérables de spectateurs, mais que le film proposé est livré par un auteur seul aux commandes.
Cela renforce fortement l’impression pendant le visionnage que tout est possible, et qu’on ne se perdra pas dans de basses considérations qui poussent trop souvent certains produits à ne rechercher que ce qui va dans le sens du spectateur, de sa morale, de ses envies…
Paradoxalement, cette incertitude, ce risque, force l’attention, provoque la peur, le malaise, et une forme de plaisir étrange qui est la même qu’on éprouve dans des thrillers, les films d’épouvante et d’horreur. Les moyens modestes dépensés pour le film, l’ingéniosité qu’on devine pour le tourner, la sobriété, tout ça concourt à créer une authenticité qu’il serait impossible de rendre dans le confort et les contraintes d’un grand studio.
C’est probablement stupide, mais on n’échappe pas toujours au contexte qui entoure le film et aux préjugés (favorables ou défavorables), et on ne peut être que séduits devant cette maîtrise honnête dont fait preuve Soderbergh pour mettre en scène cette histoire. Quand le sujet est simple, on adopte les moyens qui conviennent : pas besoin de cinémascope, de cinquante décors et autant de figurants. Mais les moyens justes et appropriés. Question de ton, d’alchimie, mais aussi souvent de choix. Quand on dispose de moyens limités, on monte un film en fonction, et on se concentre sur l’intimité d’une histoire, et des acteurs pour donner à voir ce que d’autres ne dévoileront jamais en ayant les moyens de les montrer. Parce que ce qu’on suggère au spectateur, ce qu’il voit dans son imagination, ne se produit pas par la dépense de moyens physiques et finalement visibles sur la pellicule ; le cinéma, encore, ce n’est jamais qu’une histoire racontée, et l’artifice, les procédés, ne sont que des moyens qui ne pourront jamais éclipser le sujet.

Sexe, Mensonges et Vidéo, Steven Soderbergh (1989) | Outlaw Productions, Virgin
La musique aussi témoigne de cette économie de moyens. Il serait si facile, avec un tel sujet, de tomber dans la vulgarité et la facilité. Le volume, les notes, ça ne coûte pas bien cher. Invisible, modeste, à peine perceptible donc. Sans variation, faible, mais présente, comme le vent qui vous lèche l’oreille et vous sodomise les tympans l’air de rien. Une petite brise fluette et douce que les plus malins traduisent en retour et nomment « psychologie des personnages ».
C’est en fait le suintement de notre propre sueur qui s’excite à la moindre note. Une illusion. On n’entend la musique intérieure des personnages pas plus qu’on ne voit leur sexe.
La musique est là aussi pour suggérer et nous laisser imaginer le meilleur. Soderbergh s’insinue furtivement en nous, avec elle, nous dévoile le point G qui s’agite en ligne de fuite entre le sujet et celui qui l’écoute ou le regarde ; et comme il est imperceptible, dans l’air, c’est peut-être aussi un point qu’on écoute parce que notre œil ne parviendra jamais à se fixer sur lui. À défaut de tendre autre chose, c’est donc l’oreille que l’on tend.
La musique, c’est comme le tennis : mettre à portée son adversaire en tentant négligemment le lob, et l’air de rien, éperdus, nos yeux se révulsent et se tendent vers le ciel. On ne se retourne que pour constater les dégâts. Le plus souvent, on ne voit rien venir. La musique est là, mais on ne la voit pas ; elle guide nos pas jusqu’à quelques rares contre-pieds ; elle ne se laisse pas attraper, ni même exposer. Un mystère, déjà un mensonge. Une musique d’ascension.

Toutes ces qualités se concentrent dans un finale admirable : l’enregistrement, l’entretien du grand déshabillage, entre Graham et Ann.
Les séquences qui précèdent ciblent harmonieusement et logiquement vers elle comme une scène attendue et espérée, comme un orgasme dont on ne sait jamais qui en ressortira vainqueur. Alors ? Le mensonge ?…
En attendant la réponse dans la presse coïtienne, la scène est, comme il se doit, longue. Le strip-tease (« dénouement », pour les frileux), plus on l’attend, plus on a faim.
Les variations liminaires achevées, on donne sa langue au chat, et on l’écoute miauler. On se lèche le contour des yeux, on s’en turlupine les babines avant d’y mettre le doigt pour en connaître la saveur ou la direction du vent. Ça feule dans tous les coins, ça grimpe vers les longs sommets, ça chicane de long en large, ça crapahute à cor et à cri, et enfin, on change de position, c’est une révolution. « Permettez qu’on permute ? vos culbutes me fatiguent, madame… » Confidences pour confidences. Ann stram Graham, bourrez bourrez ratatam, Ann stram Graham !…
Tout le film, avec son triangle amoureux, se décalotte sous nos yeux ébahis et nous dévoile enfin son « poteau rose ». Comme la vérité est douce quand on la trouve au bout du chemin sans même l’avoir cherchée.
Le triangle n’était qu’illustration. Une mémoire qui flanche comme le chante Jeanne Moreau. Un souvenir pubien. Et ne compte plus alors que ce dernier revers, ce passing shot, ce coup gagnant de Graham.
« À la fin de l’envoi, je couche ? »

Le finale est génial dans sa lenteur. Les mouvements parfois semblent inexistants, comme si la force des révélations transformait les corps en musique.
Dans le noir, on se concentre mieux, on se dévoile un peu plus. Ne perce plus à l’écran que ce qui était alors invisible. On ne voit qu’un canapé, et par magie, il devient l’expression d’une attente tendue, d’une pensée, d’un secret qui s’étale dans la lumière, avec émotion, et qui demande enfin le noir complet pour s’exécuter. Triste canapé qui ne témoignera jamais rien de ce qu’il a vu, lui.
Le montage s’invite à la fête. Quelques plans successifs qui, comme une lingerie fine, excitent et dévoilent autant qu’ils tiennent à distance.
Ces révélations-là ne sont pas pour nous, elles seront laissées à notre imagination ; elle sait toujours mieux que nous-mêmes quoi en faire. « Que se passe-t-il ? » « Que vont-ils faire ? » Rien, on ne voit rien, quand on élimine l’essentiel et se cantonne aux transitions, comme l’a toujours fait le cinéma.
On est à nouveau happés par la lumière de l’image ; la sonorité sensuelle de ce qui ne perce que dans les fins interstices du dénouement s’est déjà évanouie comme un souvenir las ou une musique des particules ; on se rattache à ce qu’on voit, nous guide désormais ; mais on n’y retrouve rien du rythme débordant passé.
L’âpreté de l’après, l’interrogation du comment et la perspective trouble du regard de l’autre. Et retour à la seule constance du monde : le mensonge. Avec sa lumière et ses incertitudes.
Tout le film est la promesse, l’attente, l’introduction d’une vérité qu’on ne verra finalement jamais, qu’on ne peut voir et nous montrer, car on doit la sentir et l’imaginer.
Elle est là l’opposition entre deux cinémas. La tentation de l’un à offrir du plaisir à des ogres qui en demandent toujours plus, et l’ambition de l’autre à éveiller le désir à des hommes en quête d’un absolu qui les échappe.
Il y a bien quelque chose d’envoûtant dans ce cinéma quand il est maîtrisé. Et ce film l’est parfaitement.
17 mars 1997

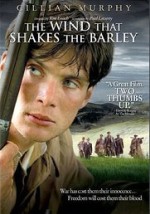
 Année : 2006
Année : 2006








 Année : 1982
Année : 1982




 Année : 1993
Année : 1993



 Année : 1994
Année : 1994
















 Année : 1953
Année : 1953
