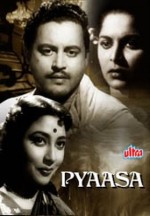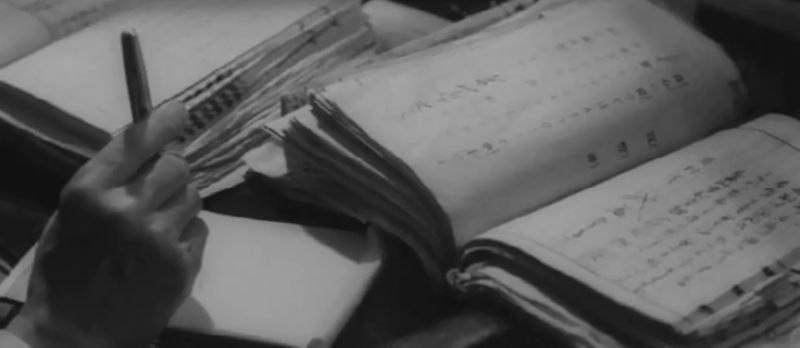Souvent mes amis imaginaires me demandent de leur spoiler les films. J’essaie de m’y atteler le mieux possible, mais je dois avouer que j’oublie trop souvent cette requête et me consacre plutôt à des études vaseuses promises, elles, à mes élèves factices de l’École Marie Laforêt (salut à eux). Mais que seraient des amis, même imaginaires, si on ne prêtait pas attention à eux et ne répondait jamais à leurs attentes ? Après quatre heures de travail, j’achève donc ce spoil médiocre et froid. À tous les lecteurs qui me lisent sans faille, jour après jour, je ne vous demanderai que deux choses : de l’imagination et de la tolérance. Ceux qui n’existent pas apprécieront.
Pour accentuer un peu plus le caractère épique du canevas et archétypal des personnages, j’ai préféré aller au plus simple dans les descriptions :
Une pute, un rônin, et un autre rônin appelé également dans ma retranscription « rônin » mais affublé, lui, presque toujours d’une épouse (non ce n’est pas la même chose qu’une pute). Voilà qui est plus clair. That’s jidaikegi cinema!
Ce spoil reste sans commentaire. Pour une raison simple : cette structure est parfaite. Alors taisons-nous et contemplons la bête.

1/ La pute essaie de charmer le rônin pour qu’il ne voie pas ses poursuivants arriver. Le rônin arrive à fuir : c’est toi qui parles de fierté ?
2/ Le chef samouraï et sa suite trouvent le cheval du rônin. La fille du chancelier assassiné dit à son mari samouraï que les temps ont changé et qu’il faut vite s’adapter aux nouvelles règles.
3/ De son côté le rônin joue son sabre au jeu et lui permet de gagner un peu d’argent avec son domestique et rencontre brièvement des prospecteurs d’or.
4/ Le rônin se cache dans une auberge et se prépare pour l’assaut. L’aubergiste va immédiatement prévenir les samouraïs qui décident d’attaquer. L’aubergiste revient, tout tremblant, et le rônin se doute qu’il a été trahi comme il le prévoyait et qu’il va être attaqué.
5/ L’attaque. Le rônin met en échec ses poursuivants et se réfugie sous une charrette conduite par son domestique qui est questionné par les samouraïs avant de prendre le large.
6/ La fille du chancelier en veut à son mari et lui dit qu’il hésite à tuer le rônin, car ils étaient autrefois amis. Elle lui rappelle qu’il a tué son père : Flashback des désaccords entre le rônin et le chancelier. Le rônin avec des amis a fait une pétition pour réclamer de nouvelles méthodes au shogun pour s’adapter à la nouvelle situation du pays. Il refuse. Pour ne pas se faire hara-kiri, les samouraïs le tuent, devant sa fille. Pour la fille du chancelier, il n’y a pas de pitié à avoir envers un tel traître, et son mari lui rappelle que c’est tout de même un samouraï. Elle lui rappelle ce qu’il a gagné en se mariant avec elle.
7/ Le domestique du rônin lui dit qu’il a trouvé un corps dans la rivière avec une bourse remplie d’or. Pas étonnant dit le rônin, revenu sur les lieux de son enfance, cette région est pleine d’or et attise les convoitises.

8/ Un orpailleur et sa femme sont interrogés par le clan local qui les attaque quand l’orpailleur lui dit qu’il n’a pas l’intention de le partager au shogunat. Il les tue.
9/ Le rônin et son compagnon trouvent les corps dérivant dans la rivière : ce sont des samouraïs importants, donc ça veut dire des problèmes. Son compagnon se met à chercher l’or, mais son maître lui dit que ça n’a aucun intérêt.
10/ La femme de l’orpailleur s’inquiète de tous ses morts car ça veut dire que le shogunat va les faire arrêter si ça se sait. L’orpailleur répond froidement que leur clan ne les abandonnera jamais.
11/ Des villageois trouvent un autre corps à la dérive plus en amont mais celui-ci est encore vivant mais blessé. Ils le ramènent à l’auberge.
12/ Une prostituée se propose de le réchauffer et demande pour cela que les villageois sortent. Elle tente de le tuer. À ce moment le rônin arrive. Tué délibérément.
13/ Un peu plus tard, la prostituée rejoint le rônin aux bains lui disant qu’elle veut lui montrer sa gratitude, alors qu’elle est venue le tuer.
14/ Le lendemain le rônin repart sur les routes et la prostituée le suit (il lui a laissé la vie sauve). Il lui demande pourquoi il a tué cet homme, quel était leur lien. Mais elle ne répond pas. Il lui demande de ne pas le suivre.
15/ Plus loin près de la rivière l’orpailleur continue son travail malgré les doutes de sa femme. Il lui dit qu’ils ont une mission. L’or doit sauver leur clan. Flash-back : le chef de clan de l’orpailleur lui promettant de devenir samouraï et un poste s’il ramène cet or.
16/ Le rônin retrouve l’orpailleur et sa femme et lui demande pourquoi il a tué tous ces hommes. Il répond qu’il tue tous ceux qui s’approchent. Le rônin comprend et s’en va lui disant qu’ils se reverront.
17/ En partant le compagnon du rônin lui demande ce que c’est que ces personnes. Le rônin lui répond que ça ne leur regarde pas. L’autre dit qu’ils prennent l’or sur le dos du gouvernement. Le rônin répond que c’est tout ce qu’il y a à savoir. Son compagnon croit alors qu’il en veut à leur or et qu’il pensait d’abord gagner son or honnêtement. Son maître lui répond qu’il est une bête sauvage, que c’est lui qui décide quand il attaque son ennemi et pourquoi ; sinon il se laisse guider par les événements et c’est son ennemi qui décide. « Choisis bien tes amis et tes ennemis ».

18/ Des brigands s’en prennent à la femme de l’orpailleur et lui demandent de leur remettre son or sinon ils tuent sa femme. L’orpailleur refuse. Les brigands le menacent alors de violer sa femme. Et l’orpailleur ne réagit toujours pas.
19/ Le rônin vient à leur aide. Il tance l’orpailleur sur ses choix. L’autre répond que ces montagnes sont faites pour des monstres.
20/ À l’auberge les samouraïs du shogunat trouvent la trace du rônin et demandent où il est parti. Dans les montagnes lui répond-on. La prostituée entend tout.
21/ Le compagnon du rônin cherche un peu d’or dans la rivière et dit à son maître qu’il savait bien qu’il n’avait rien d’un monstre quand il est allé sauver la femme. Mais le rônin dit qu’il a bien été clair : qu’il reviendrait non pas pour la femme mais pour l’or. L’autre lui répond qu’un monstre ne l’aurait pas prévenu de ses desseins et lui dit que s’ils veulent éviter de lui voler l’or il ferait bien de commencer à chercher de l’or. Son maître lui répond d’arrêter ça.
22/ À la hutte de l’orpailleur sa femme refuse de travailler. Il lui demande de le faire mais lui demande s’il la considère encore comme sa femme… Du coup elle part et trouve le rônin. Elle se propose à lui, elle veut devenir une bête comme lui, d’abord intéressé, il refuse : il apprend qu’ils sont là pour une mission, ils travaillent pour leur clan.
23/ Le rônin se rappelle comment lui aussi était assujetti à son clan : le chancelier lui a d’abord fait croire que certaines réformes seront acceptées. Le rônin dit que les clans qui se sont adaptés sont désormais plus riches qu’avant. Retour avec la femme : le rônin dit qu’ils ont cru le sous-chancelier et qu’ils ont accepté de tuer le chancelier en croyant que ça résoudrait le problème. Retour au flashback : en revenant voir le sous-chancelier celui-ci lui dit qu’il n’a jamais demandé le meurtre du chancelier et qu’il va être poursuivi pour cela – ses complices ont déjà été tués. La femme lui dit qu’il a été poussé à être un monstre, il ne l’est pas devenu. Le rônin lui dit qu’il ne la force pas à la rejoindre, mais si elle veut suivre la voie des monstres, elle doit d’abord en informer son mari.
24/ Elle retourne voir son mari. Celui-ci veut d’abord la mettre à mort avant de tomber dans ses bras.
25/ Le rônin retrouve l’orpailleur et lui épargne la vie après avoir gagné son combat. Il lui demande pourquoi. Le rônin dit qu’il est juste venu le prévenir que les hommes de son clan viendraient bientôt s’emparer de son or. Il lui demande s’ils savent qu’ils sont ici ? Le rônin répond que la prostituée leur a dit. Il ne pourra pas l’aider à fuir une fois qu’ils seront là. L’orpailleur comprend et lui révèle son nom, mais ne peut lui dévoiler son clan. Peut-être se retrouveront-ils un jour. Le rônin répond peut-être, mais il doit aussi filer car ceux qui sont à sa poursuite ne sont plus loin.
26/ Plus loin donc la fille du chancelier et son mari suivent la trace du rônin. La femme est exténuée mais tient à continuer. Elle demande à son mari pourtant d’y aller seul. Il part.
27/ Près de la rivière, le compagnon du rônin lui dit que c’est du gâchis de partir maintenant, sans or. Le rônin lui répond que leurs poursuivants ne sont plus loin. Pourtant le plus fort a été tué, pourquoi en avoir peur ? Parce que celui qu’il craint le plus, son ami, est encore vivant. Mais lui, veut-il rester ici ? c’est qu’il y a beaucoup d’or et il n’est pas recherché ! Mais pour le rônin la vie a plus de valeur que l’or.
28/ C’est alors que son ami les retrouve. Il lui dit que le maître du shogun a été tué et qu’il ne reste plus que lui. Sa fuite s’arrête ici… Il lui dit qu’il peut encore regagner son honneur en se faisant hara-kiri (ou presque).

29/ Entre-temps, sa femme se fait attaquer par des brigands. Le compagnon du rônin vient les prévenir… Ils vont l’aider mais c’est déjà trop tard. Le compagnon dit qu’elle hésitera désormais à le chasser maintenant qu’ils l’ont sauvé. Mais le rônin lui dit de bien la regarder, c’est bien la fille d’un samouraï, rien n’a changé.
30/ Le chancelier avec ses hommes arrive enfin et dit « Je veux et Shakespeare d’exquises excuses ! ». Et comme il ne parvient pas à le dire sans faute, il réfléchit et dit « Tuez-les tous ! » (Ça doit être Shakespeare qui lui a soufflé l’idée).
31/ Le rônin s’apprête à partir mais la prostituée vient le voir et lui dit que c’est un piège. Les hommes de son clan l’y attendent. Il se méfie et lui demande pourquoi il l’aide : ne travaille-t-elle pas pour le clan ? Elle répond que trop de monde a vu son visage, elle ne sait pas ce qu’il va advenir d’elle : tous ceux qui sont impliqués vont mourir.
32/ Le mari pense que la vendetta est une excuse qu’à trouver le rônin pour rester dans l’opposition. Quant à la femme de l’orpailleur elle voit qu’il est parti. Pour le rônin c’est le signe que son clan l’a déjà trouvé. Ce qui signifie qu’ils vont le tuer, car les samouraïs ne laissent jamais rien derrière eux. La femme s’étonne, pourquoi le tueraient-ils ? Parce qu’il est la preuve vivante qu’ils ne laissent jamais aucune trace derrière eux. Son mari est donc en danger et lui demande donc de lui révéler où il cache l’or.
33/ A l’endroit de la cachette, le chancelier félicite l’orpailleur. Le rônin arrive et dit qu’ils vont le tuer une fois l’or en lieu sûr. Le chancelier demande à ses hommes de tous les tuer. Ils prennent en otage la femme de l’orpailleur. Il laisse tomber son épée. Ils le tuent, lui et sa femme. Le rônin cherche à tuer le chancelier qui lui demande pourquoi il le tue, ils ne sont pas connectés ! Le rônin lui répond que désormais ils le sont : ils iront tous deux en enfer.
34/ Ils partent : ils doivent continuer à fuir, car la fille du chancelier est toujours à leur trousse, les choses ne changeront pas.

Le Sabre de la bête, Hideo Gosha 1965 Kedamono no ken, Sword of the Beast | Shochiku, Shochiku-Fuji Company