Fûfu, La Dînette, le préquel

Un couple

Titre original : Fûfu
Année : 1953
Réalisation : Mikio Naruse
Avec : Ken Uehara, Yôko Sugi, Rentarô Mikuni, Keiju Kobayashi, Mariko Okada, Kamatari Fujiwara, Chieko Nakakita
— TOP FILMS —
Il ne faut pas s’y tromper, si Naruse est le cinéaste du couple et du mélo, il y a dans ce film un humour léger qui affleure à chaque scène. Pour lui sans doute, décrire les détails amusants d’une relation comme les événements les plus tragiques, c’est la même chose. Parce qu’il a le goût de l’absurde. Il comprend la vie et sait qu’elle n’est rien d’autre qu’absurde, futile et éphémère. Tout y est léger. Le film est à cheval entre les films sans prétention de « gosses de Tokyo » (comédies pince-sans-rire qu’on associe plus volontiers à Ozu, mais Bon courage larbin, son premier film qui a survécu en est un exemple ; d’ailleurs Ozu aura plus tard ce même goût des détails futiles et absurdes) et les films plus tardifs plongés plus franchement dans le mélo (ceux écrits par Matsyuama notamment).
Le film a été réalisé trois ans après Le Repas (il reprend le même acteur, Ken Uehara, et le même scénariste, Toshirô Ide), pourtant il y a ce petit quelque chose dans le ton qui le relie à l’absurdité plus affirmée des Acteurs ambulants (on y retrouve l’acteur principal dans le rôle du père faussement méprisant et désintéressé), et donc à ces comédies des années 30, pas si lointaines. Un ton difficile à trouver, entre comédie et drame, qui est aussi la caractéristique d’un auteur comme Tchekhov. La fin y ressemble : une sorte de mélo doux amer comme quand, au milieu du gué, on lance « le roi est mort, vive le roi » (si, ça arrive plus qu’on ne le croit).

Un couple, Mikio Naruse 1953 Fûfu | Toho Company
Pour suggérer cet humour, il fallait un acteur capable d’assumer ce rôle de perturbateur indolent. Et Rentarô Mikuni est parfait dans ce registre. Le fait de le revoir dans ses nombreux films futurs est peut-être trompeur, mais il a quand même une gueule et des mimiques qui ne trompent pas. Le personnage a sans doute été écrit ainsi. Veuf, il est indifférent à tout jusqu’à ce que ce jeune couple vienne partager sa petite maison. Mikuni a toujours cet air ahuri qui laisse penser qu’il vient de se réveiller ou qu’il pense à autre chose. Parfait pour jouer les idiots, ou pas. Parce qu’il est (et sera toujours) sur un fil, ne tombant jamais dans le grotesque. Ici par exemple, on le voit s’épiler les poils des narines. Un détail, mais qui fait tout. Quand il dévoile ses sous-vêtements ridicules, les deux autres se marrent comme des gosses, et lui ne comprend pas ce qu’il y a de si drôle, d’autant plus que c’est sa défunte femme qui les lui avait confectionnés pendant le rationnement… Humour doux amer. C’est d’ailleurs la seule fois où on verra le couple rire, et être sur la même tonalité.
Les trois sont comme des enfants, ils le disent assez. Insouciance à tous les compartiments, spontanéité, naïveté… Il faut attendre la fin pour les voir se comporter enfin comme des adultes. Avant cela, certains comportements sont présentés volontairement comme puérils : le mari passe son temps à bouder, il ne sait probablement pas lui-même pourquoi ; et elle ne se sépare jamais de son sourire amusé. Plus qu’un jeune couple, on dirait un petit garçon et une fille qu’on oblige à s’asseoir à la même table à l’école. Même pas mal. Alors quand on y invite un garçon, celui-ci peut bien perturber le couple, ce n’est jamais grave. « Tu aimes ma femme ? » « Oui. » « Ah. » Et on repart comme si rien ne s’était passé. On rentre ensemble et on continue de jouer.

Les enfants sont partout et nulle part. Souvent pris en référence comme quand ils reçoivent le frère et sa jeune femme à la fin pour leur expliquer (eux les vieux de la vieille, les grands, parce qu’ils ont peut-être deux ans de mariage, comme les grands chez les enfants qui sont ceux qui ont dix ans) que les maris aiment être traités comme de grands enfants… (parce qu’une femme japonaise doit être à la fois la maman, la bonniche, la nounou, la secrétaire, et accessoirement, la maîtresse). Des enfants, ils n’en ont pas encore. Amusante scène d’ailleurs quand, à la fin, juste après avoir donné ces conseils aux jeunes mariés, ils visitent une maison à louer et qu’on leur dit qu’ils ne veulent absolument pas de couple avec des enfants à cause du bruit. Non, des enfants, ils n’en ont pas, et pour cause, c’est encore eux les enfants…
Encore une petite perle de Naruse. Deux ans après Le Repas, il nous en propose le préquel en quelque sorte. Même volonté de coller à la réalité d’un couple, même précision, même concision, mêmes décors (très restreints d’ailleurs). Seule différence, le ton du film, plus léger, plus insouciant. Le perturbateur du couple, en dehors de l’ennui et de la déception de se retrouver ensemble (avoir tiré le mauvais numéro, comme il le dit justement), il est là, dans la maison. Il a un nom, un visage, donc on peut en rire. On voit qu’il ne fait pas si peur que ça. On ne se sépare pas encore, on fuit ensemble, croyant que c’est encore possible.
À noter la présence de Mariko Okada, qui aura le temps de dépasser son quota de sourire (chez Naruse entre autres) avant de se marier avec Yoshishige Yoshida et de ne plus tirer dans ses films que d’atroces tronches bouffées par la sinistrose.












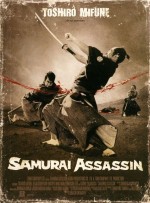

























 Année : 1962
Année : 1962





