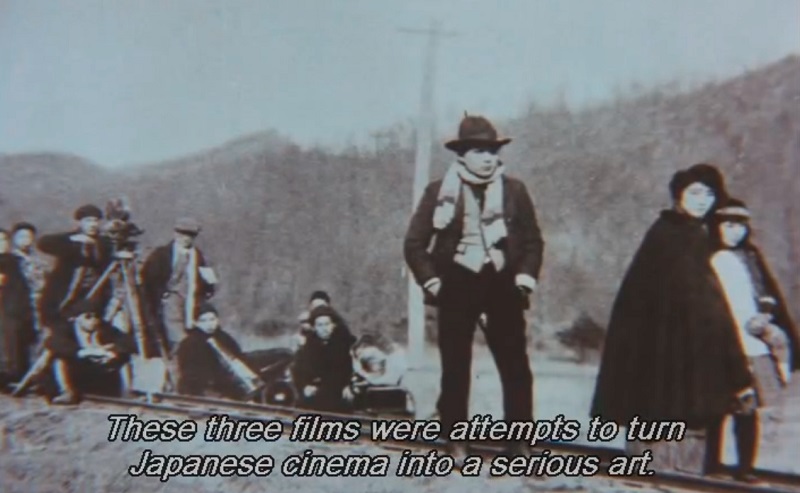Nuée d’oiseaux blancs
Titre original : 千羽鶴, Senba zuru
Aka : Thousand Cranes
Année : 1969
Réalisation : Yasuzô Masumura
Avec : Ayako Wakao, Machiko Kyô, Mikijirô Hira, Eiko Azusa, Eiji Funakoshi, Tanie Kitabayashi
À tourner dix films par an, on finit fatalement par ne plus savoir ce que l’on tourne et par oublier l’essentiel de la mise en scène : diriger des acteurs pour que leur interprétation soit cohérente et trouver exactement la bonne distance en ce qui concerne le ton ou le rythme du récit. Un professeur de théâtre disait toujours que dans une pièce « si la lumière n’était pas allumée dans les premières secondes du film, l’intérêt du public sera toujours éteint ». Au cinéma, c’est pareil. Si, dans les premières minutes, l’approche, le ton, la distance ne conviennent pas, on sait que l’on va passer un mauvais moment.
Dans un univers de studio, avec des réalisateurs et des équipes rodés, la facture générale du film peut faire forte impression : le spectateur habitué des films de Masumura reconnaît son talent pour la composition des plans, placer ses personnages et découper tout ça au montage (c’est de l’orfèvrerie, j’ai probablement dédié mon meilleur article au sujet). Mais très vite aussi, on sent que quelque chose cloche. L’introduction sort un peu de l’ordinaire. On reconnaît le minimalisme de Kawabata, son goût pour les ellipses, pour le formalisme des situations, mais je ne sais pas si c’est son récit qui manque de chair dans cette entame, si l’adaptation de Kaneto Shindô n’a pas saisi le danger d’un récit à l’introduction trop rapide, ou enfin la faute à Masumura, incapable de restituer les subtilités de l’entrée en matière de l’auteur… Quoi qu’il en soit, l’intrigue commence, et au bout de quelques minutes, non seulement l’affaire est pliée et une liaison se noue entre les deux protagonistes, mais on se demande aussi si ce récit ne constituerait pas la suite d’une précédente histoire qui nous aurait échappé. Les personnages agissent ainsi plutôt comme dans un développement, voire un dénouement, avec des excès émotifs qui ne paraissent pas être à leur place. Certes, Madame Ota est censée en faire toujours un peu trop (selon mademoiselle Kurimoto), mais le bonhomme n’est pas obligé de tomber si facilement sous le charme de l’ancienne maîtresse de son père… Lui a peut-être le temps d’être séduit, nous, non. Et pourtant, c’est une des plus belles femmes du cinéma en face. On n’est pas des spectateurs faciles, hein. On ne se couche pas le premier tiers du film !
La cohérence du récit est une chose, la tonalité, encore une autre. Ce qui donne la tonalité, l’atmosphère d’un film, c’est parfois sa musique. Et une musique peut livrer sa propre logique et éclairer le sens d’une histoire. On travaille en petit comité : le coupable se trouve être Hikaru Hayashi, autrement dit un habitué non seulement des films de Masumura (pas forcément les meilleurs), mais aussi de Kaneto Shindô (et les bons, Onibaba et L’Île nue, pour citer les meilleurs). Possible que Hayashi se soit trouvé un peu dépourvu en voyant le montage du film, parce que sa musique semble plus traduire sa perplexité qu’autre chose…
Hikaru, ayant chanté tout l’été, se trouva fort dépourvu quand la bise fut venue et que madame Ota son pantalon… « Quoi ? Quoi ?… Vite : musique mystérieuse. »
Les notes de musique reflètent un mystère tout aussi forcé que les excès de Madame Ota et nous voilà comme projetés dans un film de Yoshida chez qui la musique expérimentale fait écho à l’incompréhension du spectateur face aux propositions crypto-esthétiques du réalisateur.

« Tu aimes les films avec de la musique mystérieuse, Kikujisa ? »
Est-ce la bonne approche, la bonne tonalité ? Instinctivement, Kawabata, je l’associerais davantage et dans un premier temps à la nostalgie, et seulement après, au mystère, à la solitude, conséquence inéluctable de l’incommunicabilité. De mémoire, Pays des neiges procédait de la même façon avec des ellipses obsessionnelles, des décors restreints, un temps chaotique et inconsistant renforçant l’idée d’isolement, de solitude et de désorientation. J’imagine qu’une adaptation des Belles Endormies fonctionnerait de la même manière : d’abord, la découverte d’une situation, la répétition, l’étrangeté, puis l’obsession d’une idée fixe, d’un vice… Plonger ainsi à brûle-pourpoint dans une forme de mystère pas encore nécessaire, reposer sur des dialogues plus que sur des non-dits, un jeu hiératique ponctué soudain d’excès incompréhensibles ne fait qu’ajouter de l’incrédulité aux incohérences de départ.
Le développement ne parvient pas plus à faire jaillir un peu de lumière dans ce spectacle étrange et éteint. L’alliance du côté solennel, procédural de la cérémonie du thé et des excès émotionnels ou comportementaux des personnages donne l’impression d’assister à un spectacle de robots poussés à se divertir en imitant les humains après leur disparition. Ce serait dans leurs incohérences et leurs maladresses qu’ils révéleraient leur nature. Un tel angle peut toujours avoir son intérêt dans un film dédié à la « vallée de l’étrange » (comme dans Stepford Wives), dans une adaptation de Kawabata, un peu moins.
Effet d’une introduction ratée ou non, difficile pour moi de me passionner pour une telle histoire de fétichisme à la limite de la nécrophilie. Quant à l’héritage amoureux, cet étrange ménage à quatre transgénérationnel, je sais que l’on est dans l’univers d’un homme qui a imaginé des rapports avec de « belles endormies », mais la maîtresse éplorée qui devient la maîtresse du fils de son amant avant que ce fils ait des rapports avec la fille de la maîtresse de son père, voilà un type de téléphone arabe pour le moins déconcertant… Imamura aurait fait de ces personnages alambiqués des monstres et l’on s’en serait amusés (comme l’on se serait amusés d’un réalisateur insistant sur la symbolique sexuelle du fusil dans Winchester ’73). Mais attention, on est chez les kawabatophiles, les rapports tordus, pervers, fétichistes représentent une forme d’idéal ou de normalité dans les cercles intellectuels. Qu’auraient-ils à raconter autrement à leur psychanalyste ?
Boire dans les tasses centenaires qui ont vu passer des générations d’amants, celles que portaient aux lèvres papa et maman, est-ce tromper, docteur ? Les briser, est-ce mettre fin au cercle incestueux de notre héritage pervers ?
J’ai beau apprécier passionnément Ayako Wakao, je suis loin de partager ces tendances fétichistes. Si le thé n’est pas bon, si la cérémonie déraille, et si Ayako me paraît répéter une séquence de dénouement d’un film qu’elle tourne entre deux prises sur le plateau d’à côté, je me lève et je me casse.
Mais brisons là.
La tasse séculaire.
Et allons nous coucher.
Seul.
Repus de médiocrité.
Et de tessons amoureux.
(À relire mon commentaire pour Le Temple des oies sauvages, je me dis que je pourrais réécrire exactement la même critique. Et c’est d’ailleurs un peu ce que j’ai fait. Moi aussi, je fais dans le transgénérationnel. Ah, c’est encore dans les vieilles tasses que ça part toujours en déconfiture.)
Nuée d’oiseaux blancs, Yasuzô Masumura 1969 千羽鶴 Senba zuru | Daiei Studios
Sur La Saveur des goûts amers :
Composition des plans et montage en champ-contrechamp chez Yasuzô Masumura
Liens externes :
Si vous appréciez le contenu du site, pensez à me soutenir !
Réaliser un don ponctuel
Réaliser un don mensuel
Réaliser un don annuel
Choisir un montant
Ou saisissez un montant personnalisé :
Merci.
(Si vous préférez faire un don par carte/PayPal, le formulaire est sur la colonne de gauche.)
Votre contribution est appréciée.
Votre contribution est appréciée.
Faire un donFaire un don mensuelFaire un don annuel