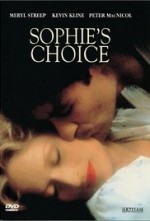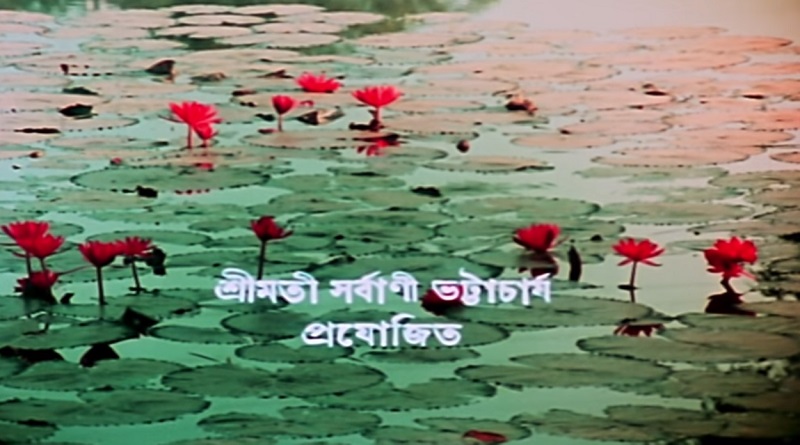Je sors de mes vieux films pour aller au cinéma et voir ce film. Il a fallu que ce soit un gros morceau pour que j’en entende parler, parce que je ne suis plus du tout l’actualité du cinéma depuis un bon moment. J’y suis donc allé sans savoir de quoi il s’agissait. Je savais juste qu’il y avait DiCaprio et que c’était réalisé par Christopher Nolan (ça, je l’ai compris au début du film, et je ne suis pas très fan de Nolan…). Je suis sorti du film assez assommé et surtout avec un gros mal de crâne (je n’en veux pas au film, mais il m’a bien rendu malade). Sur le coup, je n’ai éprouvé aucun plaisir à suivre le film, même si on ne voit pas le temps passer. Donc une fois sortie, impossible de dire si j’avais aimé ou pas, j’avais reçu une claque dans la gueule. À la différence des autres spectateurs, pour qui la claque était sans doute une chose positive, moi ça m’a fichu KO. Et je n’aime pas ça.
Ce film me laisse à peu de chose près la même impression, le même goût désagréable, que ses films précédents. De Batman en particulier. En relisant ma note sur ce film, je vois que je n’avais pas aimé le film parce qu’il manquait cruellement de poésie et d’humour (voire d’ironie). Aussi, la structure du film, une espèce de nœud informe sans début, ni milieu, ni fin, avec un montage trop serré, trop dense. Et je retrouve tout ça dans ce film. Et il faut croire que je suis le seul, parce que déjà pour le Batman, je notais ma surprise de voir critiques et spectateurs s’accorder pour dire que le film était génial…
C’est peut-être parce que je suis habitué aux structures propres, une maille à l’endroit, une maille à l’envers, des films des années 50. À l’époque la dramaturgie était directement inspirée des romans ou du théâtre. Là, avec Nolan, je suis totalement perdu. Il reprend bien des codes de narration utilisés comme une scène d’intro qui fait vite rentrer le spectateur dans le vif du sujet. Pour le reste, comme Batman, pour moi, ça ne respecte rien. Mon pote en sortant m’a soufflé que c’était brillant, que la dramaturgie était incroyable. Brillant, ça oui c’est brillant, trop même, mais aucun rapport selon moi avec la dramaturgie. Emboîter des événements les uns dans les autres, trouver des astuces, trifouiller à l’infini un sujet en le complexifiant toujours plus et sans finalité, juste pour la frime, pour moi, ce n’est pas signe de qualité dramaturgique. Au mieux, c’est un travail d’architecte qui essaye de tout mettre à niveau, fermer les angles, etc. La meilleure des dramaturgies, c’est celle qui arrive à rendre simples les choses compliquées, qui rend accessible une histoire, qui donne du plaisir et de l’intérêt au spectateur, tout cela en respectant certains codes, qui ne sont pas là pour faire beau ou pour respecter une tradition, mais juste parce que ce sont des procédés utilisés depuis des millénaires et qu’ils sont les meilleurs pour raconter une histoire.


Si on prend la scène de présentation par exemple, c’est intéressant, on rentre directement dans le sujet du film, on est interloqué, on se demande dans quel environnement on se trouve, on doit comprendre avec les rares indices qu’il nous laisse, et c’est plutôt un plaisir — jusque-là. Sauf que la scène est trois fois trop longue ! Une présentation doit montrer les choses assez sommairement, parce que si elle met en scène le sujet du film, introduit un contexte, une ambiance, ce n’est pas le sujet du film. Une demi-heure rien que pour présenter le phénomène de l’intérieur, c’est un peu long, d’autant plus qu’on y reviendra pendant tout le reste du film. Par la suite, le personnage de DiCaprio réexpliquera le phénomène des rêves emboîtés et le principe de vol d’information (voire d’introduction d’idées chez une cible) à Ellen Page qu’il vient de recruter… encore avec des effets visuels, qui en remettent encore et encore une couche alors qu’on n’est pas encore rentré dans le vif du sujet du film. Bref, que du hors sujet, des répétitions, des fausses pistes…, et tout de même pas mal d’invraisemblances que j’ai eu du mal à accepter.
Pendant toute cette longue séquence d’introduction, le personnage de Ken Watanabe est la cible du voleur de secret qu’interprète DiCaprio (une sorte de mix improbable entre Freddy et Arsène Lupin). À ce moment, en terme dramaturgique, on dit que Watanabe est l’opposant. D’accord… DiCaprio échoue dans sa mission, on apprend que ceux qui l’ont engagé ne vont pas l’accepter et vont le supprimer (même pas le temps d’expliquer pour qui il travaille, dans quelles conditions, pourquoi… ça arrange le scénariste même si ça paraît peu crédible), c’est donc là que tout naturellement, Watanabe lui propose de travailler pour lui… Mais bien sûr, comme c’est pratique ! Il a justement une mission sous le coude à ce moment-là, de la plus haute importance… Invraisemblable.
Remarque, Nolan dit que le film n’est qu’un rêve, donc que ça n’aurait aucun sens de chercher des vraisemblances dans sa structure… comme c’est pratique. « Bien sûr, si mon film est tout pourri, si je n’ai pas jugé utile de remédier aux faiblesses du scénario, c’est parce que ce n’est qu’un rêve et les rêves sont imparfaits, pas vraisemblables. » Oui, moi j’appelle ça une perte de crédibilité. Le rêve est un contexte pas un film, sinon on demanderait aux fantômes qui s’adressent à Richard III de s’adresser directement à l’acteur en rêve et de se contenter de se bouger en faisant des « hou, hou ». L’art de la dramaturgie, c’est de faire passer un message, une histoire, pas de coller à la réalité ou au rêve. Et pour faire passer un message, il faut tout mettre en œuvre pour que le spectateur reçoive au mieux les informations qu’on lui donne et surtout qu’il y croit. C’est tout le problème de la vraisemblance soulevé par Aristote ou d’autres certainement après lui… Il pourrait ensuite me reprocher d’accepter les vraisemblances contenues dans The Man from Earth[1], et pas ici. D’accord, sauf que dans ce film, le problème est posé tout de suite et qu’il est simple : est-ce qu’il ment ou pas, tout le reste est un jeu. Alors on peut décider ou non de rentrer dans l’invraisemblance proposée par le film, mais ici avec Inception, on n’a même pas le choix et le « c’est peut-être un rêve » sonne surtout comme une pirouette pour faire tout et n’importe quoi, ce qui est bien la marque de Nolan. Les effets avant le sens.

Un des autres gros défauts dans la dramaturgie du film, à mon sens, c’est son rythme. Même problème que dans Batman. On ne nous laisse jamais respirer. Dans Memento, ce n’était pas tant que ça un problème, parce que le film n’était, en apparence, pas structuré avec des éléments essentiels à chaque scène : les scènes étaient des tranches de vie, on pouvait donc prendre son temps et apprécier le décor (très important ça…, je ne plaisante pas c’est essentiel pour qu’on puisse faire travailler notre imagination), même si on se rend compte finalement que chaque scène possédait des outils pour comprendre la suite (ou le début…). Mais c’était le principe du film, de nous perdre en route, un peu comme Usual Suspects : peu importe si on est plus trop attentif du qui est qui ou de qui a fait quoi pendant le film, c’est de toute façon impossible, l’important, comme dans le Grand Sommeil, n’étant pas de suivre, mais de se laisser pénétrer par l’ambiance, et d’être attentif aux revirements quand ils arrivent, notamment bien sûr au revirement final dans Usual Suspects, qui nous laisse pour des crétins et on en est bien content ! Le mec qui ressort du film en disant « j’avais tout compris ! » est un menteur. Le plaisir, comme d’une certaine manière quand on se fait plaisir en se faisant peur en regardant un film d’horreur, on l’a dans ce genre de film en comprenant qu’on nous a pris pour des idiots. Sauf que Nolan, il nous prend pour des idiots dès le début. Avec lui, c’est clair dès le début : laissez-moi faire mes canevas boiteux et émerveillez-vous devant la splendeur de l’absconcitude incarnée de ma savante complexitude…
C’est gonflant ce côté opéra qui ne s’arrête jamais. Jamais d’intro chez Nolan, on entre direct dans le vif du sujet. C’est sans doute voulu, mais moi j’ai horreur de ça. Ça permet de dire qu’on ne dramatise rien, on montre des événements qui se succèdent sans mise en relief, alors que c’est ça le rôle d’un raconteur d’histoires. Et finalement, puisqu’il n’en est pas capable, il laisse la musique faire son boulot. Sauf qu’elle ne s’arrête aussi jamais… C’est le boléro de Ravel non-stop… Poump, poump-poump, poump, tin…, ti… tililililitilili, tilililitili, tilili-li-li-li… Poump, poump-poump…… Si ce côté non-stop est voulu, c’est carrément pour moi une erreur. Je me répète mais le spectateur, il a besoin de respirer. Si tout s’enchaîne à un rythme rapide, sans pause, sans alternance, on finit par s’asphyxier. Là, on attend l’interlude qui va nous permettre de respirer… Même quand il y a juste une musique lente, à peine audible, c’est une musique qui entretient le suspense, la tension, qui dit attention c’est grave, un truc va se passer… Pff ça va quoi…, quand tout est important dans un film, quand il faut faire attention au moindre détail, plus rien ne l’est.
Et puis, moi, je n’aime pas réfléchir pendant un film, ou du moins je n’aime pas qu’on m’impose ce à quoi il faut réfléchir pendant trois heures. Parce que c’est ce que fait le film de Nolan. Il y a tant de choses à comprendre, qu’il faut sans cesse être à l’écoute, être attentif à la moindre explication, sinon on perd une pièce du puzzle et tout s’écroule, on est largué. Or le but contrairement à Usual Suspects ou Memento, n’est pas de nous induire en erreur, nous faire perdre le fil, mais bien de faire appel à toute notre intelligence, notre attention, parce que tout ce qui est dit comporte des informations capitales pour comprendre la suite, le contexte, la genèse des personnages, etc. Sauf qu’autant d’informations en peu de temps, énoncées au milieu d’un flux énorme d’information du même type, souvent en plein milieu d’une scène d’action ou rapidement soufflées par autre chose à l’écran, c’est juste intenable et cela explique mon gros mal de crâne à la sortie de la projection. Alors, soit j’ai une faible capacité à intégrer des données dans un temps très court (c’est fort possible, j’ai jamais aimé le stress d’apprentissage, je préfère renoncer et apprendre plus tard quand on ne me demande plus rien), soit les autres font semblant de comprendre et sont juste émerveillés par l’action sans pose, par l’impression laissée de gros canevas cérébral… Peut-être que d’autres, de la génération MTV, arrivent à tout ingurgiter avec plaisir… Moi, je ne peux pas, j’ai besoin de temps pour intégrer, j’ai besoin de me familiariser avec une nouvelle information en la mettant en scène dans ma tête pour me l’approprier, pour juger des différentes portes de sortie possibles dans l’histoire, pour imaginer les origines de cette idée, me représenter toutes ces idées dans un tout. Ce n’est pas le tout de me dire que dans le rêve, il peut y avoir un autre rêve et de m’expliquer brièvement pourquoi…, il faut que je me fasse à l’idée, dans mon petit esprit lent et avec mon intelligence molle. Bref, j’ai besoin de faire appel à mon imagination, à mon intelligence, en comprenant une information avec son contexte, ses enjeux, ses implications. J’ai besoin d’intégrer des fausses pistes pour les identifier par la suite dans l’histoire si elle se présente, pour me dire « ah, ça non, ce n’est pas possible… » Si on me prémâche tout, si on ne me laisse pas le temps de réfléchir, de penser, de juger de la crédibilité d’une idée, d’imaginer, je ne retiens rien, je n’éprouve aucun plaisir et surtout il y a une sorte de stress qui m’envahit parce que je ne veux rien manquer. C’est présenté de manière trop prosaïque, ça manque de chair, de superflus. Pour reconnaître ce qui est important dans un film, il faut aussi y intégrer un peu de superflus. Pour mettre du rythme dans un film, il faut alterner les rythmes. Si on joue tout au même rythme, on ne perçoit aucun rythme. Là, tout est au même rythme, à la même note… C’est comme un arc qui se tend et qui ne se relâche jamais.

J’ai vu que le film était comparé à Matrix et à Blade Runner (le premier OK, pour les mondes virtuels imbriqués les uns dans les autres, mais pour le second, à part l’univers dickien, je ne vois pas…), mais dans ces deux films, il y a de vrais moments de poésie, où on prend son temps, où on laisse le spectateur se faire sa propre sauce, où le film ne se joue pas seulement devant, mais en nous, avec notre propre imagination. C’est le principe de la catharsis… Comment s’identifier à un mec qu’on ne voit qu’une seconde entre un plan de bagnole qui vient en percuter une autre et un plan de train qui lui fonce dessus ?… Et merci pour le jeu d’acteur… Là encore, peu de place laissée à son imagination à lui. Très peu de temps pour exprimer ce qu’il a envie de passer… C’est simple, les acteurs sont des pantins : ils n’ont pas de sentiments, pas d’expression, pas de motivation, pas de contradictions, pas d’espoir…, tout est dit par l’action. Les personnages sont déterminés par rapport à ce qu’ils représentent dans l’action. Donc aucune place laissée à l’humain, à la subtilité, tout ce qui fait qu’on s’intéresse à un personnage auquel on a envie de s’identifier… On suit le film comme on doit lire un rapport top secret tout juste sorti du coffre secret de la cible, c’est-à-dire pressé par le temps et en ne retenant rien.
Les personnages, on peut en parler. Là encore, on se soucie peu de leur donner du corps. Tout ce qu’on apprend sur le personnage de DiCaprio au fil du film, est toujours d’une importance capitale pour comprendre son cheminement, son rapport avec le rêve, qui est son outil de travail, et donc le sujet du film. On se soucie peu de lui construire une personnalité, un passé, ses motivations (en dehors de retrouver ses enfants). Ainsi, que sait-on au fond de cette technique d’immersion dans les rêves ? On sait qu’il a testé le principe « d’inception » sur sa femme, on sait que la pratique est utilisée dans des sous-sols en Turquie avec des camés du rêve. Mais au final, sur le contexte de son invention, du comment, on ne sait rien. Caine joue le père de DiCaprio et semble s’y connaître sur le sujet, est-il le créateur de cette technique ? On n’en sait rien. Qui sont les entreprises qui font appel à lui et pourquoi… On n’en sait rien. Pourquoi le fait-il ? Pour l’argent pour autre chose ? On n’en sait rien. Les enjeux et les motivations des personnages sont si flous, que quand DiCaprio se lance dans la recherche d’une équipe pour mener à bien sa nouvelle mission (là on a droit à des scènes tout aussi inutiles pompées à Mission impossible…, toujours le prétexte à de nouvelles scènes d’action hors sujet), son père lui présente une étudiante, Ellen Page (très crédible là encore…). Les scènes alors se focalisent sur l’explication de ce qu’est l’inception. Procédé intéressant et souvent efficace : faire entrer un personnage en même temps que le spectateur pour pouvoir expliquer au spectateur un contexte en même temps que le personnage en question. Sauf qu’un personnage ne peut pas avoir que ce rôle. Les personnages ne sont pas des pions qu’on invente aussitôt que la nécessité s’en fait sentir. Une fois créé, un personnage, en fonction de son importance dramatique (et par la suite Nolan lui en donne, parce qu’elle gardera cette place auprès de DiCaprio, celle qui nous sert à nous d’inception pour comprendre l’univers du film) on n’a pas le droit de le laisser tomber ou de l’utiliser uniquement quand l’histoire se retrouve face à une porte close et qu’on choisit un personnage au hasard pour en ouvrir la serrure. Un personnage, il a des motivations propres, une histoire personnelle, de craintes, des buts…, il doit apporter au monde froid et strict de la trame dramatique un peu de folie, d’imprévu, de paradoxe. Là ? Rien. Ellen Page accepte la mission, en simple étudiante. Aucune question éthique, aucune motivation qui expliquerait son acceptation de la mission. « OK Ellen, on va pénétrer dans la tête d’un mec d’une grande société à la demande de son concurrent, pour lui suggérer une idée qui sera profitable à son concurrent. Tu es partante ? » « Et comment ! » On y croit… Effectivement, tu rêves, Christopher… (Encore je suis gentil, il ne lui demande même pas son avis…) Ce qui compte dans une histoire ce n’est pas l’histoire en elle-même, parce que toutes les histoires ont déjà été racontées ; ce qui compte ce sont les personnages, leur vie, leurs imperfections, leurs contradictions, leurs craintes, leurs espoirs, leur évolution. La catharsis agit à travers eux. Sans eux, ce n’est que de l’action brute et autant lire un almanach d’événements se succédant les uns après les autres.

Quand on enlève toutes les scènes d’action, finalement, on se rend compte qu’il n’y a pas grand-chose derrière. Pour reprendre encore en référence Matrix, c’est un peu la différence entre le premier volet de la série, qui raconte une vraie histoire, avec une vraie mise en profondeur progressive dans l’univers, des enjeux qui se dessinent lentement, un apprentissage qui est un peu aussi le nôtre, une montée en puissance jusqu’à un affrontement final (du classique quoi), et les deux autres volets qui ne font plus appel qu’à de l’action brute, une action répondant à une autre, sans intervention des humains, de leurs motivations, de leurs contradictions, de leurs craintes, etc. C’est devenu, creux, sans passion, sans vraisemblance. Exactement comme la plupart des films de Nolan et donc dans celui-ci.
Même sur le plan visuel, il y a des scènes magnifiques comme celle de Paris où Page s’amuse à plier l’horizon ou encore les scènes d’apesanteur. Ce qui manque à Nolan, en tout cas ce qui me gêne, c’est l’absence totale de fantaisie. Tout est prosaïque, réaliste, sérieux… C’est sans doute ce qui avait plu à certains dans son Batman, et ce qui m’avait agacé. Mais il faut reconnaître ensuite que ça limite pas mal l’invention, et les folies visuelles. On a du mal à croire qu’on est dans des rêves la plupart du temps dans le film. On croirait plutôt à un monde recréé. D’ailleurs, DiCaprio fait appel à des « architectes » qui doivent reproduire jusqu’à la texture des matières… Bah, oui mais dans un rêve, on s’en fout de la texture des choses. Surtout, on n’a pas besoin que tout soit parfaitement reproduit pour y croire, vu qu’on ne sait pas qu’on est dans un rêve et que le ciel pourrait nous apparaître jaune que ce serait normal, du moins que ça ne nous empêcherait pas de continuer à rêver… « Ah merde j’ai rêvé d’une moquette en polyester alors que dans la vie elle est en laine… » Bah et alors, c’est un rêve, le mec n’aura jamais ce genre de réaction. Dans un rêve, tout est décousu, les décors, comme les idées, rien ne ressemble à la réalité. Et même quand on voudrait faire croire à une cible qu’elle est toujours dans la réalité…, elle ne s’en soucierait pas puisqu’elle est dans un rêve, et quand on y est, on est prisonnier de sa réalité. Reproduire les bizarreries des rêves, voilà qui aurait été intéressant plastiquement, esthétiquement. Changer de lieu sans que cela n’affecte la raison des personnages ; des personnages qui changent sans raison, etc. Le problème il est là. Dans un rêve, on n’a jamais son libre arbitre, on est passif et esclave de son subconscient. Nolan, lui, rend tout ça rationnel, fabrique un univers onirique qui n’est ni plus ni moins que la réalité virtuelle de Matrix. Pas assez poète pour comprendre ça le Nolan, pas assez surréaliste. Un puzzle baroque qui ne représente rien du tout et ou toutes les pièces pourraient être interchangeables…
Pour ce qui est des acteurs, je ne suis pas très fan de DiCaprio, éternel adolescent pour moi (donc peu crédible dans un rôle comme celui-ci)…, mais j’ai eu beaucoup de plaisir à revoir Ellen Page. C’est peut-être le seul élément qui apporte par sa présence un peu de nuance au film. Corps de mec (pas de bassin, plate…) mais ultra-féminine ; visage poupon mais grande intelligence (dans son interprétation — pour ce qu’on lui laisse faire — et le personnage, qui mène à notre compte, l’enquête). Il fallait bien finir sur une note positive…

Inception, Christopher Nolan 2010 | Warner Bros., Legendary Entertainment, Syncopy