Joli mélodrame sur la condition de la femme prostituée dans le Japon des années 30, complété d’une délicate description du milieu des quartiers des plaisirs de Tokyo, des relations longues et secrètes qu’entretiennent certains hommes, partagés entre les lumières scintillantes des quartiers de « l’est du fleuve » et la réalité du foyer familial. L’adaptation du roman de Kafû Nagai écrit en 1937 est assurée par Toshio Yasumi qui avait déjà signé le scénario pour Shirô Toyoda de Pays des neiges, et qui dans le même genre (le mélo fin et discret) avait participé un peu plus tôt à l’écriture de Jusqu’à notre prochaine rencontre (Tadashi Imai).
Contrairement à ce que le titre pourrait laisser penser, l’histoire n’a rien de singulier (ou d’étrange, d’insolite, selon les traductions), c’est une énième variation sur le thème de la prostituée vivant plusieurs années durant avec l’espoir que son client et amant abandonne femme et enfant pour elle. Le récit est habilement introduit à travers les quelques notes de l’auteur décrivant la vie et les personnages habitants ces quartiers. Une sortie de bar sous la pluie, une rencontre qu’on voudrait croire fortuite, et puis l’auteur et personnage principal se laisse traîner chez cette femme dont il tombera amoureux. Suivra une étonnante série de séquences décrivant l’amour tendre et fusionnel entre ces deux amants, à quoi répondront des scènes plus tumultueuses, plus bourgeoises, de vie de couple entre l’écrivain et sa femme (un rôle parfait pour Michiyo Aratama). Rien de bien original donc, mais une remarquable qualité d’écriture, s’évitant tous les écueils gonflants du genre avec ses scènes à faire hautement prévisibles, notamment grâce à des dialogues capables de nous faire comprendre en quelques secondes une situation sans chercher à en rajouter (suggérer certains de ces événements attendus, par petites touches ou évocations, au lieu de montrer frontalement et dans la longueur ce qu’on prévoyait déjà) ; au contraire, le gros des séquences s’applique à décrire les détails de la vie quotidienne, les relations, les inquiétudes ou les attentes personnelles (souvent dévoilées à travers la mise en scène, l’attitude ou l’expression faciale) de chacun des personnages…
On retrouve la même méticulosité dans la mise en scène que dans Pays des neiges que Toyoda avait réalisé en 1957, la même discrétion dans le jeu d’acteurs et la même capacité à produire des ambiances opaques, tamisées, presque contemplatives dans un décor et une activité pourtant foisonnants. C’est un mélodrame au sens noble, sans excès ou effets superflus. La caméra reste à distance respectable ; on pense plutôt à la finesse des mises en scène de Mizoguchi ou d’un Imai, et encore plus certainement encore d’un Naruse de la même époque avec quelques scénarios de Zenzô Matsuyama, mais aussi dans Une histoire de femme ou encore dans Quand une femme monte l’escalier tourné la même année (le même studio est aux commandes, la Toho, avec une volonté évidente de faire des shomingeki des drames chatoyants sans tomber encore tout à fait dans le clinquant et l’excès).

Il y a les mélodrames grossiers, paresseux et ronflants, qui sont des séries B, et il y a — ou il y avait avant que le genre ne disparaisse — des mélodrames à grand budget tournés par des réalisateurs de première classe, capables seuls de juger du trop ou du pas assez, à l’image de ce qu’on produit entre 1955 et 1965 à Hollywood, à savoir des histoires d’amours impossibles, contrariées, situées en ville, concentrées le plus souvent en intérieurs, donc tournées en studio, avec une image impeccable (c’est ici un des plus beaux noir et blanc que j’ai vu, mais on est en plein dans la période où le Japon propose ce qui se fait de mieux en matière de photographie), une musique classique pour souligner subtilement les ambiances et les détours dramatiques, et enfin une distribution irréprochable, dense, avec de nombreux acteurs de premier plan pour jouer des seconds rôles (une habitude, toujours, dans un système de studio désireux de produire des films événements pour attirer les foules).
Ces acteurs, c’est l’atout majeur du film. Tous se mettent au diapason pour servir au mieux cette histoire, et la maîtrise en matière de direction d’acteurs de la part de Shirô Toyoda est telle que s’en est une véritable leçon.
L’aspect le plus important, et qui est déjà souligné par les dialogues, c’est qu’il faut insister sur la nécessité de faire vivre ses personnages dans un décor, dans une situation, un état et un confort qui leur donnent vie dans le cadre. Autrement dit, les acteurs doivent être capables de faire, de montrer à voir à chaque instant, même de passer d’un élément de décor à un autre, d’un accessoire à un autre, d’un état à un autre, pour produire une image de leur personnage aidant à constituer une représentation contextuelle de la situation et de l’espace dans lequel évolue, vit, ce personnage. On fait bouillir de l’eau, on allume une cigarette, on se déshabille, on fait jouer son éventail, on médite, on attend… (Les dialogues parsèment les séquences de ces détails de vie enrichissant ainsi le contexte décoratif, social ou psychologique, touche après touche, comme quand Oyuki lors de la première rencontre avec Junpei se rappelle avoir laissé la fenêtre du premier étage ouverte — la séquence n’apporte rien « dramatiquement », elle ne fait qu’enrichir, voire ici, introduire, ce précieux contexte).
Ce n’est pas le tout de se dire qu’il faut placer ses acteurs et leurs personnages dans des situations de vie, encore faut-il que ces choix procèdent réellement à une mise en valeur d’un contexte historique et social, précisent la nature des personnages et leurs liens passés et futurs, le tout en accord avec le texte original et une cohérence propre à chaque histoire. L’exécution dans tout ce micmac sonore et creux, c’est tout ce qui compte. Certains acteurs n’ont aucun rythme, aucune présence, aucune imagination, aucune écoute, aucune mécanique ou rigueur du geste mille fois répété. On réduit trop souvent les talents de mise en scène à une composition des plans, un sens du montage ou du cadrage, or il y a un savoir-faire devenu très rare aujourd’hui, qu’on ne retrouve que partiellement au théâtre (envahi par les usages et facilités supposées du grand écran), et qui est donc cet art de faire évoluer un, deux ou plusieurs acteurs au sein d’un même espace. C’est beaucoup plus dur que cela paraît, car il ne suffit pas contrairement à ce que beaucoup estimeraient possible et nécessaire, de faire comme dans la vie, ou juste de paraître « naturel ». Non, il est bien question de composition : chaque geste doit être répété pour être juste, même paradoxalement, ceux qui doivent donner l’impression d’être improvisés (comme quand Junpei s’amuse tout à coup à faire sonner une clochette avec son éventail), parce que s’il ne fallait que répéter des gestes quotidiens tout semblerait lent, maladroit, imprévisible et inutile et brouillon. La vie est brouillonne ; l’art n’est que rigueur. Et si l’art de la direction d’acteurs avait un modèle, ce ne serait certainement pas la vie, mais la rigueur que doivent s’imposer un groupe de trapézistes contraints de régler au millimètre et à la seconde leurs numéros de voltige.

Le terme « théâtral » — trop souvent devenu un adjectif dépréciatif — est ce qui convient le mieux pour définir le jeu des acteurs dans Histoire singulière à l’est du fleuve. Pourquoi faire théâtral ? Opérer des gestes rapides sans les précipiter, des gestes clairs, tout en éliminant tous les autres parasites que le corps peut offrir au regard quand il évolue librement, c’est apporter du sens, de la nourriture, de la matière au regard du spectateur. Un geste mal exécuté, que ce soit dans son rythme, sa précision ou son élan (qui doit découler d’une intention), est comme une réplique qui bafouille ou un cadrage dégoulinant. Plus encore dans un tel cinéma descriptif et d’ambiance où les situations s’exposent dans la lenteur comme un brouillard rampant. Ces détails, qui pourraient être tout à fait insignifiants pris les uns séparément des autres, participent à créer une peinture harmonieuse de la vie d’une société. Le cinéma (comme le théâtre), ce n’est pas la vie. C’est en donner l’illusion. Sinon, il suffirait de poser sa caméra et de filmer en attendant que quelque chose se passe : ce n’est pas la vie que l’on expose, mais un contexte, et celui-ci ne peut être que le reflet de l’intention d’un auteur, l’expression de son désir. Sans choix établis par une omniscience créatrice, pas de cinéma, pas d’histoire, pas d’illusion. Les mauvais cinéastes tombent dans le piège et veulent reproduire « la vie », les meilleurs connaissent les codes pour produire des images qui font sens. Une fois qu’on a parfaitement compris qu’il fallait obéir à ces codes, on entre alors dans l’usage (donc l’apprentissage), le savoir-faire ; et c’est parfois pour s’affranchir de cet obstacle, que les pires cinéastes préfèrent jouer avec l’idée de réalité, de vie. Ceux-là ont de la chance, parfois, car l’art est ainsi fait qu’il permet aussi les miracles, les surprises ; et c’est ainsi qu’il n’est pas rare de voir des grands films exécutés par des nigauds. Il n’est pas question de ça ici bien sûr.
À l’image d’une symphonie, l’art de créer un personnage, de les faire évoluer dans le même espace, à travers les séquences, c’est un art de la composition. On y fait évoluer des éléments épars entre eux, on touille, et les maîtres qui connaissent les rouages savants de cette cuisine arrivent à nous en mettre plein la vue.
Un autre exemple pour illustrer l’excellente direction d’acteurs dans le film, c’est la manière dont les rôles principaux gèrent la connexion entre leurs dialogues et leur corps. Je l’ai dit, dans la plupart des séquences, les acteurs ont mille choses à faire pour s’occuper, passant d’une activité à une autre, et le plus souvent, nos yeux ne voient rien, tant tout cela paraît insignifiant, sinon à remplir l’espace et le temps qui défile. On ne voit rien, mais on imprime tout. Comme un décor à l’arrière-plan. Or, quand on (les acteurs) a déjà à jongler avec ces impératifs intermédiaires (chez Stanislavski on parle d’objectifs, dans mes vieux souvenirs), il faut encore se trimbaler un texte et jouer les hommes orchestre. « D’accord, je me déshabille dans cette séquence, mais j’ai quelque chose à dire, non ? » Là, par facilité, le mauvais acteur, ou l’acteur mal dirigé, s’appuiera sur ses répliques pour « donner à voir ». Le corps s’arrête alors de vivre ses propres objectifs (non dramatiques mais toujours signifiants, prémédités, donc choisis par le cinéaste ou l’acteur) et tourne toute son attention (et la nôtre) sur ce qu’il va bien pouvoir nous apprendre à travers une ligne de dialogue. « Eurêka ! se dit le mauvais acteur, j’ai quelque chose à dire, je suis le centre d’attention, on ne verra que moi, et je n’aurais qu’à déblatérer mon texte pour que tous les regards de la salle se tournent vers moi dans un même élan de compréhension et de bonheur… » Se reposer sur un texte, sur la parole, peut paraître logique et légitime, sauf que si ça l’est dans des cas bien définis, ça ne l’est pas toujours. Simplement parce que dans la vie, tout ne repose pas sur la parole. Et si le cinéma, ce n’est pas la vie, il a vocation à l’imiter, et les corps des acteurs ne doivent pas cesser de suivre leur propre mouvement pour souligner, commenter, chaque ligne de dialogues, tout comme on ne s’arrête pas de vivre chaque fois qu’on a quelque chose à dire et qu’on a besoin de le souligner par un geste de la main ou par un hochement de tête (sauf les Italiens). On est dans le théâtral, oui, c’est du théâtre, le meilleur qui soit, celui capable de composer (encore) une situation à la fois à travers les informations délivrées par ce qui est rapporté oralement, mais aussi ce que peuvent offrir les corps. Tout un art. La composition d’un personnage, c’est comme travailler ses arrangements dans une symphonie.

Le résultat d’un tel savoir-faire, c’est que dans la grande majorité des séquences, où on ne délivre que quelques informations, subtilement, pour comprendre un contexte plus général qui se compose dans le temps, sur la durée, et peut même rester le plus souvent simplement évoqué, suggéré. Et puis, parfois, quand il faut légèrement insister sur un tournant dramatique, eh bien le corps et toute l’attention des personnages qui va avec se tournent vers un objectif commun. Ce qui n’a rien de surprenant : quand arrive quelque chose d’important, toute notre attention et notre corps se focalisent sur cet élément perturbateur (qu’il soit positif ou négatif). C’est d’autant plus nécessaire à reproduire que quand les deux lignes d’actions (celle de la parole et du corps) se rejoignent, le spectateur comprend que son attention doit être décuplée. L’art encore, c’est de savoir doser et situer ses effets. Contrepoint, mesure, rythme, relief… la musique des corps, des regards et de voix, c’est autre chose que la composition informe, étriquée et brouillonne de la vie.
Chez les acteurs ne maîtrisant pas cette composition entre voix et corps, leur tête et leurs yeux (voire pire, leurs mains) ont l’habitude de commenter ou de souligner les phrases jetées par leur personnage. Ici, au moins parmi les personnages principaux (mais beaucoup de personnages secondaires sont tenus par des acteurs habitués aux premiers), les répliques semblent jaillir toutes seules, sans forcer, simplement, de la manière la plus claire et la plus (faussement) désintéressée. Le passage entre une action et une autre ne se fait jamais en parasitant la fluidité (apparente facilité) du langage. Et puis parfois, on écoute le chef d’orchestre qui tient à marquer un passage plus qu’un autre, on s’arrête, ou on accélère, on appuie ce qu’on dit par un regard, un geste, et l’attitude change aussi. Quand on parle de deux éléments essentiels dans une histoire et en particulier au cinéma, que sont le contexte et le hors-champ (en gros ce qu’on devine, suspecte, imagine ou apprend à connaître à travers des détails plus ou moins évocateurs), la maîtrise de ces connexions entre les lignes de dialogues et les impératifs de « vie » des corps procède très largement à l’enrichissement de cet univers si précieux à une histoire. Ce qui importe, c’est moins ce qu’on voit ou ce qu’on apprend de la voix des personnages, mais bien plus encore ce qu’on peut comprendre par nous seuls à travers des éléments secondaires qui sont comme les témoins, les réflecteurs, d’une réalité, d’une situation, qui constituent l’essence de toute histoire. Derrière la fable, il y a toujours un sens à tirer de l’histoire. Ce sens, c’est au spectateur de l’imaginer, de le reconstituer, le deviner ; et s’il est tentant de lui mettre tout nu devant les yeux, cette évidence presque pornographique ne le convaincra jamais autant qu’une histoire qu’il flaire derrière celle plus fragmentée, trompeuse, subtile, suggestive, derrière le paravent des exhibitions anodines. « Il se passe quoi là ? — Rien. » Mais des petits riens mis bout à bout, ce sont des constellations dans la nuit, des ombres mouvantes sur un mur, et on ne voit plus alors avec nos yeux, mais avec notre imagination. C’est cet écran qui nous fascine depuis le temps des cavernes, qui depuis toujours séparent ceux qui savent raconter les histoires, les mettre en scène, leur donner « corps », et les autres.
Du théâtre d’ombres. Riens de plus.
Je finirai sur la dernière séquence, avec cette image saisissante où Toyoda semble répondre grâce à un travelling latéral et en plan-séquence à la dernière image du dernier film de Mizoghuchi, La Rue de la honte, tourné quatre ans plus tôt. Toyoda se met à la place du visiteur/auteur/personnage bientôt alpagué par des images furtives de prostituées encadrées dans des cellules de lumière rectangulaires. Et ce n’est plus l’image de fin de La Rue de la honte, mais sa reproduction, encore et encore, comme trois petits points se fondant dans la nuit, comme pour en donner presque la saveur morbide d’un calendrier nécrologique.
Setsuko Hara n’est pas la seule à avoir stoppé prématurément sa carrière en plein âge d’or du cinéma japonais. Fujiko Yamamoto (qui tient le rôle-titre ici) arrêtera trois ans après ce film. Pour elle, toutefois, il semblerait que ce soit un différent lié au renouvellement de son contrat qui ait été à l’origine de sa disparition des écrans.
Kaneto Shinto réalisera une autre version d’Histoire singulière à l’est du fleuve en 1992.







































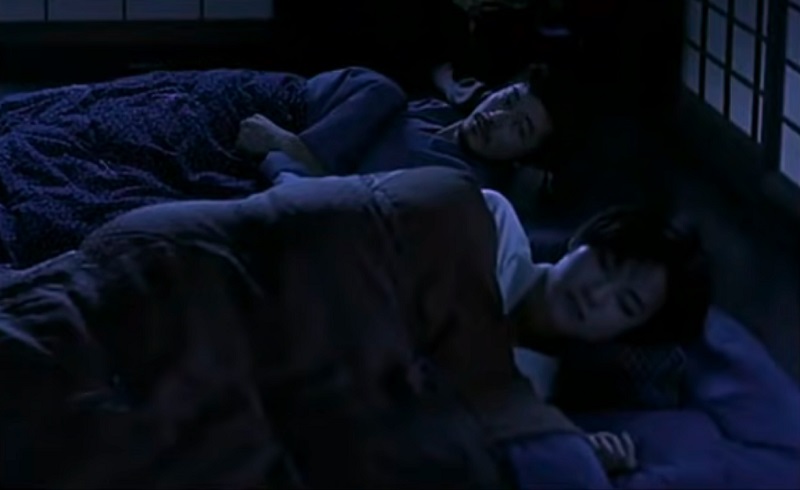













 Année : 2016
Année : 2016















