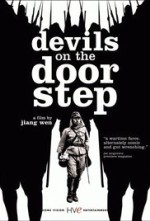Xiao Wu, artisan pickpocket
Titre original : Xiao Wu
Année : 1997
Réalisation : Jia Zhangke
Avec : Hongwei Wang, Hongjian Hao, Baitao Zuo
Tribulations d’un Chinois en Chine, ou l’errance permanente tant morale que physique, la rédemption entraperçue venant comme chez Bresson d’une femme, et puis la chute.
Jia évoque lui-même Le Voleur de bicyclette comme source d’inspiration, d’autres, Antonioni ou Hou Hsiao-hsien, et c’est vrai qu’il y a peu de dialogues et qu’on se rapproche beaucoup dans son cinéma du concept de l’incommunicabilité. Mais ce qui me frappe personnellement dans ce type d’écriture, c’est sa proximité avec celle d’un cinéaste postérieur usant de mêmes techniques narratives pour faire dialoguer peu à peu ses séquences entre elles, laissant ici ou là des indices, des éléments, qui seront repris, rediscutés, souvent transformés par la suite pour mieux montrer la subjectivité des choses et l’impossibilité de les juger correctement. Cette écriture, c’est celle d’Asghar Farhadi.
Pourtant l’Iranien est très volubile, très dense, tout le contraire en apparence du cinéma de Jia Zhangke et de ce premier long métrage en particulier. Mais les deux se retrouvent sur cette qualité, propre à certains auteurs disons non-commerciaux, européens et moyen-orientaux pour l’essentiel, de ces trente dernières années, à montrer des événements à l’apparence anodins qui, peu à peu, dialoguent entre eux. Ce n’est pas seulement l’utilisation parcimonieuse et parfois imperceptible de quelques leitmotivs, c’est l’évocation aussi de certains sujets parfois seulement abordés à l’oral, en apparence toujours anodins, auxquels on ne prête évidemment pas attention quand ils sont évoqués pour la première fois, qui peuvent revenir sous une autre forme, parfois ironique, ou pour évoquer tout autre chose, une évolution, derrière laquelle on peut ou non y lire une signification.
Ces petites évocations d’apparence anodines sont les véritables sujets de ces films. Il faut de la patience en tant que spectateur parfois, parce qu’il arrive qu’on n’y voie rien de ces évocations ou indices, et que ces rapports soient trop lâches ou insignifiants à nos yeux (Hou Hsiao-hsien, par exemple, me passe par-dessus la tête).
Le parcours presque fonctionnel que va prendre la bague dans le récit, pour prendre un exemple évident, est dans ce registre assez amusant : d’abord imaginée pour aller au doigt de sa belle, Xiao Wu se résout à l’offrir opportunément à sa mère après que sa belle a disparu ; cette même mère qui, doutant de la valeur de l’objet et quémandant de l’argent à ses mômes qui ne viendra pas, l’offrira à sa bru, et avant que Xiao Wu décide de la récupérer à la réapparition, croit-il, de sa belle…

Une belle qui d’ailleurs est une autre réussite, et un symbole même, de ce type de construction narrative : dans un récit fait d’allusions, de souvenirs, elle ne devient elle-même plus qu’allusion et souvenir. Une fois que Xiao Wu pense s’en faire sa petite amie, elle disparaît, ce qui ne fera que plonger un peu plus le pickpocket dans des errances sans fin…, et qui pour le spectateur, alors qu’il ne s’y attend pas (le personnage étant alors parti pour occuper l’espace central du récit avec le personnage principal), provoque une sorte de manque et d’incompréhension qui pourrait s’apparenter à la disparition prématurée de Janet Leigh dans Psychose. La force des hors-champ. Ce qui n’est plus peut encore hanter longtemps le cadre. C’est bien le principe des allusions et évocations diverses qui parsèment ainsi tout le film et le dépasse.
Les personnages principaux disparaissent (comme des quartiers entiers qu’on s’apprête à raser), mais on ne cesse de penser à eux, tout comme certains éléments de séquences passées qui s’invitent par petites touches dans le cadre ou les dialogues, passant du hors-champ au cadre quand ils n’auraient jamais dû y revenir : une interview de l’ancien condisciple de notre “artisan” devenu commerçant respectable et respecté évoquant son futur mariage ; une interview que Xiao Wu verra plus tard à la télévision après avoir rendu visite à cet ancien ami en essayant de gagner sans succès ses faveurs… Xiao Wu qui refuse de chanter dans un karaoké ?… On le montre par la suite chanter, seul dans un bain public… Pourquoi faire discuter les acteurs sans fin quand les séquences peuvent le faire à leur place ? Tout est comme ça. Des fils de récit qui dansent, se nouent, se défont, et arrivent, grâce à l’habileté de leur auteur, à ne jamais s’emmêler.

Avec Xiao Wu, artisan pickpocket, c’est la preuve encore que pour réaliser un film, nul besoin d’un matériel de fou et de gros moyens : il suffit d’une écriture. Jia Zhangke, né dans un trou perdu de Chine, réussit à pondre un cinéma personnel, sans les moyens d’aucune maison de production locale. Il aurait filmé en vidéo que ç’aurait été pareil. Sa qualité dépasse celle des images. Un Jia Zhangke en Chine, pourtant, mais combien voit-on de films sur Youtube ou ailleurs capables de nous proposer ça ? Une écriture sans moyens. 1997, une époque qui aurait dû être charnière comme l’avait été dans les années 60 un cinéma militant et personnel à la portée de tous (et certes disparu aujourd’hui). Au tournant du siècle, de nouvelles technologies apparaissent pour faciliter justement l’accès à l’écriture cinématographique, l’ouverture du monde… Pourtant, là encore, le vide. On cherche à l’écran les talents, quitte à ce qu’ils disparaissent par la suite. On ne voit rien, et il semblerait que Jia ait été le seul à profiter de ce tournant… avec encore un matériel du siècle dernier. Chapeau (et disparition).
Dernière chose concernant l’acteur, parce que sans, on peut rarement faire de bonnes choses (Jia le sait bien, il fera souvent tourner Zhao Tao, devenue sa femme, mais surtout une admirable actrice) : il aurait été si simple de rendre ce pickpocket antipathique, mais par sa personnalité et son talent, Wang Hongwei, arrive à la rendre un peu impassible (à la Antonioni), mais aussi beaucoup sympathique notamment grâce à une forme d’humour parfois imperceptible mais réelle (la fantaisie, toujours).
Listes sur IMDb :
✓
✓

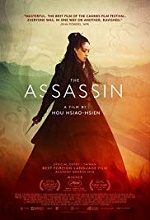
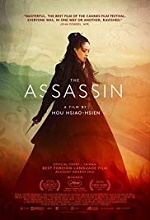

 Année : 2007
Année : 2007

 Année : 2004
Année : 2004








 Année : 2010
Année : 2010