
Les meilleurs films de femmes indépendantes
11. La Rumeur (Amelia Tilford et Martha)
Fay Bainter et Shirley MacLaine
(Lillian Hellman, John Michael Hayes/William Wyler, 1961)
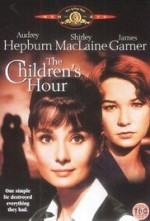
Il y aurait beaucoup à dire de ce qui est progressiste dans le caractère des femmes de cette histoire et de ce qui l’est beaucoup moins.
Si l’on omet peut-être les vingt dernières minutes, deux personnages féminins au moins semblent vivre leur célibat de manière assumée : la riche grand-mère et Martha qui n’a jamais songé au mariage (et pour cause).
Un débat possible consisterait à savoir si la grand-mère représente une figure progressive ou une autre franchement conservatrice. Pour rester sur le credo de cette liste, je continuerai à dire que quand le débat n’assène pas d’atroces évidences, il participe toujours à faire évoluer les lignes. Alors, certes, la grand-mère correspond à l’archétype de la femme riche, indépendante et conservatrice, mais c’est aussi un des personnages ayant eu le mérite de reconnaître ses torts et de le faire avec classe sans prêter attention aux conséquences de son retournement (c’est une preuve de probité et d’indépendance). On pourrait alors rétorquer que quand on a tout (et déjà une forme de pouvoir), faire amende honorable ne relève pas vraiment de l’exploit. C’est vrai, sauf que l’on sait que dans la réalité, les puissants ne se rabaissent jamais à ça.
La figure la plus représentative de ce modèle, bien que moins riche, est sans conteste celle de Rachel Cooper dans La Nuit du chasseur, interprétée par Lilian Gish : sa fonction première (voire unique) consiste à protéger les enfants qu’elle recueille. Normal dans cette logique archétypale qu’on ne lui imagine ni vie passée ni vie sentimentale.
Pour Martha, en revanche, ça se complique. Si elle ne vit que pour son métier, on apprend à la fin qu’elle voue en secret une passion amoureuse pour sa collègue Karen. Un brin sentimentaliste. Toutefois, son indépendance sentimentale (en tout cas affichée) et sociale est réelle. Cela ne peut pas faire de mal d’évoquer les peines de cœur des femmes homosexuelles, surtout quand il s’agit de mettre en évidence la solitude qui les pèse. Le personnage de Martha doit faire face à une double difficulté qui entrave sa quête émancipatrice : être une femme et être une homosexuelle.
Une dernière question pourrait se poser : la vision de Wyler de cette histoire a-t-elle altéré celle de Lillian Hellman ? En d’autres termes, y a-t-il un vernis de male gaze placé sur un produit initialement écrit par une femme homosexuelle ?
12. La Femme qui faillit être lynchée (Sally Maris, Kate et les autres)
Joan Leslie et Audrey Totter
(Steve Fisher, Michael Fessier/Allan Dwan, 1953)

Un des rares westerns où les femmes ne jouent ni des rôles de potiche ni des stéréotypes de femmes de westerns. Le film est antérieur à Johnny Guitar de quelques mois et propose plus de personnages féminins atypiques forts et indépendants (trois ou quatre).
Les confrontations génèrent un bon nombre de répliques amusantes sur la condition de la femme, même si c’est justement pour prendre le contre-pied de ce qu’on voit à l’écran, car c’est le plus souvent pour critiquer le manque de vertu et de tenue de ces garces qui n’hésitent pas à se taper dessus ou à se défier en duel.
À l’image de l’usage de la femme indépendante dans le film noir, quasiment unanimement présentée comme un modèle de dépravation, l’idée ici avait sans doute comme but, dans le respect du code Hays, d’offrir au public des personnages féminins loin d’être idéaux : le western n’a jamais cessé de montrer des meurtriers et des mauvais garçons (même si la morale s’en tire toujours à bon compte), alors pourquoi ne pas en faire autant avec les femmes et créer un pendant de la femme fatale dans le western ? Le hic, c’est que l’on s’identifie tellement à ces personnages féminins (surtout au principal) qu’adopter une démarche de ce type, c’est prendre le risque que ces archétypes censés déprécier l’image de la femme ainsi dépeinte finissent réellement par servir de modèle aux petites filles et que les hommes trouvent finalement plus attrayant leur tempérament que celui des modèles de femme gnian-gnian habituels.
Parmi les échanges, on note par exemple, après que l’une d’elles en blesse une autre en duel :
— Et si tu te comportais en femme ?
— Tu es trop lâche pour me tuer.
— Tu es née femme, mais tu es une honte pour notre sexe.
— Et toi qui gères un saloon, tu es un symbole de vertu ?
Son mari (Quantrill, fameux hors-la-loi) intervient :
— Abandonne. Elle se bat, elle tire, et elle parle mieux que toi.
Avant d’ajouter :
— Et je parie qu’elle cuisine mieux.
Ce n’est pas franchement ce que l’on pourrait imaginer de mieux comme repartie féministe. Pourtant, à côté des piques pour savoir qui est la plus vertueuse des deux, on assiste bien à une lutte de pouvoir et à une confrontation généralement laissées aux hommes.
Ici, les hommes regardent derrière les fenêtres pour se cacher des balles, et même le plus dangereux d’entre eux se contente d’observer sans intervenir. L’esprit du code Hays est respecté… tout en vantant une forme d’égalitarisme qui n’est pas sans rappeler les joutes intersexuelles des comédies pré-Code et des screwball comedies. Sauf que dans La Femme qui faillit être lynchée, cela se chamaille entre femmes, et les hommes sont réduits à un rôle d’observateur normalement laissé aux femmes.
Il faut faire attention avec les films de travestissement. On prend le risque d’y prendre goût. Quelle que soit l’idée de départ, un metteur en scène aura tout loisir de ne pas s’en servir pour moquer les personnes visées, mais au contraire, pour profiter de ce jeu millénaire qu’est le travestissement (sous toutes ses formes et à travers tous les… genres) pour abaisser les frontières et casser les stéréotypes. Dans certaines sociétés, le carnaval ou certaines fêtes usent de ce stratagème pour apaiser les tensions entre les classes, les sexes, les origines. C’est pourquoi, notamment, je suis contre la condamnation systématique des blackfaces : la pratique du travestissement en tant que tel n’est pas répréhensible. Ce que l’on peut en faire, oui.
Ainsi, qu’importe comment et pourquoi ce film a pu se faire : Allan Dwan et ses acteurs en ont fait une œuvre égalitariste basée sur la crédibilité d’un monde où les femmes, même en obéissant à certains codes de la femme « vertueuse », peuvent adopter des comportements identiques aux hommes. Et prendre leur place. L’émancipation par l’exploration des possibles, l’élargissement de notre horizon. En principe, le western offrait le terrain de jeu idéal pour cela. Dommage qu’il n’ait pas été plus souvent utilisé dans cette optique.
13. Le Journal d’une fille perdue (Thymiane)
Louise Brooks
(Margarete Böhme, Rudolf Leonardt/Georg Wilhelm Pabst, 1929)

Le choix de l’indépendance doit-il être fait en conscience ou est-ce le résultat de traumatismes et de violences subies à l’intérieur d’une société oppressant les femmes ?
Eh bien, parfois, certains personnages n’ont pas le loisir ou le privilège de choisir. Le choix, quand il existe, en fonction des époques et des régions du monde, est un privilège. Ce choix a souvent été le privilège des filles de bonne famille nées dans un environnement progressiste et sain.
L’histoire se passe dans l’Allemagne des années 20 (adaptée d’un grand succès public du début du siècle écrit par Margarete Böhme), mais elle pourrait se tenir aujourd’hui encore dans beaucoup de régions du monde. La fille d’un pharmacien se fait violer par un ami de la famille ; ses parents la rejettent ; elle perd son enfant et finit dans la rue avec comme seul moyen de subsistance la prostitution.
Le personnage qu’interprète Louise Brooks ne rêve probablement d’aucune →→→→→→→→→→→
aventure amoureuse. Les violences dont elle a été la victime ne lui en ont pas laissé le choix. Ce que ces hommes lui ont infligé l’a rendue, par la force des choses, indépendante. Seule et indépendante. Et quand l’on est ni éduquée, ni écrivaine, ni actrice, cette autonomie subie, cela signifiait le plus souvent devenir prostituée.
Ce sont peut-être aussi ces indépendances non désirées, poussant les femmes dans la misère, et cette forme de servitude ignoble, qui légitiment l’urgence d’une émancipation de toutes les femmes. Derrière les rares exemples de femmes (bourgeoises ou artistes) qui gagnent le droit de leur émancipation se cache la misère des femmes qui n’ont pas eu la chance d’un choix vers l’autonomie ou d’une formation.
Certains films ne proposent pas que des modèles à suivre ou des modèles avec lesquels s’identifier, mais des éléments aussi pour comprendre et changer la société. Il faut de tout pour faire une liste.
14. Tout sur ma mère (Tous les personnages féminins du cinéaste )
Toutes les actrices
(Pedro Almodóvar, 1999)

On pourrait discuter de l’aspect mélodramatique des films de Pedro Almodóvar : tout le monde s’aime, mais est-ce de l’amour sentimental ou un trop-plein de personnages qui ont le cœur sur la main (voire une forme, souvent, de sororité) ?
On ne pourra pas nier en revanche l’indépendance bien affirmée de la plupart des personnages (presque toujours féminins) du cinéaste espagnol.
Je ne m’attarde pas, c’est un peu une évidence. Même si certains grincheux pourraient arguer qu’il y a derrière la dévotion (ou l’amour) d’une mère pour son enfant mort, une forme de dépendance.
Hé, toutes les femmes chez Almodóvar sont indépendantes. Oui, elles palabrent pendant des heures entre elles sur l’amour et rêvent peut-être d’une romance comme des petites filles.
On s’en moque, si elles peuvent en parler des heures, c’est bien parce qu’elles jouissent d’une forme de liberté.
Le cinéaste ne décrit d’ailleurs pas forcément le monde réel, mais une forme de société idéalisée, avec ses petits drames auxquels aucune société ne peut échapper, une société idéalisée dans laquelle bien souvent la question de l’égalité et de l’émancipation ne se pose plus.
Un film d’Almodóvar, c’est un peu un Tati avec des paroles bien audibles. Le Journal d’une fille perdue décrivait un monde réel et brutal qu’il faut montrer pour le dénoncer et y remédier ; Tout sur ma mère décrit un monde presque idéal pour les femmes, plein de fantaisies, de tragédies et d’amour. Il faut de tout pour faire une liste (et du cinéma).
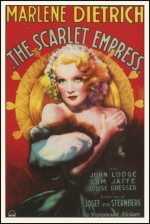
Question : Catherine est-elle animée par une quelconque pulsion amoureuse quand elle trompe son mari ou tout n’est-il que calcul ?
J’aurais tendance à penser qu’il n’y a rien de romanesque dans L’Impératrice rouge. Mariée trop tôt à un imbécile (lui-même mené par le bout du nez par une autre femme indépendante : sa mère, l’impératrice Élisabeth), elle déchante vite et bientôt se servira de ses amants pour affirmer son pouvoir.
De manière générale, les personnages incarnés par Marlene Dietrich, malgré les apparences, n’ont que faire des interactions romantiques. Un peu à la manière de Garbo, sa présence à l’écran émanait principalement d’un paradoxe, voire d’une contradiction, qui rapprochait sa relation avec les hommes à… des séances d’hypnose ou de trans entre deux êtres de nature différente.
Leurs personnages ont presque toujours vocation, comme dans n’importe quel film romantique, à trouver l’amour, pourtant, parions que l’une et l’autre n’ont jamais éprouvé le moindre désir pour les hommes. Garbo était probablement homosexuelle ; Dietrich semblait sincèrement se plaindre qu’elle n’ait vécu que des histoires imparfaites, mais j’ai du mal à être convaincu par son intérêt pour les hommes (elle aurait été bisexuelle, mais quand on songe à ses rapports avec Gabin, par exemple, cela évoque plus une relation entre potes qu’à des amants).
L’une et l’autre, quand on connaît leurs trajectoires personnelles, pourraient même faire →→→→→→→→→→
penser à des femmes asexuées (bien qu’ayant participé à une industrie sexualisant largement les femmes). Et y a-t-il une plus grande indépendance que celle d’être libéré de ses pulsions sexuelles et sentimentales ?
Tout cela n’est peut-être que vaines spéculations, mais il se dégage de leur présence à l’écran un quelque chose d’étrange, loin des standards féminins auxquels certaines femmes, habituellement exclues des logiques d’identification des films avec leurs schémas très hétérocentrés, pouvaient se retrouver.
Peut-être est-ce au contraire dû à l’intelligence supérieure des deux actrices (face aux hommes qui leur sont proposés), faisant de ces femmes des êtres tellement détachés de leurs partenaires qu’elles en deviendraient des créatures indépendantes malgré elles. Restent, dans ce cas, les deux questions suivantes. Une indépendance subie devrait-elle être considérée comme une forme d’émancipation ? Et l’émancipation naît-elle d’un désir ou est-ce un état, une conséquence subie ?
Accessoirement, c’est parce que tout cela demeure flou, incertain et sujet à interprétation que ces films de l’âge d’or d’Hollywood supposés être romantiques sont parfois si fascinants. L’une et l’autre sont moins des « femmes fatales » que des « femmes froides et distantes », non par calcul, mais par désintérêt romantique — la propre fille de Marlene Dietrich, Maria Riva, la décrira d’ailleurs comme froide, manipulatrice et pas du tout maternelle.
16. New York-Miami (Ellie Andrews)
Claudette Colbert
(Samuel Hopkins Adams, Robert Riskin/Frank Capra, 1934)

Je sais, il est question de romance. J’explore les limites du cadre défini. Sans limites, pas de cadre.
Une romance, donc, mais quelle romance ! Une romance dans laquelle, pour ainsi dire, les rôles s’inversent dans les rapports de force traditionnels entre amoureux. Ce ne sont plus les hommes qui mènent la barque et les femmes qui suivent, toutes enamourées, mais le contraire. À défaut, dans toutes les screwball comedies, et à partir de celle-ci, une joyeuse empoignade s’engage pour savoir qui entre la femme et l’homme portera la culotte.
Le principe de la comédie est d’inverser les rôles pour se moquer ? Peut-être. Sauf qu’à force… d’explorer certaines limites, on les repousse. Quand on travestit des personnages en leur faisant changer de classe ou de sexe, cela a toujours été pour en révéler la nature superficielle, hypocrite ou injuste. Quand on inverse alors les rôles entre celui qui est censé séduire, gouverner, et l’autre qui devrait se contenter de suivre, personne ne se laisse faire, et l’on explore les possibles.
Ce premier round des hostilités loufoques se →→→→→→→→→→
fait par l’intermédiaire d’une femme de bonne famille. Et comme souvent, cette femme se rebelle contre le désir du père ou contre les conventions sociales. Elle est là, d’abord, l’indépendance. Vient ensuite la séduction… démocratique : on est en Amérique, tout le monde est susceptible de tomber amoureux de tout le monde (ici, un journaliste sans le sou).
En réalité, ces rapports de force, ces types de relations où la femme a son mot à dire existent depuis un moment dans la littérature ou dans le cinéma muet (les personnages interprétés par Louise Brooks, et ceux, par exemple, dans un registre déjà plus souvent comique, de Clara Bow, dans It) ; la screwball comedy, ou la comédie de remariage, ne viendra qu’apporter de nouvelles normes (éphémères) à cette réalité.
Qu’est-ce que l’indépendance sentimentale ? Être hermétique et insensible à l’amour ou vivre ses amours en toute liberté sans souci des conventions et des pressions sociales ou familiales ? C’est ma liste, je réponds donc : les deux.

Certes, le personnage de Marcia n’est pas au cœur du film, et même s’il y a une vague romance entre les deux protagonistes, je ne me rappelle pas que cela relevait de la plus haute importance dans le développement du récit. À côté de ça, en pleine Amérique conservatrice, Marcia n’est pas loin de représenter ce qu’il se fait de mieux en matière de femme indépendante : journaliste qui impose ses idées, c’est bien elle qui possède le pouvoir et qui constitue le véritable cerveau du film. La relation romanesque est vite évoquée parce que c’est quasiment un prérequis dans un film hollywoodien, mais cela n’entame finalement pas les caractéristiques principales du personnage. C’est bien elle, Marcia, qui finira par détruire le monstre qu’elle avait contribué malgré elle à faire naître. Elle est dans la position du docteur Frankenstein. Pas du tout dans celle de la créature à laquelle très souvent (mais pas seulement) les rôles féminins sont cantonnés.
Ce n’est pas une exclusivité dans les rôles tenus par Patricia Neal. La femme autonome (toujours avec ces réserves liées aux obligations de développer des intrigues romantiques à Hollywood) a constitué tout au long de sa carrière une forme de credo personnel. Le Jour où la Terre s’arrêta, Le Rebelle, Le Plus Sauvage d’entre tous, Courrier diplomatique : elle a presque invariablement incarné des femmes indépendantes, veuves, célibataires, →→→→→→→→→→→→
et cela sans forcément avoir un registre de femme fatale (ce n’était d’ailleurs plus l’époque).
Elle personnifiait donc cette image de la femme autonome financièrement, riche, parfois certes, éduquée, à l’opposé de l’archétype dominant d’alors (femme au foyer ou amenée à le devenir).
Cette spécificité de l’actrice ne coïncidait pas avec des personnages négatifs (à l’inverse des femmes fatales dont le but originel consistait à présenter les femmes indépendantes comme des femmes de mauvaise vie dont il fallait se méfier), même si l’on peut reconnaître qu’on peut parfois flirter avec une idée de pitié ou d’anti-héroïne (notamment en insistant sur la solitude relative des rôles qu’elle interprétait).
L’image de la femme émancipée donnée par l’actrice à l’écran était-elle globalement positive ? Je pense que oui. C’est l’essentiel. Loin d’être le faire-valoir du personnage masculin, elle est au contraire celle qui a tout pouvoir sur lui. Marcia, c’est le docteur Frankenstein, c’est celle qui ramène King Kong sous les projecteurs et qui le voit lui échapper avant de se résigner à le tuer. Marcia, c’est le matador. Marcia et les autres personnages incarnés par l’actrice annoncent même d’une certaine façon Ripley dans Alien (je m’emballe, j’explore les limites).
18. Mirage de la vie (Lora Meredith)
Lana Turner
(Eleanore Griffin, Allan Scott, Fannie Hurst/Douglas Sirk, 1959)

On a beau se retrouver dans un film de Douglas Sirk, l’intrigue sentimentale est sèche, râpeuse même.
Entre familles monoparentales et entre femmes seules, peu importe la couleur, on se serre les coudes, et quand la réussite pointe le bout de son nez en même temps que l’amour (les deux viennent souvent ensemble), Lora préfère encore privilégier sa carrière. Si ce n’est pas la preuve d’un personnage indépendant, je ne sais pas ce qu’il vous faut.
Évidemment, ça ne peut que tourner mal (autrement, on n’en ferait pas un film) : le destin doit être un mec, et comme autrefois dans les légendes antiques, on punit les « hommes » (les femmes donc ici) qui osent défier l’ordre des dieux (les anges n’ont pas de sexe ; les dieux, si).
On remercie une nouvelle fois Hollywood (même sous influence du code Hays) d’avoir adapté le roman d’une femme, parlant de femmes, pas strictement destiné aux femmes. Hollywood n’a pas été qu’un repère de machos et n’a pas servi aux spectateurs qu’une soupe réduisant les femmes au foyer. Si les phallocrates étaient au pouvoir (et en abusaient), ils étaient →→→→→→→→→→→→→→→
aussi pragmatiques et cherchaient avant tout à ramener le public dans les salles. La moitié de ce public étant féminin, tous les films à destination supposément des femmes étaient-ils des romans à l’eau de rose ? Non. L’histoire se révèle plus nuancée : le cinéma a permis d’illustrer à l’écran et de forcer certaines évolutions et pratiques qui se retrouveront ensuite dans la société.
L’usine à rêves porte bien son nom : les rêves ouvrent des portes sur ce qu’il est possible de faire, possible d’être, explorent des situations en en décrivant les ressorts, les aspirations et les écueils.
Aucun autre secteur que le cinéma (à Hollywood et peut-être un peu ailleurs) n’a œuvré autant pour changer le rôle de la femme dans la société. Était-ce suffisant ? Non. Mais c’est la société qui était à la traîne du cinéma, pas le contraire.
La réussite ou l’ambition des femmes (au détriment d’une vie sentimentale, voire familiale) n’a pas vocation à tourner toujours en tragédie. Il n’y a pas que des mélos à Hollywood. Et celui-ci piétine les attentes d’un mélo sentimental : « On se marie ? » « Non. Je pense à ma carrière. »

Il est amusant de noter, quand on lit le synopsis (parce que personne n’en a jamais rien eu à faire ou n’a jamais rien compris au film), que le point de départ de l’intrigue repose sur un homme qui prétend avoir demandé la main d’une femme (l’année précédente) et que la femme en question affirme au contraire ne pas s’en souvenir.
Quoi de plus révélateur de l’indépendance d’une femme que de ne rien savoir sur elle sinon qu’elle a dit « non » à un homme ? (Ou peut-être pas.)
Tout chef-d’œuvre est affaire d’alchimie. Le film de Resnais n’aurait sans doute pas rencontré le succès sans la présence magnétique et mystérieuse de son actrice (ou même sans les délires stylistes d’Alain Robbe-Grillet, mais c’est une autre histoire).
Il y a peu d’actrices qui ont su incarner à l’écran à la fois la classe et l’indépendance dans une étrange impression mêlée, faite de séduction et d’asexualité. Il y a eu Greta Garbo, il y a eu Marlene Dietrich, il y a eu Katharine Hepburn. Toutes presque toujours collées à des hommes. Et il y a eu Delphine Seyrig. Qui dit : « Non, je ne me rappelle pas votre demande. Allez jouer à votre jeu idiot. Laissez-moi, je vais fumer sur la terrasse. »
Ce ne sont plus des femmes fatales, ce sont des femmes platoniques : des femmes qu’on ne se surprendrait pas (en tant que spectateur) à aimer d’un amour sexuellement désintéressé. No sex, no love, no marriage, just a bit of platonic seduction, and you.

Nouvelle screwball comedy, plus tardive, mais loin d’être la plus mauvaise…
Évoquons le personnage de Rosalind Russell : une journaliste, pas vraiment du genre gratte-papier, plutôt à succès, plus futée que nombre de ses collègues (parmi lesquels, son ex-mari), et bien décidée à faire valoir ses droits.
L’amusant dans l’affaire, plus typique encore que dans les autres comédies de remariage, c’est qu’il n’est, à proprement parler, pratiquement jamais question d’amour : la journaliste envisage bien d’épouser un nouvel homme, pourtant, aucune passion ne semble unir les deux « partis ». On se marie un peu par commodité sociale, un peu comme on change d’appartement.
Le mari n’est plus qu’un partenaire ou qu’un colocataire. L’ex-mari ne montre d’ailleurs pas beaucoup plus d’enthousiasme pour elle ; et pour la reconquérir, il sera loin de privilégier la séduction. C’est que la dame « du vendredi » est plus journaliste que femme, et son ex-mari plus patron qu’ancien amant…
À regarder Rosalind Russell évoluer au milieu de tous ces hommes, le stéréotype de la femme enamourée paraît d’un coup démodé.
Cette forme d’égalité se traduit d’ailleurs dans son apparence : si, au début du film, un chapeau à la dernière mode couvre sa tête, une fois dans le feu de l’action, elle passe au tailleur strict, l’équivalent direct du costume des hommes qu’elle fréquente. Sa taille lui permet aussi de tenir tête à Cary Grant.
Si, avant la comédie de remariage, le cinéma avait proposé des représentations de la working girl, elle ne sera jamais aussi émancipée que dans cette série de films où les femmes luttent d’égal à égal avec les hommes. Même la it girl paraît dépassée (elle qui jouait beaucoup sur la séduction).
Paradoxalement, c’est en gommant toute forme de sexualisation (imposée par le code Hays) qu’Hollywood a fait de cette femme moderne l’égale des hommes. Car sans séduction, que reste-t-il ?
Le pouvoir de séduction sera réservé aux femmes de mauvaise vie dans les films noirs qui commencent à apparaître avec ses femmes fatales.





