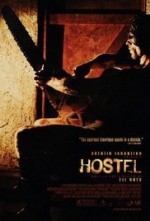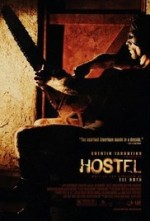Un brin de Godzilla, un autre du Projet Blair Witch, le tout saupoudré d’Alien, des Monstres attaquent la ville ou des Dents de la mer ou encore de Starship Troopers. La dramaturgie est bien sûr réduite au minimum. On voit rarement le monstre dans son intégralité. On a droit au début à une scène pour présenter les personnages qui, un à un, mourront (ce n’est pas un spoiler ça, c’est le principe de tous ces films). Le seul fil conducteur étant de rejoindre une amie à l’autre bout de Manhattan en essayant de survivre aux monstres… Bref, tout est basé sur le « naturalisme » et la linéarité des événements. En cela, c’est vraiment semblable à Blair Witch. Après l’horreur, le film catastrophe donc joue avec les différents niveaux de réalité.
On avait déjà vu ce que les effets spéciaux étaient désormais capables de faire en matière de réalisme dans Le Fils de l’homme, dans la scène du débarquement d’Il faut sauver le soldat Ryan et dans la scène de bataille spatiale du dernier volet Star Wars. Comme dans le Fils de l’homme, l’idée est la transparence des effets pour accentuer le réalisme, la peur. C’est la technique qui se met au service du récit. Alors parfois, c’est un peu surfait. Le paradoxe, c’est que les moins crédibles, ce ne sont pas les images mais les acteurs, même si sur ce point, ils s’en sortent vraiment pas mal vu la difficulté d’être crédible et juste dans ce genre de truc qui se veut ultra-naturaliste.

Cloverfield, Matt Reeves 2008 | Pictures, Bad Robot, Cloverfield Productions
Si on ne voit rien, c’est que c’est produit par J.J. Abrams
On peut aussi penser que c’est un film directement issu du 11 septembre. Si les vieux films de science-fiction mettaient en scène les peurs contemporaines des Américains, à savoir la peur de l’invasion des Rouges, là c’est pareil, le danger vient de l’extérieur et s’attaque à la ville. La différence, c’est qu’il est moins défini, plus insaisissable. On ne sait pas s’il s’agit de monstre marin, d’extraterrestre, de créatures issues de la folie des hommes…, peu importe, l’Amérique est attaquée ! (D’ailleurs, ce n’est pas une coïncidence si Invasion est là encore comme une énième version de L’Invasion des profanateurs de sépultures… Hollywood n’a pas cessé d’adapter cette histoire, avec dernièrement, une version télévisée en série et donc ici aussi avec le film avec Kidman.)
Après le 11 septembre, les Américains avaient cessé de faire ce genre de films par respect pour ce qui s’était passé. Mais l’Amérique digère ses démons en les imprimant sur pellicule et les digère vite. Des films comme Independance Day ou Armageddon, en dehors de leur (manque de) qualité, sont la véritable identité de l’Amérique. Un pays basé sur le mythe de l’Eldorado, fait de bannis, d’exilés, de persécutés, et s’isolant du reste du monde pour s’en protéger. Et donc, paranoïaque face aux menaces extérieures.
Il serait intéressant de comparer la culture américaine avec les deux autres civilisations qui ont une histoire d’isolationnisme. On remarque dans la culture nippone une même peur de l’apocalypse, de l’étranger venant d’un ailleurs inconnu (cf. Godzilla). Le Japon a connu deux catastrophes nucléaires sur son sol. La Chine, elle, n’a pas vraiment cette culture, alors même que son voisin l’a bel et bien envahie (et d’autres depuis deux siècles). C’est un peu comme si la Chine se suffisait à elle-même, qu’elle était trop imposante pour servir de cible aux monstres et aux catastrophes. Tu peux attaquer la Chine, mais c’est si vaste, si dense, que tu ne fais que lui bouffer deux ou trois feuilles de mûrier — le mûrier, lui, dans l’imaginaire collectif, est immuable. Sa culture est basée surtout sur des conflits à l’intérieur même de son territoire ; jusque dans sa culture, la Chine est restée très refermée sur elle-même. Même la culture issue de Hong-Kong reste très axée sur elle-même, voir vers la Chine et quand Wong-Kar Wai s’expatrie dans le Sud-Est asiatique ou en Argentine, ce n’est évidemment pas pour montrer l’étranger sous un mauvais jour (d’ailleurs il ne les montre pas, ce n’est qu’un décor). Il y a peut-être une culture similaire en Corée, influencée par le Japon ou par mimétisme par la Corée du Nord… avec l’arrivée de quelques films catastrophe avec des grosses b-bêtes qui tuent la ville (donc la nation).
Chaque culture met en scène ses propres démons. L’Amérique met en scène ses peurs de l’étranger. Ça se traduit soit par des récits remplis de violence urbaine, soit par de récits métaphoriques à travers tout le cinéma de genre. Le Japon tente de vivre après l’apocalypse d’Hiroshima, la Chine revisite son époque médiévale pour échapper à la censure ou traduit l’oppression des communautés de quartiers, du communisme en général à travers la mise en scène de truands qui ont tout pouvoir dans un monde sans justice, sans police.
Et l’Europe dans tout ça ? Les Allemands ne sont jamais aussi bons que quand ils revisitent leur histoire (Goodbye Lenine, La Vie des autres). Les délires de Visconti et surtout de Fellini ont été les fossoyeurs du cinéma italien ; Nanni Moretti et Benigni émergent de temps en temps, mais le néoréalisme et la comédie italienne n’ont pas eu de suite. La culture aujourd’hui, en Italie, elle est sur les chaînes de Berlusconi…
En Espagne, on semble se tourner rarement vers le passé, ou sinon l’époque franquiste n’est qu’un décor. Le meilleur film sur cette époque est sans doute anglais avec Land and Freedom de Ken Loach. Seul Almodovar a émergé. Ses délires étant le signe d’une liberté nouvellement acquise. Il s’est depuis assagi, mais ses films restent des farces intemporelles, d’excellents films qui pourraient être aussi bien japonais ou français ; c’est un peu de la world culture…
L’Angleterre n’a pas à se trouver une culture, elle n’a pas de démons à affronter (à part du côté de l’Irlande peut-être…) car elle n’est finalement devenue qu’une sous-culture de la grande Amérique. Elle est après Hollywood, le centre cinématographique américain : une très grande partie des stars us sont en fait britanniques, ainsi que ses techniciens, une partie du phénomène pop musique est née là-bas ; le seul démon qu’elle pourrait avoir, c’est l’Amérique elle-même… sinon, qui irait se plaindre de la Reine ? (À noter toutefois qu’on peut voir James Bond comme le fantasme ou la nostalgie de la puissance de l’empire britannique).
Et en France ? Elle est schizophrène. Autrefois sa culture était au centre de toutes les attentions ; aujourd’hui, elle déprime en se sentant peu écoutée. Surtout, elle ne cesse de vouloir se comparer à la culture dominante qu’est la culture américaine, parce qu’elle ne connaît rien d’autre qu’être le centre de toutes les attentions. Jalouse, elle essaie d’imiter, mais ça ne marche pas (et pour cause, on n’intéresse pas grand monde quand on parle des démons des autres). Reste des genres peu appréciés du grand public qui ne voit que par la culture américaine, ne cesse de réclamer des chewing-gums aux G.I venus les délivrer, et qui en en ayant honte se reporte vers la découverte des autres cultures du monde (au lieu de se tourner vers sa propre histoire, ou ses propres mythes, comme on le fait donc en Chine par exemple). Comme l’Angleterre, si la culture française avait un démon ce serait la culture américaine, la peur de devoir se comparer à elle, la peur d’être oubliée et de ne plus être jugée à sa juste valeur telle une grand-mère qui rappelle à ses enfants qu’elle aussi était belle autrefois. La culture française a pourtant des démons qu’elle met souvent en scène mais qui attirent peu l’attention de son public. Nos démons d’aujourd’hui sont la peur de la précarité, le conflit social ou familial. Bienvenue chez ceux qui n’ont pas de problèmes. Problèmes de riches, de gens heureux (qui ne le savent même pas). Les gens heureux n’ont pas d’histoire. C’est parce qu’on ne vit pas mieux dans aucun pays du monde qu’il est difficile de se trouver des démons à combattre. Les nôtres sont minuscules, donc risibles. Parfois. Surtout quand le pays de l’existentialisme hésite entre la Maman, et la Putain. Chez Maupassant, chez Flaubert non plus il n’y a que des conflits de genre « minimes », mais ils ont été portés par le rayonnement d’une culture à son apogée. S’ils vivaient aujourd’hui, ils seraient dépassés. Ce qui intéresse chez eux, c’est l’environnement bien français de la fin du XXᵉ siècle. Un environnement déjà décrit dans d’innombrables récits ; même s’ils nous décrivent un petit village de campagne sans intérêt ou une chambre à Paris, ça nous paraît déjà fantastique rien qu’à leur évocation ; parce qu’il y a derrière tout ça une culture qui nous est familière, qui est familière au monde entier. Difficile d’avoir été quand on est plus, on ne sait quoi faire… Copier, réinventer ? On se cherche…
Le plus ironique dans tout ça, c’est que, souvent, en dehors de la culture us qui n’a jamais de peine à mettre en scène ses démons. Freud s’il n’avait pas été Viennois aurait été quelques décennies plus tard Américain ─ d’ailleurs ses « théories » ne sont pas plus populaires ailleurs qu’aux USA, partout ailleurs, sauf en France, il est dépassé), les cultures elles-mêmes ne sont pas toujours les mieux placées pour parler de leurs propres démons. Du moins, de les affronter directement. Le meilleur film sur Hiroshima, le plus explicite, c’est un film français, Hiroshima mon amour. Le Tombeau des lucioles par exemple aurait pu traiter le sujet, mais a glissé timidement sur autre chose, une autre catastrophe (mais un démon tout à fait identique. Le meilleur film sur la part d’ombre de l’histoire française a été réalisé par Kubrick, avec les Sentiers de la Gloire et ses « fusillés pour l’exemple » durant la grande guerre. Les films sur la résistance ont été nombreux, mais sur la collaboration, sur le régime de Pétain, finalement, c’est timide. On préfère encore se souvenir des héros, plutôt que des monstres, or les héros sans monstres ne sont rien, et là, c’est comme si ces héros ne faisaient jamais face à leurs démons, comme si c’était du vent. Les collabos ? En dehors de Lacombe Lucien, je n’en vois pas beaucoup, sinon des crapules juste bonnes à glorifier les autres qui eux sont des héros. Et puis, il y a La Bataille d’Alger… forcément, un film italien.
Il y a un domaine que les Français devraient donc aussi creuser, au lieu de vouloir imiter la violence urbaine américaine (totalement inexistante en France ou presque), c’est le film catastrophe ou de science-fiction sur la peur des envahisseurs, de l’intrus, de l’étranger. On cherche parfois à imiter leur violence urbaine alors qu’on habite sans doute dans un des pays les plus sûrs au monde, où il fait le plus bon vivre, alors qu’on a un point commun avec eux, même si notre approche est sans doute encore plus schizophrène, c’est la peur de l’autre, de l’intrus, de l’infiltré. La série V aurait dû être française (elle tire d’ailleurs son inspiration de la résistance française pendant l’occupation), toute la gamme de films sur le thème des Envahisseurs auraient sans doute une crédibilité. Restera ensuite bien sûr de ne pas aller vers le sens de cette peur… « On va vous faire peur, et vous avez raison d’avoir peur !!! »
Encore faut-il avoir des auteurs disponibles et écoutés (on peut avoir des auteurs, mais ils ne sont pas toujours pris au sérieux… Ainsi entre mille exemples on peut citer La Planète des Singes de Pierre Boule, Papillon de Henri Charrière, Le Salaire de la peur de Georges Arnaud également adapté par Friedkin alors que le film pour le coup de Clouzot était une grande réussite ; et nos auteurs populaires, le plus souvent, faute de culture d’adaptation cinéma, iront voir du côté de la BD). On pourrait traiter la Guerre d’Algérie, les attentats de la fin des années 90, le déploiement d’armée ou d’ONG dans le monde… Même ça, on ne fait pas, on préfère laisser faire par les autres. Quand la femme (française) de Richard Pearl sort un bouquin, ce sont les Américains qui l’adaptent…
On n’aime pas mettre en scène nos peurs ? Et donne des leçons de morale au monde entier et on n’est pas capable d’apporter un jugement critique sur nos propres démons. S’il y avait à définir l’esprit français, le voilà. Et si par hasard un type prenait le risque de parler de ses peurs, on crierait tout de suite (en j’en ferais probablement partie) au balourd. À défaut d’avoir encore des loups pour nous faire peur, on tire sur les balourds (oui, je suis lourd). Ce n’est pas ce qui est arrivé à Kassovitz avec L’Ordre et la Morale ?
Au fond, on peut se rassurer autrement. Si on n’a pas (ou plus) d’auteurs français qui influencent la culture du monde, au moins, on peut être fier d’avoir une économie (grand paradoxe) qui fait vivre une bonne partie du cinéma du monde (hors USA). Sans Canal+, ou Arte, et sans les redistributions sur recette à la production française (qui produit une très grande part dans le cinéma hors France), certains cinémas étrangers n’existeraient pas. L’influence de la culture française, elle est là. Pas d’auteurs, mais des producteurs. Une sorte de grand programme pour l’aide au développement cinématographique… Un vrai paradoxe (une autre schizophrénie) pour cette culture qui met en avant autant « la politique des auteurs »… sans en avoir, ou plutôt qui refuse de voir les siens… Ou qui considère qu’un cinéaste qui met en scène nos peurs contemporaines n’est pas un auteur (nouvelle ironie, un film comme Cloverfield n’aurait pas du tout été possible en France à cause de son aspect purement commercial, pourtant les Cahiers adorent le film…). De David Lynch à Almodovar, en passant par Wim Wenders, Nanni Moretti, Wong Kar-wai, Aki Kaurismaki ou Theo Angelopulos, les fonds français sont partout. Et tels les bons marchands, il n’y a pas mieux que nous pour mettre en valeur les produits venant de ces ailleurs, à travers une quantité impressionnante de festivals sur tout notre territoire. La France, c’est ni Florence, ni Vienne, mais c’est déjà Venise, et ce n’est déjà pas si mal. Mais faisons en sorte maintenant de ne pas couler… En acceptant de produire nos merdes sidérales, nos films qui font peur. Il y a des vertus cathartiques à regarder un film qui s’attaque à nos peurs. On ne prend plaisir qu’en face des peurs des autres, on ne nous met jamais en danger… Tu m’étonnes ensuite qu’on se bourre de médocs. Le monstre de Cloverfield pourrait bien résorber le trou de la sécu ! Mais oui…
Heu, oui Cloverfield… He ben, j’ai été dévoré par le monstre du hors sujet. Zavez pas vu ma main trembler ? Voilà une capture que j’ai pu préserver dans la pagaille :



















 Année : 2006
Année : 2006







 Année : 2007
Année : 2007




 Année : 2004
Année : 2004