(Première lampée de notes.)
Tout chez Tarkovski est action. Parce qu’il ne peut rien y avoir d’autre. Le cinéma n’est que mouvement et son, et le visuel, c’est l’action. Et c’est l’action qui amène le sens.
Les images, qu’elles soient “tableaux” ou non, possèdent toujours en elles l’essence d’une “action”. Pas forcément toujours au sens de mouvement, mais de “faire”. Qu’y a-t-il là ? Que sont-ils en train de faire ? Si Tarkovski fait sens (comme tout le cinéma, mais pas toujours justement à cause du manque « d’action »), c’est bien parce que chacun de ses “tableaux” est d’abord une action. Pour être plus clair, on pourrait presque dire que les plans de Tarkovski peuvent se traduire par un verbe. Le verbe est toujours action, et c’est lui d’abord qui fait sens.
Un sens qui pourra alors, et alors seulement, être sujet à interprétation.
Faire sens, ce n’est pas forcément, se faire comprendre. C’est là que Tarkovski transcende ce qui n’était au départ seulement qu’une action, et que par elle seule, il parvient à donner du sens à ses images : c’est une fois seulement que l’action apparaît, qu’elle peut disparaître au profit d’une logique qui ne peut être perçue, comprise, que sur la durée. Le verbe, l’image, le sens, s’organisent autour d’un discours, d’une langue mystérieuse, qui comme la musique, est celle d’un récit commun à tous les hommes. Si les langues des hommes diffèrent, leurs histoires, leur cœur, leurs aspirations, leurs espoirs sont les mêmes. Qu’importe alors le détail, les tableaux ne sont plus que des prétextes, des supports qui dans leur particularité atteignent l’universel.
L’action particulière appelle le sens impersonnel et universel. « Je vois ce que tu veux dire, je n’en comprends pas précisément le sens, mais au-delà de la compréhension, ça me parle. »
C’est en ça que Tarkovski est poète. Ce qu’il décrit, montre, dévoile des interrogations communes à tous. En interrogeant les images de sa mémoire, il questionne la nôtre. Les actions gagneraient un sens plus précis, ou il tenterait d’offrir directement un sens, sans passer par l’éloquence de l’action, il ne ferait qu’expliquer ce que lui voit ou perçoit sans doute en lui, mais que son public se refuserait toujours à voir. Parce que le cinéma, le récit, c’est une histoire qu’on raconte aux autres. Et ces autres viennent y trouver un passeport pour se hisser en haut de leur propre mémoire, de leurs propres sensations ou réflexions. L’art montre, ne démontre pas. Au lieu d’être discursif, il serait plus « sur-discursif ». C’est-à-dire qu’il en donne l’illusion. Au spectateur.
Une femme qui court. Un moineau qui se pose sur le bonnet d’un enfant. Du lait qui coule d’une table. Une cabane qui prend feu. Le vent dans les herbes hautes qui souffle… Ce sont des images, mais elles décrivent bien une action : ce n’est pas seulement un tableau, là maintenant, il se passe quelque chose qui ne se passe pas par “ailleurs”. Des images parfois sorties de leur contexte (il n’y en a pas toujours), mais qui étonnent par leur singularité immédiate. Plus que des “actions”, peut-être, ce sont des « faits divers ». Des attractions, dirait sans doute Eisenstein. C’est-à-dire, des images fortes. Qui collées les unes après les autres prendront sens ou pas.



Le sens, souvent obscur, chez Tarkovski, qu’il soit personnel, mystique, religieux ou philosophique, il reste au spectateur de l’interpréter. Au contraire d’un film qui use de symbolisme comme on se lance des private jokes à table. S’il y a du symbolisme chez Tarkovski, il n’est pas exclusif, excluant, parce que Tarkovski reste toujours sur le seuil du sens, ne fait que le suggérer, hors-champ, donc dans l’esprit seul de celui capable de le deviner. Au contraire de la théorie du montage des attractions d’Eisenstein (superposition d’images de différentes situations ou saynètes censées proposer un sens immédiat, une sensation forte, à celui qui les regarde), le cinéma de Tarkovski propose plutôt un montage des illusions : au lieu de chercher en permanence à provoquer un choc des images qui fasse sens, comme un champ-contrechamp permanent, fascinant mais pas toujours logique, héritier des premiers montages de Brighton, Tarkovski adopte un angle qui lui permet de mettre à distance la situation (principe du tableau) et préfère retarder la compréhension des images montées si elles se répondent, comme pour suggérer par la résistance, la lenteur, un sens au-delà de l’image et de la percussion des images. Ce qui ne marchait parfois pas chez Eisenstein (lui-même le reconnaîtra) quand il prétendait que le spectateur pourrait comprendre de tels montages, Tarkovski décide, lui, d’assumer cette incompréhension et de jouer sur la tension et d’infimes variations à l’intérieur des images et de la bande sonore pour laisser le temps au spectateur de tenter d’en saisir le sens. Au lieu d’être inondé par un mitraillage d’images dont il ne pourra très vite plus comprendre la logique d’ensemble, on est ainsi au contraire plongé sans malaise à la soupe tarkovskienne. Ce qu’on peut nommer alors « poésie » peut ainsi se laisser appréhender à travers chaque plan, parfois même à travers la moindre image. C’est ce qu’on voit avec l’affiche du film (une affiche, par principe, ne renvoie à aucun montage, mais on remarque déjà la position de la caméra, alors que dans la séquence même, l’image à venir est déjà suggérée hors-champ par une agitation sonore, puis Tarkovski retarde son dévoilement, et plus encore, préfère montrer toujours ses personnages regarder de dos, et dans le même plan, plutôt qu’organiser un champ-contrechamp qui serait à la fois plus courant et plus significatif ; ou moins : en déstructurant ainsi ses “actions” et en se refusant au jeu facile des dialogues d’images, c’est bien un sens caché qu’il suggère et à qui il appartient à nous seuls d’en proposer l’interprétation).
Eisenstein et Brecht avaient comme ambition de donner un sens précis à leurs “tableaux” (qu’ils soient “montés” ou « épiques), un sens, parfois même, qu’on pourrait juger de politique. C’était probablement une erreur. Je le répète souvent, cette ambition de faire passer un message à travers un récit a échoué. Et c’est sans doute mieux ainsi. Les messages sont toujours compris de travers. Chez Tarkovski, en revanche, en jouant un peu plus sur la distanciation chère à Brecht, mais une distanciation, paradoxalement utile à prendre de la distance avec le sujet (ou l’objet du film) jusqu’à ne plus le voir flou, tandis que la distanciation chez Brecht consistait précisément à se rapprocher du sujet par une mise à distance avec le dispositif narratif de toute histoire censée provoquer une forme d’identification. Et le flou chez Tarkovsi, c’est sa poésie. Il nous livre des “attractions”, ou des “illusions”, et le spectateur se débrouille avec ça.
Art et philosophie (voire politique) ne font pas bon ménage. L’un altère toujours irrémédiablement l’autre. Et c’est pourquoi l’art, le récit, ou le cinéma, ne peut être, au mieux, que poésie. Bien sûr, une histoire peut s’attacher à décrire une thématique, un raconteur peut s’appliquer à établir un angle. Mais les actions, les faits, qui y sont montrés ne sont qu’un vecteur possible donnant accès au sens. Celui-ci ne sera jamais que suggéré. Les explications, toujours, réservées aux spectateurs.
(Besoin de revisionner, pour en dire autre chose.)
Révision :
Le temps, le temps qui passe… ou du temps suspendu…, je sais pas, mais c’est putain de beau. De la grâce, de la poésie.
Je pourrais regarder pendant une heure, un siècle, la nuque d’une femme tandis que le vent caresse les herbes pour annoncer l’arrivée d’un type qui pourrait être à la fois celui qui lui souffle dans les cheveux, celui qui se fait souffler la place ou qui se fera souffler sur la commode, on s’en moque, surtout que pour expliquer ces grands mystères, il y a ces mots russes d’une putain de saloperie de beauté et qui veulent strictement rien dire parce qu’on ne lit déjà plus les sous-titres, et parce qu’au fond, ça ne peut dire qu’une chose : « Ferme ta bouche ô spectateur, parce que ton souffle divin retombe d’un peu trop près sur les images ! » Et pis un peu plus loin : « Ô spectateur, fais donc attention, tu viens de renverser cette bouteille de lait, mais regarde ! Regarde un peu ce que tu as fait ! » Et nous : « Oh mais papa, dis, c’est quoi cette bouteille de lé ? »
Il y a des films qu’on aime, plus comme des œuvres, mais comme une femme, une mère, comme une blonde, comme une caresse… Celui-ci, c’est « oh ! chéri ! » et il peut rendre totalement gaga, comme suspendu à un fil de morve, balancé entre les reliures pelliculées du temps.
Le vent souffle nord-nord-ouest, aujourd’hui, on dirait.




















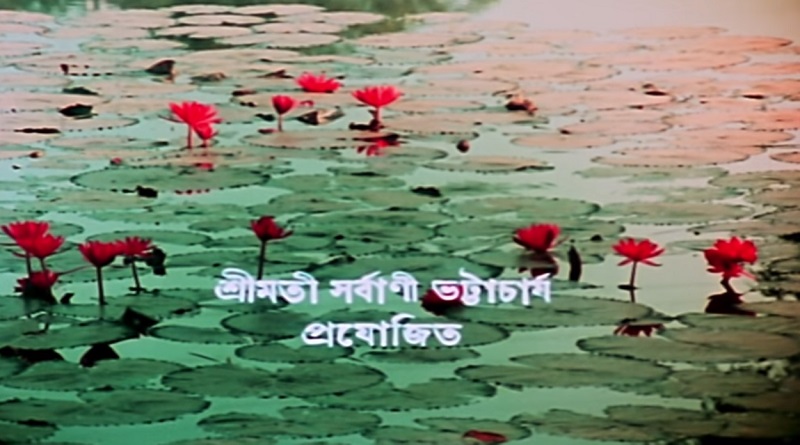











 Année :
Année : 





 Année :
Année : 




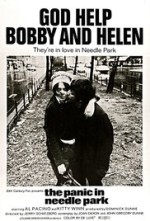 Année :
Année : 