La Belle fait partie de ces chefs-d’œuvre rares et méconnus qui convainquent à l’instant où on les voit, qui disent l’essentiel du cinéma, voire de la vie, tout de suite, avec la force des évidences. L’alchimie qui s’opère dans La Belle est parfaite : justesse du geste et des échelles de plan, beauté visuelle, délice sonore…, c’est une fable simple, son interprétation, quasi miraculeuse.
Dès le générique, on comprend à quoi on a affaire. Un poème, une ode à la liberté, à la beauté, à la simplicité, à la bienveillance et à l’espérance… Le film commence en contre-plongée vers le houppier scintillant des arbres : lumières d’été, silence apaisant, l’espoir peut-être déjà… Travelling arrière, et la caméra redescend vers la terre des hommes, qui sont en fait ici des enfants. Un petit groupe joue dans le lit d’une rivière asséchée à « La belle », un jeu qui consiste, on l’apprendra plus tard, à se réunir en cercle autour de notre personnage principal, Inga, au physique censé être disgracieux avec ses taches de rousseurs, ses grandes jambes nues, ses yeux ronds et rapprochés, ses grosses joues, et de lui dire combien elle est « belle », de vanter ses multiples qualités, alors qu’elle danse au milieu du cercle, gracieuse, lumineuse, telle une déesse se nourrissant avec bonheur des offrandes qu’on vient lui porter. L’image fait immédiatement penser à ces boîtes à musique souvent utilisées dans les films, censées raviver des souvenirs oubliés, et où parfois on actionne une petite manivelle pour y faire évoluer une danseuse mécanique.
À voir Inga dans cette première scène, difficile de concevoir aujourd’hui qu’un tel ange puisse représenter une image de la laideur, mais la réalisatrice lituanienne Alantė Kavaitė qui présentait le film confirmait toutefois que les taches de rousseurs par exemple n’étaient pas considérées comme des marques de beauté à cette époque dans son pays (et affirmait aussi que le scénario original dont elle avait pu se procurer un exemple ne souffrait à ce sujet d’aucune ambiguïté : Inga était laide).

Si tout est dit en une seconde, dès ce premier plan du générique, c’est qu’à ce moment, grâce au mouvement de caméra, à la situation (tirée d’une scène du film et qui pourrait tout aussi bien achever le film — ce qu’elle fait presque d’ailleurs), à la musique et à la grâce de la jeune actrice, souriante, élégante, malicieuse, eh bien tout est dit. Comme une ritournelle qui s’impose dès la première mesure, et qui revient sans cesse hanter nos oreilles : quelques plans de cette scène reviendront ponctuer le film mais tournés en divers endroits, car dans ce jeu étrange (qui ne peut être que celui des anges, a-t-on vu des enfants se comporter réellement ainsi ?) c’est tout à la fois qui se compose autour de la même harmonie : le dilemme et sa résolution. Du moins une résolution, car si ces anges semblent nous donner dès le générique une belle leçon de vie, le film ira plus loin encore. Alantė Kavaitė encore parlait d’un film impressionniste. Si dès le générique tout est dit, c’est que le film ne s’appliquera pas à suivre le cours d’un récit chronologique. Le film est trop court pour cela, et au mieux il prend la forme d’un conte. Ou pour rester dans le jeu d’enfants et de la ritournelle, la comptine. Différentes séquences serviront en fait à illustrer toujours la même idée, la même obstination : celle d’une beauté pas seulement intérieure, mais une beauté qui peut se révéler à notre regard quand ce qui est défini comme laid sourit à la vie et est embelli par la bienveillance de ceux qui la regardent.
Un seul élément nouveau dans ce que le film tient précisément de narratif viendra mettre à l’épreuve la logique bienveillante de ces elfes en culottes courtes : l’apparition d’un nouveau venu de leur âge questionnant pour la première fois la « beauté » de leur amie. Le perturbateur fera en réalité long feu. S’il remet en doute la beauté d’Inga, ce sera moins pour révéler sa naïveté que l’existence de beautés nouvelles, plus amères, ou moins immédiates.
Ce nouveau voisin, sorte de philosophe panthéiste perdu au milieu d’un manège de libellules, s’obstine à vouloir faire fleurir une demi-douzaine de branches que la joyeuse bande de lutins rieurs prend d’abord pour les rameaux d’un balai mais que lui laisse mijoter avec foi dans un vase de fortune. Ce qu’attend ici notre poète, c’est la liberté, l’espoir d’un temps meilleur… L’autre beauté, elle est là, celle de l’attente et de la foi. Autre préoccupation de sage pour cet étranger : nourrir les chiens délaissés par leurs propriétaires partis en vacances. L’occasion pour Inga (qui suit maintenant cet étrange bonhomme partout) de rencontrer un chien sur les bords du lac, indifférent à leurs caresses, attendant son maître noyé déjà depuis plusieurs semaines. Inga comprend que sa mère est comme ce chien, à attendre le retour improbable d’un mari invisible. Toujours la même attente. L’espoir doux amer, la résignation optimiste du sage convaincu en dépit des apparences que tout est possible… Même de voir des balais fleurir.

Voilà, peu de choses racontées ou montrées en à peine plus d’une heure : l’essentiel, une fulgurance cinématographique. La vie des anges n’aura été dérangée que quelques minutes : le soleil continue à briller, et on peut même inviter sa mère à jouer à « la belle », lui rappeler combien elle l’est, belle, et essentielle, si l’espoir lui venait à manquer. Dans ce conte philosophique, ce sont les enfants qui font la leçon aux parents. Et ils peuvent bien : une fois plus grands, leur balai ayant fini de fleurir, ils pourront les envoyer promener. Les vieux. Qui n’auront alors plus qu’à s’asseoir sur un banc et à contempler le désastre du temps passé. L’immuable marche du monde, comme pour dire à l’occupant et à la tyrannie : la liberté refleurira bientôt.
Inutile de dire que pour convaincre en jouant une telle partition, il faut une maîtrise formelle impeccable. Tout du long la réalisation de Arūnas Žebriūnas est élégante, préférant les mouvements de caméra aux images statiques (on dit souvent que pour filmer les enfants il faut savoir se mettre à leur hauteur, mais il faut aussi savoir les suivre : comme pour L’Histoire de Jiro, les travellings d’accompagnement sont magnifiques, tout comme les zooms, utiles pour éviter un montage heurté, ou les panoramiques en plans rapprochés), la musique prend souvent le pas sur les dialogues (l’atmosphère est volontiers contemplative), et surtout la petite Inga Mickytė est impressionnante de justesse, de poésie, de charme et d’intelligence. Autant de qualités déjà présentes dans Les Dimanches de Ville d’Avray tourné quelques années plus tôt (le film peut également faire penser pour cette scène de danse à Cria Cuervos).
(Le film semble être en voie d’être distribué en France. La copie était magnifiquement restaurée. Espérons que ça se fera un peu moins dans l’anonymat que ce coup-ci à la Cinémathèque. La salle était quasiment vide et le film projeté dans le cadre d’une séance « jeune public ».)













































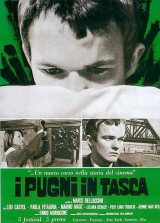 Année :
Année : 




 Année : 1967
Année : 1967











