Caresser le chien

Un homme presque parfait
Titre original : Nobody’s Fool
Année : 1994
Réalisation : Robert Benton
Avec : Paul Newman, Jessica Tandy, Bruce Willis, Melanie Griffith, Dylan Walsh, Philip Seymour Hoffman, Josef Sommer, Gene Saks
Coïncidence heureuse (ou forcée), je suis en plein dans la lecture de Faire un film, de Sidney Lumet, dans lequel le réalisateur explique que selon son scénariste deux types de scènes prédominent : celles où on caresse le chien et celles où on lui botte le cul. Or, selon Lumet, les studios cherchent toujours à imposer une seule vision : celle où on caresse le chien. Les stars ne font d’ailleurs pas autre chose pour préserver leur capital sympathie auprès du public. Elles peuvent ainsi faire retoucher des scénarios pour que leur personnage paraisse plus humain, positif, question « d’identification » (c’est en fait un principe hérité du théâtre qui est légèrement dévoyé à mon avis : je renvoie à mes cours dans lesquels mon prof insistait sur le fait d’« éclairer » les personnages antipathiques ; c’est loin de chercher à en gommer tous les aspects négatifs).
C’est ce qui a failli se passer avec son film, Le Verdict. Une star dont il ne révèle pas l’identité (IMDb évoque Robert Redford) a fait faire de multiples versions pour adoucir le personnage. David Mamet qui avait écrit la première version avait refusé de participer à ces réécritures qui coûtèrent un pognon de dingue. Finalement, le film s’est fait avec la condition que soit adaptée la première mouture et… avec Paul Newman qui n’avait pas fait autant de difficultés.
Avec Faye Dunaway, c’est le contraire qui s’est passé. Lumet raconte qu’elle avait la réputation d’être difficile, mais quand pour Network, il lui a demandé de ne pas insister pour rendre sympathique son personnage, tomber dans le sentimentalisme, expliquer les raisons de son comportement, elle a accepté sans difficulté et a eu le rôle.
Toute cette introduction pour en arriver à l’hypothèse que Paul Newman fait partie de ces acteurs qui n’imposent pas des changements drastiques dans un scénario pour les présenter sous leur meilleur jour. Il a en effet tourné Le Verdict. Seulement, si je peux me permettre, Sidney, Paul Newman n’a pas eu besoin de changer une ligne de dialogue parce qu’il appartient à cette autre trempe d’acteurs qui, contrairement à ce que l’on raconte au sujet de l’Actors Studio, compose peu ses rôles et offre toujours à ses personnages la même mine sympathique et… éclairée. Quoi qu’ils jouent, leur personnalité et le souvenir qu’ont les spectateurs des films précédents altèrent toujours la réalité du personnage et ses actions.
Comme point de comparaison, prenons par exemple Mikey and Nicky que je viens de voir. Peter Falk et John Cassavetes interprètent deux connards insupportables. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils n’y mettent pas beaucoup du leur pour « éclairer » leurs personnages. Ce sont des acteurs qui composent et n’hésitent pas à aller du côté obscur de la force. À leurs risques et périls. On sait que le personnage de Falk est une crapule, et ce n’est pas l’image qu’il nous reste de lui dans Columbo (au contraire, lui, toujours lumineux) qui influencera en bien notre perception du personnage qu’il interprète dans ce film.
Dans Le Verdict, vous ne verrez pas Paul Newman prendre ce genre de risques. Comme bien des stars avant lui, il ne compose pas : il se contente donc de réciter son texte avec talent en prenant soin de garder son air de bon gars à l’écran. Et ça marche. Dans Le Verdict comme ici dans Un homme presque parfait. Son personnage est un raté, il n’y a guère que sa logeuse qui « parie encore sur ce maudit cheval », mais au fond, ce que n’arrêtent pas de nous dire entre les lignes Robert Benton et Paul Newman, c’est : « ça reste un bon gars ; malgré son mauvais caractère, malgré son individualisme, ce raté est un bon gars ». Et il n’y a que de bons gars dans le film. Sérieusement, deux crétins n’arrêtent pas de se voler une déneigeuse, et ils continuent de jouer au poker ensemble comme si de rien n’était ? Ne nous y trompons pas : si rien ne porte à conséquence, c’est que le film est une comédie déguisée. Ce genre de situation ne peut pas exister dans la réalité. Derrière les allures un peu crasseuses du film, ses personnages ordinaires, c’est bien du pur Hollywood que l’on voit. Hollywood a parfaitement ingurgité les nouvelles avancées techniques et esthétiques de la nouvelle génération de cinéastes pour qu’à la fois les critiques du cinéma valident l’aspect pseudo-social du film et qu’en y insufflant un souffle positif, les spectateurs y adhèrent complètement. Résultat ? On caresse beaucoup, beaucoup le chien (on le bourre même de somnifères pour que l’on ait pas à lui botter les fesses).

Autre conséquence : le film devient un parfait véhicule pour la route aux Oscars. Sans la musique et sans certaines redondances dans les dénouements pour conclure des arcs narratifs gros comme des bâtisses en ruine, le film ne concourrait pas pour les Oscars, mais pour Sundance.
Dernier élément évoqué par Lumet que je me suis amusé à détecter pour voir s’il avait un fond de vrai pendant le film : le cinéaste parle à un moment de « canard en plastique ». Pour lui et son scénariste, il s’agissait d’un détail dans un scénario arrivant souvent aux deux tiers qui servait à expliquer les raisons du comportement (dégueulasse, presque toujours ; les bons gars n’ont pas besoin de se justifier dans les standards hollywoodiens). L’idée était à nouveau d’échapper au misérabilisme et aux personnages antipathiques en inventant une excuse psychologique en carton (ou en plastique) à ses erreurs et méfaits. Mais Lumet prétexte au contraire qu’un personnage ne doit pas justifier son comportement autrement qu’à travers ses actions. « Un jour, quelqu’un lui a volé un canard en plastique et c’est ce qui a fait de lui un tueur. »
Et vous savez quoi ? C’est exactement ce que l’on trouve ici. Enfin, pas tout à fait, puisque ce n’est pas aux deux tiers que l’explication traumatisante une fois révélée justifie le comportement du personnage principal, mais un peu avant la moitié du film. Le canard en plastique est ici la vieille maison où le personnage principal a vécu : son père alcoolique battait sa mère, et bien sûr, un jour, lui, le bon gars en devenir traumatisé, s’est interposé… Touchant n’est-ce pas ?
Certaines coïncidences peuvent être délicieuses. Mais les leçons de Sidney Lumet ont beau être parfaites, elles ne peuvent pas pour autant tout expliquer d’un film, qu’il soit réussi ou non.
Parce que malgré tous ces artifices, ces justifications pour forcer la sympathie, pour éclairer et « positiver », je dois être un bon spectateur (sans doute parce que je suis un « bon gars »). Non, ce n’est pas ça. Je suis une mouette.
Justifier psychologiquement les comportements négatifs ou jouer les bons gars quand vous avez manifestement raté la vie des autres en plus de la vôtre ; ajouter une grosse musique de mélo ; insister sur tous les effets en prenant bien son temps entre quatre yeux pour bien se faire comprendre qu’entre nous, en champ-contrechamp, on se comprend ; puis fermer, une à une, toutes les portes ouvertes par le récit après avoir bien pris soin d’en faire « une scène à faire »… ; non, ça ne me fait pas peur. Je ne boude pas mon plaisir. Bonne pomme, je ne saute pas pour autant au plafond. Moi aussi, je suis un romantique. Je garde un côté innocent et je crois toujours qu’à la fin les bons gars arriveront à prouver leur valeur.
Mon côté Jessica Tandy.
C’est un des plus grands mensonges du cinéma. Parfois, on a juste besoin d’y croire. C’est mal, ça nous abrutit. Et peut-être que c’est ça la foi au fond. La foi, non pas en une force surnaturelle, mais à la logique des hommes et de la civilisation qu’ils ont contribué à bâtir. Comment le monde pourrait-il être tel qu’il est (encore debout et pour combien de temps), si les hommes étaient foncièrement mauvais, intéressés et névrosés ? Tous, un peu comme dans Mikey and Nicky ?
Si vous n’y croyez, mettez peut-être la musique d’Howard Shore un peu plus fort. Et alors peut-être, tous les dobermans vous sembleront gris.
En attendant, je finis Faire un film, de Sidney Lumet. Il doit bien avoir quelque chose à dire sur la musique caressante et les dénouements multiples en forme de révélation altruiste sur la nature des hommes… La culture typique du happy end : ne retrouverait-on pas ça depuis A Christmas Carol ? Trouve-t-on de la même manière ce goût du dénouement en forme de rédemption (toute chrétienne) dans la culture narrative française ? C’est une autre histoire…
(Chapeau à la directrice de casting qui a su réunir toute une panoplie de seconds rôles au sommet de leur art : Bruce Willis, Melanie Griffith, Jessica Tandy, Philip Seymour Hoffman.)
Un homme presque parfait, Robert Benton (1994) Nobody’s Fool | Capella International, Cinehaus, Paramount Pictures
Si vous appréciez le contenu du site, pensez à me soutenir !
Réaliser un don ponctuel
Réaliser un don mensuel
Réaliser un don annuel
Choisir un montant
Ou saisissez un montant personnalisé :
Merci.
(Si vous préférez faire un don par carte/PayPal, le formulaire est sur la colonne de gauche.)
Votre contribution est appréciée.
Votre contribution est appréciée.
Faire un donFaire un don mensuelFaire un don annuel




























 Année : 1992
Année : 1992







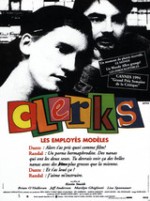 Année : 1994
Année : 1994



