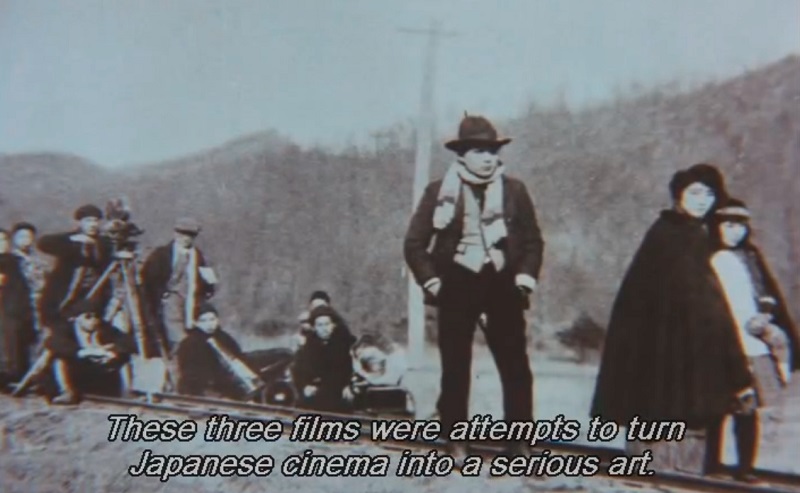Adapté d’un roman (ou d’un recueil de nouvelles) de Shôfû Muramatsu, ce film constitué de trois parties distinctes est un petit bijou. Chaque sketch tournant autour d’une idée commune (celle de femmes manipulatrices et vénales) possède son réalisateur attitré. En vogue dans les années 50 et 60, ce type de films a souvent peiné à trouver une unité. Pourtant, ici, un même souffle émane de cet ensemble : un style et un ton capable à la fois de se faire léger et mélodramatique. La musique joue sans doute un grand rôle dans cette unité. Elle est l’œuvre de Yasushi Akutagawa, habitué de deux des trois réalisateurs.
Masumura selon toute vraisemblance aurait réalisé le premier segment avec Ayako Wakao ; Ichikawa le second avec Eiji Funakoshi et Fujiko Yamamoto ; quant à Kôzaburô Yoshimura (Le Bal de la famille Anjo), il aurait réalisé le dernier segment avec Machiko Kyô.
La première histoire montre une hôtesse de bar dont la malice arrive à soutirer de l’argent à ses clients sans devoir en arriver à la chambre à coucher. Présentée comme une menteuse invétérée, à la fois insouciante, espiègle au travail (elle mord l’oreille de ces amants contrariés, signe de sa jouissance feinte et de la castration permanente qu’elle inflige à ses admirateurs), mais aussi consciente, en dehors, de la nécessité d’investir pour ses vieux jours. Sa seule faille (et on le retrouvera dans les deux autres personnages féminins du triptyque), c’est l’amour, réel cette fois, qu’elle porte pour un jeune homme de bonne famille. La tigresse finira par se faire avoir par son propre jeu, et ultime pirouette mélodramatique, refusera sans doute la seule chance de sa vie de trouver l’amour et le bonheur. Ces garces sont joueuses, et en tout cas pour celle-ci, quand elle baisse la garde et se révèle telle qu’elle est véritablement, elle ne tarde pas à replacer le masque pour ne pas s’avouer sa défaite, ou sa faiblesse. Avoir la plus belle femme du monde pour incarner cette tornade, ça aide. D’abord pour la crédibilité du personnage (tout le monde la désire, personne n’arrive à l’attirer au lit, mais personne ne lui en tient rigueur, on lui laisse tout passer grâce à sa beauté et son insouciance de façade), mais bien sûr, et surtout, parce que Ayako Wakao est une actrice formidable. Déjà trois ans qu’elle apparaît dans les films de Masumura (beaucoup sont encore difficiles, voire impossibles, à voir), et ici, en quelques minutes, le personnage lui permet d’exprimer une gamme impressionnante d’humeurs. La grande réussite de l’actrice et du réalisateur aura été d’arriver à ne pas faire de cette garce un personnage antipathique : elle ne prend rien au sérieux, et c’est à peine si elle se cache de mentir à ses prétendants. Un comble.
À noter également la performance impressionnante de Sachiko Hidari dans le rôle de la confidente. Future actrice de La Femme insecte ou de Sous les drapeaux l’enfer.

Testaments de femmes, Yasuzô Masumura, Kon Ichikawa et Kôzaburô Yoshimura 1960 Jokyo | Daiei Studios

La seconde histoire manie très bien également l’ironie, grâce au talent de son actrice, Fujiko Yamamoto. Ichikawa retrouve ici son acteur de Feux dans la plaine, Eiji Funakoshi.
Un écrivain porté disparu se réveille sur la plage. Image étrange qui ne réclame aucune explication, comme un rêve, comme une parodie des thrillers (en particulier des histoires de fantômes). Il rencontre une femme à l’air absent, lui révèle que son mari est mort et qu’elle vient brûler ses lettres parce qu’il aimait l’océan. À cet instant, son côté éthéré, on peut toujours y croire, mais le plaisir est là quand on doute de ce qu’on voit et qu’on n’ose pas encore rire. Fujiko Yamamoto joue la funambule entre le trop et le juste assez. La veuve et l’écrivain se quittent et se retrouvent par hasard le lendemain. Elle l’invite dans sa maison. Elle est froide et vide, inhabitée. Elle l’invite à prendre un bain. Et toujours cet air absent, cette voix haut perchée, traînante et naïve. Magnifique cut : gros plan sur l’écrivain, pas franchement rassuré dans son bain. Il a raison, elle vient lui tenir compagnie, nue. Fantasme, réalité ou… fantôme. On rit bien maintenant. Toutes les intonations de voix paraissent fausses. (Pour avoir un peu palpé l’art de la scène, je peux dire que c’est une des choses les plus dures à jouer : être crédible et drôle dans le surjeu parodique. S’il suffisait d’en faire trop et n’importe comment ce serait facile. Or, il faut être rigoureux et garder une humeur fixe, légèrement surjouée, sans perdre le fil. Un peu comme arriver à garder la même note pendant plusieurs minutes…)
Bref, on comprend vite grâce à l’intervention importune d’un autre personnage qu’il s’agit là, comme dans le premier segment, d’une manipulation. L’issue sera la même : la belle se fera prendre à son propre jeu. Les femmes jouent avec les hommes, mais ça leur arrive aussi de perdre. Le dénouement est à la fois amusant et magnifique : quand on ne sait au juste si la tension est celle d’un amour naissant ou celle de représailles qui s’annoncent. Comme deux taches d’encre sur la soie, ces tensions s’unissent, et c’est bien la composition de ces couleurs inédites qui provoque le plaisir du spectateur.
Le dernier segment est peut-être le plus conventionnel. Il permet à Machiko Kyô de montrer en détail tout son génie créatif.
Une “mama”, patronne de bar et responsable d’une maison de geishas après les nouvelles lois encadrant la prostitution, ayant donc bien réussi, refuse de cautionner le mariage de sa sœur. Celle-ci lui lance en retour que malgré sa réussite, elle a échoué à devenir heureuse. On la suit donc dans ses activités de parfaite gestionnaire, mais les reproches de sa sœur semblent encore résonner en elle. En quelques minutes, on en vient à mieux la connaître, à travers des références bien trouvées à son passé, à travers des détails révélant une nature tournée exclusivement vers son désir de réussir. À son autorité naturelle qu’elle montre face aux clients ou ses employées, s’oppose la faille ouverte par sa sœur qui ne va cesser de s’agrandir. C’est ce parcours et cette prise de conscience tardive qui permet de la rendre sympathique aux yeux du spectateur, placé comme en face d’une rédemption silencieuse. On n’attend alors plus que le moment où le basculement va pouvoir s’opérer. Deux fronts : un lentement préparé, qui est l’utilisation très vite dans le récit d’un événement perturbateur. Une classe est venue assister à une représentation de geishas et un des élèves est tombé subitement malade. Au lieu de l’envoyer à l’hôpital, l’enfant est gardé sur place. La “mama” ne s’intéresse d’abord pas à lui ; la maîtresse s’occupe de tout. Le deuxième front qui va permettre ce basculement, c’est l’arrivée imprévue dans la vie de cette femme au monde bien réglé de son premier amour. C’est en quelque sorte le coup de grâce qui lui fait comprendre qu’elle s’est trompée. On met de côté la crédibilité et la cohérence d’une situation un peu forcée, et on plonge dans le pathos (contrairement aux deux autres segments, ici, pas d’ironie). La police vient arrêter cet homme qui venait demandait l’aide, humblement, à cette fiancée qui autrefois l’avait quitté sans prévenir et qui avait été la source de toutes ses misères. Et le basculement est donc là : 1/ elle avoue aimer, aimer un homme hors la loi sans doute, mais elle aime, c’est le début peut-être du bonheur ; 2/ elle fait don de son sang au garçon malade ; 3/ sa sœur vient se présenter à nouveau à elle, cette fois avec son amoureux, et un peu à son étonnement, elle n’aura pas à attendre longtemps avant que sa sœur décide finalement de l’aider.
C’est du classique, un peu grossier (un mélo quoi) mais c’est bien amené. Mais il faut donc faire avant tout honneur ici à Machiko Kyô. Malgré un physique pas forcément avantageux, elle arrive à tenir l’attention grâce à son autorité, sa justesse et sa précision. Elle est capable de se fixer un objectif pour chaque scène, de jouer ainsi en priorité la situation. Et alors chaque réplique devient une évidence : délivrée simplement comme une certitude toute faite, elle envoie tout ça avec le plus grand naturel. C’est trop précis pour être de l’improvisation. De temps en temps, elle ponctue son jeu, en réaction à ce qu’elle entend, apprend, à ce qu’on lui dit. Le langage du corps apporte quelque chose de plus essentiel qui n’apparaît pas dans les dialogues. Ce sont comme des apartés que nous sommes bien sûrs seuls à voir. Ce n’est souvent qu’un geste, un regard perdu. Quand on place les acteurs dans un tel environnement fait d’objets du quotidien, là où on devrait au contraire les retrouver dans un certain confort, il n’est pas aisé d’arriver à jouer sur tous ces tableaux : la force à travers l’autorité, la faiblesse à travers les doutes et des informations sur le passé auxquelles elle semble ne pas réagir, mais qui, à force de la suivre, finissent par ne laisser aucun doute sur la manière dont elle les reçoit. Calvaire pour les acteurs médiocres, ce contexte peut révéler le génie créatif des grands acteurs. Et il n’y a pas de doute, ce que propose Machiko Kyô ici, c’est du grand art.
Voilà, il est dommage que les films à sketchs soient passés de mode. C’était un format assez similaire au recueil de nouvelles qui permettait d’aller droit à l’essentiel. Dans ce type de films, la question de la mise en scène est accessoire : elle doit se mettre au service d’une histoire, et les prétentions esthétiques d’un cinéaste doivent passer au second plan. L’efficacité avant tout. L’académisme aussi. Le film à sketchs permet, en outre, de s’attarder sur trois personnages principaux, et bien sûr, profiter du talent d’actrices exceptionnelles. Nul doute que beaucoup de ces films aient un peu trop souffert d’un manque d’unité, mais on pourrait imaginer plusieurs histoires réalisées par un seul cinéaste. Et puis, on aurait pu également insister sur un genre, qui en littérature ne s’est finalement pas si essoufflé que ça. Quoi qu’il en soit, celui-ci est parfaitement réussi. L’unité est là, elle s’articule autour de femmes manipulatrices, ambitieuses, qui vont être confrontées à des situations remettant en cause leur parcours et leurs choix peu recommandables. Le regard posé sur elles est toujours bienveillant, comme pour souligner encore le rôle de l’art, des histoires que l’on se raconte : la vie est constituée de malentendus, de fautes, de choix lourds de conséquences, d’incompréhension, d’errance ou de chance, mais chacun avance comme il peut ; et si certains, dans ce petit jeu subtil des apparences, parviennent à nous faire croire qu’ils ne sont pas affectés autant que nous par ces désagréments de la vie, c’est que malgré cette adversité, ils avancent droit, avec dignité et confiance. Les histoires, même les plus petites, sont là pour nous rappeler, que si ces héros du quotidien sont capables, même dans leurs travers, de rester fidèles à cette conduite, chacun peut le faire.
Et si on en est incapables, reste toujours le pouvoir d’en rêver. De moins en moins, malgré nos libertés, nous faisons. Ces personnages osent et se veulent maîtres de leur destin, même si — surtout — la vie leur joue des tours, ou qu’ils choisissent une voie moralement discutable. Si le film est si léger, c’est qu’il est rempli d’optimisme. Rien n’est jamais grave. La vie continue. Alors cessons de subir.
(Autre très bon film à sketchs japonais : Destins de femmes, de Tadashi Imai.)