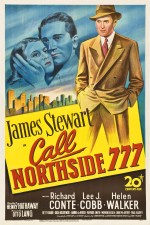You shout a film but in space no one can bear your screen, Ridley.

Prometheus

Année : 2012
Réalisation : Ridley Scott
Avec : Noomi Rapace, Logan Marshall-Green, Michael Fassbender, Charlize Theron, Idris Elba
Donc depuis la fin des années 80, Ridley Scott est perdu dans l’espace, c’est bien ça ?…
Je résume. Qu’est-ce qui faisait le génie d’Alien et de Blade Runner ? Le rythme lent, l’atmosphère oppressante, le design soigné, réaliste… Tout ça s’est perdu dans l’oubli comme des larmes dans la pluie. Alors soit, il tente de renouer le contact avec ses succès passés, mais l’intention, louable au départ (oui je rêvais de le voir renouer avec le genre SF…) se révèle être un massacre, un peu comme si Ulysse de retour à Ithaque trouvait Pénélope dans les “bras” d’Argos.
C’est bien un monstre que nous a pondu Ridley. Un film plein de références à la franchise, croyant sans doute faire plaisir aux fans, mais justement, chaque film doit être capable d’exister par lui seul. Le journal de bord de Shaw ? Une référence trop évidente au troisième volet. Le type infecté lors de sa sortie et le capitaine refusant de le laisser entrer dans le vaisseau ? On l’a déjà vu dans le premier. Le réveil ? Déjà fait. Les robots et leur infaillible soumission à la compagnie ? Idem. Une équipe constituée ne sachant pas ce qu’ils viennent foutre dans cette galère ? Pareil. Le gentil navigateur noir qui va bravement mourir n’hésitant pas à se sacrifier pour son maître, ou sa maîtresse ? (Assez douteux et) déjà fait. L’atterrissage sur une planète inconnue et l’exploration d’une cabane abandonnée qui fait bien flipper Rapace ? Déjà fait. (On perd « sa race » au profit de « rapace », il faut mettre ça au crédit de l’évolution des espèces.) La trace gluante sur un mur que même les scénaristes de Scoubidou n’oseraient plus utiliser ? Déjà vu. Un héros féminin pour jouer sur l’effet de surprise, le contraste, le sex-appeal ? Là encore, référence trop évidente, trop usée, trop lourde, trop facile…
Le problème n’est pas que tout ça ait déjà été abordé dans la franchise, c’est surtout que ça l’a été, toujours, de manière plus convaincante. Il faudrait être sacrément bien luné pour voir une cohérence dans cette soupe de grumeaux. Le problème n’est pas non plus de se répéter, si c’est bien fait. Or, ça ne l’est pas. Et Scott n’arrive même pas à s’imiter lui-même.

Une seule scène sauve le film, mais c’est probablement involontaire : celle de l’opération chirurgicale. L’exécution pour le coup, avec son côté parodique, est bien menée. On voit la même séquence dans Alien3, c’est donc encore du recyclage, mais ça va beaucoup plus loin… dans le ridicule. On ne voit pas du tout venir la manœuvre. « Tiens, une machine pour opérer les gonzesses… » Nous : « Ah, qu’est-ce que ça vient foutre là ? Hum, je vois la suite… » La suite : « Ouille, j’ai un truc qui pique dans le derche, il faudrait que je me le fasse enlever ! Youpi, il y a le machin truc pour m’opérer ? » Tout à coup on était plongés dans Starship Troopers. Je n’ai aucun doute que Scott ait mis tout son sérieux dans cette séquence, mais c’est justement ce qui est drôle. Et même sans ça, cette séquence, c’est l’aboutissement de tout un mythe à travers un simple pied de nez. « Depuis tout ce temps où on vous a fait suer avec cette créature, on avait la solution !!! » Voir la Rapace dans cette séquence a quelque chose d’étrange. Je parlais de sex-appeal plus haut, or sa capacité à exciter un homme est proche de zéro. Ce n’est pas une femme, c’est un hobbit. Là encore, on suit l’air du temps, et j’imagine bien dans la suite du préquel la voir se faire poser par la même machine un anneau gastrique (et quoi de mieux pour un préquel qu’un « You will not past » comme slogan). Sigourney Weaver était déjà curieusement charpentée, mais ça collait à son rôle de lieutenante burnée. Là, la logique, ou le fantasme de la voir à poil, ruisselante de sueur, s’agitant frénétiquement, c’est quoi ? Mystère, c’est du grand n’importe quoi, et c’est pour ça que c’est drôle. Une idée, en général, elle doit s’intriquer (j’ai dit trique ?) dans un ensemble. Seulement ici, la cohérence de l’histoire est suspecte. Toute idée est donc bonne à saisir et on brode dessus. Sorte de patchwork d’idées forcément informe et ridicule. La machine opère même au scénario. Et quand ça ne veut pas accoucher d’une histoire cohérente, pas grave, elle a les moyens de forcer la porte. Prométhée la Lune, je vous donnerais les étoiles…
Parce qu’il est bien là le problème de Prometheus. L’absence d’un scénario qui tienne la route. Manque criant d’unité et de cohérence, de rythme, de tension. Et feu Ridley Scott à ne savoir sur quel pied danser : est-ce un thriller, un film d’action ? Est-ce Le Huitième Passager ? Aliens ? Il faut choisir. Parce qu’en l’état, c’est une Histoire Génétiquement Modifiée.

Je n’ai rien contre le principe du préquel. Mais on doit en dire juste assez pour captiver l’attention du spectateur, jouer avec ce qu’il connaît déjà, sur les origines, et ensuite faire un tout autre film qui se suffise à lui-même. Évidemment, Scott tombe dans le piège et préfère proposer un film hommage, ou un film explicatif. Dans « origines », c’est vrai, on peut comprendre « explications ». Mais pour les explications, on a les commentaires sur les DVD, les bonus. On ne pond pas tout un film pour expliquer un mythe. Surtout pas quand on est justement incapable de l’expliquer clairement. L’art de raconteur d’histoire, c’est avant tout l’art de rendre les choses simples… On passe d’un mythe qui était autrefois sujet à toutes les interprétations, à toutes les fantaisies, la nôtre, à cette chose indigeste. Le film en dit trop ou pas assez. Limiter les révélations, les idées, et les dévoiler clairement à l’esprit du spectateur : « Luke, je suis ton père ! » Simple, efficace. Ici : « oui, bon, alors…, je ne suis pas sûr, mais il se pourrait, je dis bien il se pourrait, qu’il y ait eu une espèce humaine, ou humanoïde, enfin extraterrestre, tu me suis ? qui serait à l’origine de l’humanité… » Heu, mais ça n’a rien à voir avec le mythe Alien, quel rapport ? Et ce n’est pas un peu du créationnisme cette histoire ? La théorie de l’évolution tu en fais quoi ?
Et sérieusement, c’est quoi le rapport entre cette huile noire dégoulinant du studio de X-Files avec cette espèce de zigouigoui sorti de Star Wars ?…
Je m’arrête deux secondes sur le design parce qu’il m’a donné mal aux yeux. Trop de couleurs, trop d’hologrammes m’as-tu-vu… « Regardez comme c’est beau et comme ça brille !… » Heu, mais on est où là ? Où est le style organico-gothique de Giger qui convenait si bien à un film d’horreur ? Certes il était intéressant de créer un contraste entre un vaisseau high-tech et la rudesse de la caverne (ou la cabine au fond des bois), mais on prend le risque encore une fois du manque d’unité. Si on fait de ce vaisseau une invention humanoïde, une espèce avancée, ça n’a plus aucun sens de jouer sur l’organico-gothique des origines. Il n’y a plus vraiment de contraste entre le monde connu, rassurant, propre et lisse, et le monde inconnu, visqueux, inquiétant, puisque le vaisseau selon toute logique doit lui aussi présenter un aspect suggérant l’avancée de cette espèce (même si c’est contraire au mythe initial). L’unité était parfaitement rendue dans les trois premiers volets, parce que les vaisseaux humains présentaient déjà un aspect métallique assez peu rassurant. Peu de contraste. Et il suffisait qu’à éteindre la lumière, instaurer la peur, un fond sonore, pour en faire l’antre de la bête. Dans le Huitième passager, l’utilisation des néons blancs avait déjà un côté organique, inquiétant, comme une lumière tamisée traversant la chair. C’était froid comme la lumière chez le dentiste avant qu’il vous charcute les gencives, c’était flou, et le tout offrait une atmosphère mystérieuse comme un brouillard, qui ne présageait rien de bon. Moins on voit, plus on devine, mieux le spectateur se porte. Les lumières rouges orangées de la salle « Maman » étaient dans le même ton : si ça clignote, c’est que tu es encore en vie, mais pour combien de temps ? Dans Alien 3, la prison était déjà humide, froide (et chaude à la fois), métallique, exactement comme la créature de Giger. Où ici trouve-t-on une unité ? Ça part dans tous les sens.

Donc oui, ce film n’avait rien de nécessaire. Expliquer un mythe, c’est tuer le mythe. Et on peut bien laisser Ridley Scott crier, ça vaut bien le Perdu dans l’espace avec Matt Leblanc…
Prométhée fait long feu. Le scénario n’est que poussière. Repose en paix, (feu) Ridley Scott.
(Note 2016 : Après Alien, Scott s’apprête à violer Blade Runner : Non, non, non !)

Prometheus, Ridley Scott 2012 | Twentieth Century Fox, Dune Entertainment, Scott Free Productions
À lire sur La Saveur des goûts amers :





















 Année : 1955
Année : 1955