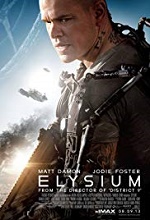Un petit (mais long) commentaire vite fait pour garder en mémoire les quelques impressions laissées par le film.
La futilité des personnages principaux dans un univers où tout dépend d’eux.
Comment croire que le sort de la galaxie dépende essentiellement de deux jeunes freluquets aux talents hors du commun amenés tour à tour, et aux détours des caprices de leur âge, à chercher à s’unir, se convertir ou s’opposer ? Si cette dualité est forcément reprise pour partie des thèmes de la trilogie originale (puisqu’on l’a assez dit, celle-ci n’en est une resucée assumée), avec la fratrie Leïa-Luke, il me semble qu’elle procédait alors bien plus à une logique de mythe.
George Lucas s’en sortait très bien, sur trois épisodes, à faire avancer cette thématique familiale, en distillant juste assez à chaque séquence ou épisode pour faire avancer la situation et l’intégrer harmonieusement avec les autres thèmes centraux de la trilogie (et cela non sans perturbation dans la force, pardon, dans la cohérence de la trilogie : par exemple, on ne voit jamais Leïa prendre conscience dans le dernier épisode que si elle est la sœur de Luke, elle est la fille de Vador…). Une grande différence avec ce qu’on nous propose ici, où on ne voit jamais la fin des vrais-faux revirements, des possibles avancées qui nous échappent parce que perdues au milieu de mille autres informations, des séquences de blabla pour convaincre l’autre de se lier à lui ou des scènes de duel sans fin (dans une logique très « on va voir qui a la plus grosse, mais à la fin, on dit pouce). À force de retrouvailles, d’appels en SMS télépathiques surtaxés, de répétitions presque comiques, ces rencontres ne riment plus à rien, et on finit vite pour ne plus en attendre d’avancées notables (syndrome de Pierre et le Loup) : au lieu d’avoir des avancées dramatiques, de vraies décisions prises par l’un ou l’autre qui impliqueraient de lourdes conséquences, ici rien n’est jamais grave ou à prendre au sérieux. Un peu comme se retrouvait autour d’un café pour taper la discute en même temps que quelques sbires de l’empire ou des pions interchangeables des rebelles. La futilité de la jeunesse en l’absence de contrepoint d’un maître, d’un père, d’un professeur, d’un gourou. Pardon, mais quand Luke rencontre Vador pour la première fois, il y laisse une main ; quand il le retrouve, c’est avec Palpatine, et rencontrer l’empereur, on sent que c’est un événement pas donné à tout le monde : Luke s’y est préparé (on en parle depuis un moment), et c’est pour en finir avec lui (enfin, croyait-on, parce que c’était sans faire avec les talents de profanateur de cadavres de Abrams), pas pour jouer à qui à la plus grosse, faire semblant à un dénouement, se dire salut et se promettre de se retrouver à la microscène 342.
Alors voilà, une fois que toutes les vieilles reliques sorties du placard ont fini de jouer les fantômes, on ressort de son puits Palpatine, on nous explique qu’il est derrière Rey depuis le début, qu’il a tout prévu jusqu’aux méchants précédents, et se place ainsi comme le grand manitou des… trois trilogies. Eh, oui, réveiller les morts, ç’a des conséquences : mis à part les deux droïdes qui sont en effet de toutes les fêtes (on respecte l’angle de La Forteresse cachée), on pensait à la première trilogie que Luke était le héros, puis c’est son père qui en devient le personnage principal avec la prélogie, et enfin ici, tout compte fait, on nous dit que ça pourrait tout aussi bien être Palpatine. Eh ben, je crois que Abrams se fout un peu de notre gueule, parce que Palpatine était très bien à sa place, celle de l’opposant idéal qu’à la fois le fils et le père Skywalker avaient réussi à remettre à leur place. Voir sa fille (oui, je divulgâche, maintenant tu es prévenu) prendre le relais et le voir, lui, un type si peu sympathique (on ne nous a pas vendu son enfance malheureuse, on a le droit de le détester) devenir le centre de trois trilogies, ça ne m’enthousiasme pas des masses. Sans compter qu’il y a un truc qui me chiffonne dans cette histoire : le papy, il est fort comme Voldemort et le diable réuni, avec une puissance ahurissante, et au lieu de s’en servir pour un détartrage, pour guérir ses guibolles manifestement en carton ou tout simplement pour se déclarer maître du monde en menaçant qui veut l’en empêcher de lui tordre le cou (on rappelle qu’on est censé être dans un monde sans jedi), non, le papy préfère œuvrer dans l’ombre, jusqu’à laisser des monstres prendre le risque de devenir plus puissants que lui, ou imagine encore tout un stratagème alambiqué pour que sa petite-fille la rejoigne du côté obscur ? Si le type est immortel à ce point, en quoi laisser ses pouvoirs à sa petite-fille, a-t-il une importance ? Et pis, si ce n’est qu’une question de descendance (il tient ça de qui d’ailleurs ? de son élève Dark Vador ?). Il est impuissant le papy ? Il ne peut pas remettre ça et s’assurer que cette fois, il gère ce projet comme tout bon papa poule ? Je n’ai pas de mots pour dire à quel point cette idée (le centre de notre trilogie donc, puisque c’est la grande révélation attendue) sent mauvais.
Et j’en reviens à la futilité des personnages principaux. Cette absence du père, ou du grand-père, à force pour beaucoup de les zigouiller en cours de route ou de les cacher dans l’ombre pour le seul goût du secret, revient à laisser des gosses gérer seuls le sort de la galaxie. Ce qui fait de cette trilogie une sorte de Seigneur des mouches à l’échelle galactique (Abrams l’avait déjà expérimenté dans une série à l’échelle d’une île si je me rappelle bien), ou une version du Collège fou fou fou intergalactique. Dans cette histoire, les adultes n’ont plus qu’un rôle anecdotique et regardent impuissants deux lycéens en colère se chamailler sans plus aucun arbitre.
Si le fort de Lucas, c’était de réveiller des mythes, les adapter, cette nouvelle trilogie se plante royalement à ce niveau. L’un des points faibles de Luke, c’était sa futilité, mais elle était contrebalancée par les autres personnages, avec lesquels finalement ils formaient un groupe harmonieux (un groupe qui n’allait pourtant pas de soi au début et dans lequel tous se tiennent : on enlève un et ça devient dramatique). Ici, c’est comme si la futilité était partagée par tous les personnages, même les adultes ne semblent pas prendre la lutte contre les Sith, ou l’Ordre machin, au sérieux (Luke avait beau était puéril, il était attaché à suivre les conseils de son maître). C’est toute la gravité de l’ancienne trilogie pourtant adulée ici qui disparaît : les humeurs des personnages changent en fonction des revirements de situation, et comme ils sont nombreux, on passe des rires aux pleurs assez rapidement sans quand jamais la séquence précédente ne semble avoir de poids émotionnel sur la suivante. De la même manière que leur groupe semble formé artificiellement pour « faire groupe », toutes leurs émotions et leurs aventures ne semblent prendre corps que pour le plaisir de l’aventure (la futilité, toujours).

Le symbole d’ailleurs de ce manque flagrant de cohérence psychologique, ce sont les séquences fabriquées avec Carrie Fisher, dont le décès prématuré est parvenu avant ou pendant la production du film et qui impose une utilisation plus que baroque des rushes disponibles. L’impression du charcutage est immense : si un dialogue se met en place, le plus souvent avec Rey, on ne va jamais plus loin qu’une réplique, et on change de sujet. Même les plans de coupe ne semblent pas appropriés pour la situation… Et donc tout le film laisse cette étrange impression que tout est monté à l’arrache, grossièrement, en rapiéçant de vieilles pièces d’étoffes appartenant à la première trilogie pour en faire un manteau d’Arlequin, forcément des plus baroques, et avec aucune consistance ni psychologique ni dramatique.
Revirements boiteux
Les revirements idiots sont nombreux : le général sorti de Poudlard (promotion Serpentard) se rebiffe au bon moment et annonce (hilarité dans la salle) qu’il est l’espion tant recherché (ce qui fout en l’air toute une quête qui prenant forme, mais puisqu’on a cinquante quêtes en même temps, en bousiller une aussi facilement au passage, ça nous arrange bien), qui demande comme dans un western parodique qu’on le blesse pour que ça passe auprès de son supérieur (on rappelle, juste comme ça, que le bonhomme est donc censé être le numéro 3 au rang des chefs méchants, et que pendant qu’il accompagne ses nouveaux potes à leur vaisseau, personne sous ses ordres ne vient à ses nouvelles : de quoi le faire un peu plus passer pour un moins que rien, ce qui n’est pas beaucoup mieux que son chef suprême qui sort tout juste de l’adolescence). Bien sûr, cet officier futé comme deux sergents Garcia, se fait dégommer dès que son pote a compris son petit jeu (ce ne serait pas expédié aussi hâtivement et avec autant de désinvolture, à la façon d’une série, sans se soucier d’y créer une réelle confrontation, un doute, source de tension, au moins pour créer un semblant de cohérence psychologique et d’intérêt dramatique : si tous les personnages se font zigouiller, même les méchants, et que ça n’a provoqué aucune mise à distance — pour mieux s’en émouvoir —, jamais rien ne peut alors devenir dramatique, sinon à forcer le trait en y développant des cris ou des larmes — ce que les deux personnages principaux et opposés ne manquent pas de faire).
« Et au fait, pourquoi tu nous aides ? — Je n’aime pas mon boss, il a été méchant avec moi. » Et l’autre : « OK, salut. »
Si c’est pour bâcler autant les situations et les dialogues, tu peux en faire une série de plusieurs heures, ce sera toujours aussi émotionnellement et psychologiquement inconsistant.
Autre revirement vite expédié et ridicule : l’explication que donne Luke sur ses ratés, ses propres revirements à la limite de la cohérence psychologique. « Yoda vient de me dire que l’échec était le principal moteur pour avancer dans la vie : je me suis planté avec Rey, ben… Cool ! Ce n’est pas si tragique ! Alors du coup, j’ai changé d’avis : j’ai eu tort de me retirer sur cette île… » Purée, mais des personnages qui sont si malléables, si inconsistants, qui n’ont aucune droiture dans ce qu’ils pensent, pour qui tout est futile ou aléatoire, ben perso je n’ai pas envie ni de les suivre, ni de leur faire confiance, ni de les aimer. Un jour ils disent blanc un autre noir, et ça change toujours en fonction des humeurs ou parce que ça fait avancer artificiellement la situation… Ce n’est même plus de la puérilité, c’est de la bêtise. Il faut de la constance chez les personnages pour les suivre.
Dénouement(s)
Quand tout une intrigue est basée sur des révélations et des dénouements successifs, difficile de repérer ce qui est important ou pas, difficile de sentir la structure même du récit. Pourtant, Abrams, puisqu’il colle à la structure de la première trilogie, a bien l’intention de refaire à sa sauce le type de dénouement positif qui a tant valu de succès à l’épisode IV (remise de médailles) et à l’épisode VI (la ewoks party). Ce qui est drôle pourtant, ou navrant, c’est que si le film multiplie les séquences de révélations, de retournements, de confrontation et de dénouement, en les charcutant à un point qu’elles font rarement plus d’une minute, celle qui prend comme modèle celle de l’épisode VI est interminable.
Le montage final de Richard Marquant était à l’image de son film : assez simple. L’idée était de clore la trilogie initiale, c’était la fête, et à raison : la séquence finale du film, dans laquelle on s’applique à bien refermer toutes les portes des couloirs narratifs, et à dire au revoir à nos personnages chéris, restera plus de quinze ans au moins le dernier acte de la saga Star Wars. Combien de temps durait-elle ? Une minute ou deux tout au plus. Ici, avec l’inflation des quêtes et des personnages à suivre, on en a bien pour dix minutes. Avec en sus une réparation stupide « fête » au wookiee qui n’avait pas été honoré lors de la remise des médailles de l’épisode IV (ce qui avait valu les sympathiques sarcasmes de Carl Sagan), et à qui on remet ici, on ne sait pas bien pourquoi, une médaille en chocolat. Ce n’est pas le tout d’honorer les anciens en zigouillant leur travail ou en les faisant mourir à l’écran, il faut encore leur faire la leçon pour leur expliquer que « quand même, c’était un peu raciste de pas filer une breloque à une carpette ambulante… » Chewbacca n’avait peut-être pas de médaille, mais peut-être bien parce qu’il est plus intelligent que les autres, et se fout de ces premiers prix de conduite. À son âge, sérieux…, il en est encore à espérer des médailles ? Non, Chewie, c’est le Yoda de l’ombre : la sagesse même. Jamais un mot plus haut que l’autre. Le véritable maître et père de toutes les trilogies. Lui filer une (futile) médaille, c’est le rabaisser à un enfant qui a été sage pour Noël.
Filiation ratée
C’est dommage, j’aurais facilement pu être convaincu par le fil conducteur, la « grande » révélation de la trilogie. Comme avec les deux autres trilogies, on y trouve ici une quête d’identité, liée à celle des parents (enjeu qui est lui, bien mythologique, contrairement à beaucoup d’autres aspects du film), et c’était une idée qui aurait pu me séduire si le reste n’était pas aussi bâclé. Après avoir imaginé après le premier volet (comme en atteste cette critique) que Rey avait de bonnes chances d’être la fille de Luke, après avoir espéré qu’elle soit la fille de personne afin de donner à cette trilogie un réel sens démocratique et sortir pour de bon des filiations, j’aurais pu me laisser séduire par un lien avec Palpatine. Reste que même à ce niveau, Abrams réussit à tout gâcher avec une énième séquence « du héros gentil se présentant face au méchant sur son trône ». Que Rey soit la petite-fille de Palpatine, d’accord, mais que Palpatine joue les momies ou les Voldemort pour l’occasion, qu’on le retrouve après la révélation ici pour une ou deux séquences de confrontation, ben, c’est assez décevant parce qu’on a l’impression que ça vient de nulle part. Et au final, sa fonction est presque illustrée par la manière physique dont il est montré dans cette scène, à savoir, porté par je ne sais quel treuil invisible : Palpatine a beau être le méchant le plus puissant des trois trilogies, il n’est ici qu’une marionnette qui va permettre au récit de s’offrir une petite séquence de confrontation finale (avant d’en avoir une autre puis une autre et encore une autre) et qu’on aura vite oubliée une fois finie parce qu’on sera passés à autre chose (c’est le problème quand on court mille lièvres dramatiques à la fois : il faut tous les suivre, et une fois qu’on en attrape un, pas le temps de savourer et de goûter la bête pour servir le dénouement et un dessert si tout le monde a été sage, non, il faut repartir à la chasse).

Si dans le premier, l’idée qu’on assiste à nouveau à la thématique de la fratrie, mais cette fois sur la variation du duel fratricide, me séduisait plutôt, on a vite basculé (déjà dans le précédent avec des blagues potaches entre les deux djeunes super-héros) vers un conflit d’ados perturbés par leurs hormones, laissés seuls dans une chambre à se chamailler quand les parents sont de sortie, ou à faire autre chose en oubliant qu’on en aime un autre… Pardon, mais c’est déjà moins une problématique mythologique. Là, tout ce qu’on entend en sous-titre de ces relations, c’est : « Tu veux pas sortir avec moi ? S’il te plaît !… Tu te rends compte que tu sors avec un vulgaire stormtrooper ?! Tu es rien, je suis un fils de bonne famille, je pourrais tout te donner si tu acceptais qu’on sorte ensemble ! Allez quoi, un bisou ! Viens, on va refaire (littéralement) le monde ensemble ! » Désolé, ça me parle moins que « Fils, rejoins-moi, nous régnerons tous les deux sur la galaxie, l’empereur l’a prévu. Tope là ! Non, l’autre main… Pas… Mais il est con, il est tombé ! ». D’un côté un père qui tranche la main de son fils (il y a du symbole) ; de l’autre, deux lycéens qui se chamaillent parce que l’un ne veut pas partager son goûter avec l’autre.
À noter d’ailleurs, douce ironie, ou belle revanche, que si dans la première trilogie (et même si c’était son emploi, et un emploi qui cadrait parfaitement avec l’ambition mythologique de Lucas) Mark Hammill était parfois agaçant, c’était la bonne surprise de l’épisode précédent, Les Derniers Jedi (bien supérieur me concernant que celui-ci). Plus que Harrison Ford dans Le Réveil de la force, son personnage avait une réelle consistance, un vrai poids sur les événements. Ici, qu’a-t-on pour jouer en face de ces jeunes bahuzards ? Des fantômes (des morts, parfois, littéralement).
Rythme
Un problème assez récurrent dans les films d’Abrams. Qu’est-ce qui l’oblige à se passer ainsi systématiquement dans une séquence qui en a besoin de quelques secondes de respirations, que ce soit pour apprécier dans sa longueur la réaction d’un personnage (afin d’essayer de percer ses pensées), pour instaurer une ambiance, un mystère, ou simplement pour offrir au récit et au spectateur, qui en a besoin pour digérer les informations qu’on vient de lui donner, un peu de respiration avant que ça reparte sur les chapeaux de roues. On n’en est plus à deux ou trois minutes près.
Cela démontre assez bien à mes yeux en quoi ce réalisateur manque quasiment presque à chacun de ses films de sens de l’à-propos : quand une séquence ne marche pas parce que trop rapide ou parce que mal mis en scène, avec une interaction entre les acteurs qui ne marche pas ou avec des enjeux et des situations flous mal exposés, eh bien, soit on repense sa séquence, on la réécrit, la retourne, ou tout bonnement on la coupe. Or, il y a un nombre incalculable de séquences, de situations, ou de propositions de jeu qui tombent à l’eau parce que trop vite ou mal expédiées.
Par exemple, en quittant je ne sais quelle planète, Chewbacca beugle et Rey le regarde en disant juste « oui ». Oui, quoi ? Ces quatre ou cinq secondes sont censées nous dire quoi ? Comme d’habitude, jusqu’au moindre détail, Abrams rapièce sa toile avec des morceaux piochés dans ses souvenirs de la trilogie originale : ce qui pouvait n’être qu’un geste, qu’une attitude, il se l’approprie et tient en dépit de toute cohérence narrative ou de mise en scène à l’intégrer dans son film. C’est pourtant un défaut assez fréquent chez les jeunes scénaristes ou metteur en scène : penser, même inconsciemment, que reproduire un effet, une image, une posture dans un film qu’on a vu, va par enchantement produire sur les spectateurs dans un nouveau film une réaction identique. Sans se demander pourquoi dans le film original cet effet avait une telle efficacité sur le public (le plus souvent parce qu’il s’intègre à une cohérence narrative bien plus large). On se doute donc bien qu’à cet instant, quand il fait dire à Rey « Oui » qu’il fait référence à un passage de la trilogie originelle (ça me rappelle vaguement quelque chose), et qu’il pense que ça pourrait avoir un effet sur le spectateur, sauf que le placer là (comme ailleurs, n’importe où), n’a aucun sens. Et j’ai souvent eu cette impression lors du film : je me dis, tiens, là il est en train de reprendre une posture qui a dû le marquer dans la première trilogie, et pour l’avoir vue en boucle, ces images peuvent rarement m’échapper. Le problème, c’est que là où Abrams pense adopter des postures, des images, des effets de mise en scène qui auront une certaine efficacité sur le spectateur, il ne multiplie en réalité que des gimmicks et des clins d’œil qui nuisent à la cohérence de sa propre mise en scène. On n’arrivera pas à me faire croire que quand on structure son histoire comme on tisse un grand manteau d’Arlequin on en arrive à en faire de la haute couture.
Il n’y a pas que des séquences qui pourraient être coupées pour rendre le film bien plus lisible et rythmé qu’il ne l’est en réalité. Quand on coupe des personnages ou certaines quêtes secondaires, on arrive forcément à réduire la voilure et à se concentrer sur l’essentiel. Est-ce que par exemple le droïde en forme de cornet de pop-corn a une utilité narrative ? La petite amie de Poe est-elle si nécessaire à l’histoire ? Là encore, on voit bien que son utilité est d’abord de faire référence à la vieille amitié entre Han Solo et Lando Calrisian ; pourquoi pas, sauf que ça vient encore surenchérir un récit en pleine inflation (j’ai comme l’idée d’ailleurs que le film de Rian Johnson a été intercalé artificiellement au milieu d’une première mouture d’un scénario écrit par Abrams pour toute la trilogie… ; ce qui expliquerait pourquoi ce dernier volet paraît si condensé ; Abrams aurait été obligé de faire de deux scénarios un seul pour permettre à Johnson t’intégrer ces idées dans le second volet — simple conjecture). Parce qu’au-delà d’une nouvelle relation avec un personnage qu’on n’aura pas le temps de suivre, le problème, c’est que ça interdit toute possibilité de développer les relations entre les personnages existants, en particulier les nouveaux de la présente trilogie : Poe et Finn devraient avoir une relation forte suite aux événements qui les a réunis dans le premier volet, or leur complicité ne s’illustre que par des répliques que chacun pourrait dire dans de telles situations d’urgence, jamais aucune référence n’est faite à leur passé commun, qui serait fort utile pourtant pour conforter leur lien, créer une connivence et nous rappeler par ces références des épisodes passés qu’ils (et nous avec eux par identifications) ont passés ensemble. C’est encore la preuve que Abrams est plus soucieux de faire référence aux films de la trilogie initiale que de s’appliquer à suivre les évidentes nécessités dramaturgiques de son histoire : pour créer une connivence entre les personnages (connivence qui existait de fait dans la première trilogie justement parce que les personnages avaient ce type d’interactions), on les fait faire ou dire des références à leur passé commun. C’est comme ça qu’on écrit une histoire. Mais on l’a bien compris, Abrams n’écrit pas une histoire, il écrit un abécédaire dédié aux fans, une fan fiction à plusieurs centaines de millions de dollars de budget et de recette, une grande foire aux références.
Coïncidences heureuses
La rapidité d’exécution du film, son extrême densité, a au moins un avantage sur le public : il a à peine le temps de froncer les sourcils à la moindre facilité de scénario, incohérence ou coïncidence heureuse qu’il est déjà embarqué dans une nouvelle scène et une autre facilité. C’est un peu comme raconter la même blague stupide et absurde à un malade d’Alzheimer profond, le voir répondre « hein, quoi ? », et enchaîner sur la même blague, et cela à l’infini. Abrams s’y connaît en lavage de cerveau : toutes ces réactions interloquées, nous les avons eues durant le film, mais comme des rêves qui s’évaporent au matin, il n’en reste pas grand-chose à notre réveil.
Parmi les coïncidences heureuses dont j’ai eu le temps de me rappeler pendant le film (le monteur a peut-être intercalé malencontreusement un moment de pause dans cette scène) : projetés hors de leur appareil sur la planète déserte dont j’ai oublié le nom, ils se retrouvent enlisés dans des sables mouvants (Rey qui cinq minutes plus tard arrivera à empêcher un vaisseau de quitter la planète n’a même pas l’idée de les faire sortir de ce truc…), puis se retrouvent par enchantement dans des sous-sols… les menant directement aux reliques qu’ils étaient venus chercher ! Oh, mais purée, quelle chance !
Et j’ai bien trop peur de revoir le film, au calme, et de noter toutes ces folles facilités. Comment Abrams, qui est un habitué des pirouettes dramaturgiques pour masquer son manque de talent, a pu devenir à la fois scénariste et réalisateur, cela restera pour moi un des plus grands mystères de notre époque.
Qualités
Le film a pourtant quelques qualités. L’humour, même si on sent bien trop l’envie de forcer vers la comédie au détriment de l’aspect plus tragique, peut parfois faire mouche. Ce rôle de comique est depuis quarante ans dévolu en partie à C3PO, et c’est encore le cas ici. C’est beaucoup moins réussi pour les personnages créés par Abrams, qui ne semblent avoir pour fonction que de rendre cette histoire toujours plus futile. Il y a aussi quelques propositions intéressantes s’intégrant dans l’univers Star Wars tout en n’ayant jamais été évoquées dans les précédents films. Utiliser un sabre laser pour éclairer dans le noir, c’est tout con, mais de mémoire ça n’avait pas été fait. La variation de vitesse des vaisseaux est, me semble-t-il, très bien exploitée que ce soit sur un plan narratif ou graphique (même si cela avait déjà probablement été fait). Le « ricochet » (même s’il faut éviter de demander pourquoi les vaisseaux ennemis parviennent à suivre le faucon comme son ombre), c’est une idée spectaculaire qui marche assez bien, et visuellement c’est beau et conforme à la physique fantaisiste imaginée par Lucas. Ou encore pas mal d’utilisations pratiques de la force : c’est dans ce domaine que le fait d’avoir fantasmé l’univers pendant trente ans ou plus pour un auteur peut être utile. « Qu’est-ce qu’on peut faire avec la force ? » Voilà quelques réponses susceptibles d’enrichir l’univers. (Certaines propositions sont de trop en revanche : capturer un gros vaisseau à pleine puissance alors qu’on commence à peine à maîtriser la force, c’est assez moyen ; le sabre couteau suisse de la Rey obscure ; voire la capacité de guérison : si c’était possible, d’autres maîtres auraient utilisé cette possibilité bien avant, à commencer par Palpatine…)
L’univers Star Wars est si vaste (potentiellement, si la Galaxie n’est pas infinie, son histoire compte plusieurs dizaines de millénaires à explorer), il mériterait que Disney offre la possibilité à de véritables auteurs de s’emparer de cet univers, pour écrire de nouvelles histoires originales dans lesquelles les références aux personnages déjà connus seraient rares voire inexistantes. À ma connaissance, des jeux vidéo s’étaient déjà engouffrés dans cette possibilité.

Autre point positif à mes yeux : je le trouve globalement beau. C’était d’ailleurs le cas des deux précédents volets de la trilogie. Et pour cause. Le récit, la dramaturgie, cite abondamment la première trilogie, c’était normal d’en faire de même pour l’univers graphique. Moins d’effets numériques, paraît-il, en dehors du rafistolage des séquences avec Carrie Fisher et une séquence un peu inutile dans laquelle on voit Luke et Leïa parfaire leur entraînement jedi (semble-t-il sur la lune d’Endor où s’achevait Le Retour du jedi). La fascination maladive de Abrams pour les lumières dans la gueule se retrouve ici malheureusement avec une variation franchement pénible vers les éclairs scintillant foutant mal à la tête et m’obligeant à fermer les yeux. Mais globalement, les décors, l’atmosphère, les paysages proposés, sont franchement magnifiques. Paradoxalement, tout inutile qu’il est, je pense que le personnage avec qui Poe a une histoire, risque de souffrir du syndrome Boba Fett : le port du casque la rend sans doute très sexy, mais on sort un peu frustré de ne pas en savoir plus sur elle. Peut-être un jour la verra-t-on réunie avec Poe dans une série intitulée The Mandoline…
Commentaire après revoyure intégrale :
Je résume Star Wars : Un nouvel espoir : la princesse Leia cache une carte dans un droïde et l’envoie auprès d’Obi-Wan Kenobi pour qu’elle soit exploitée par la Rébellion. Le droïde se rend sur Tatooine où est censé se trouver Kenobi. Sur place, il est recueilli par Luke.
Normal : Kenobi veille sur celui dont on saura plus tard qu’il s’agit du fils d’Anakin Skywalker. C’est une coïncidence heureuse, mais on a vu pire.
Je résume maintenant Star Wars : Le Réveil de la Force censé se caler sur Un nouvel espoir : une carte est cachée dans un droïde auquel on dit de « partir le plus loin possible ». Il traverse un désert, et là, il est recueilli… par la petite fille de Palpatine.
La petite fille de Palpatine aurait pu tout aussi bien se trouver à l’autre bout de la galaxie, peut-être même dans un autre univers parallèle dans lequel elle aurait eu plus de chance d’exister, mais non, elle se trouve pile poil où un droïde se fait la malle avec des informations capitales pour l’avenir de la galaxie.
Soit Palpatine a des milliards d’enfants cachés dans toute la galaxie et on nous a caché un autre côté moins avouable des pouvoirs du côté obscur, soit c’est la plus belle coïncidence heureuse de tout l’univers narratif.
Abrams cadabra étant à la tête de cette nouvelle trilogie, je penche plus pour la coïncidence heureuse que sur un Palpatine gengiskhanesque.
Bon, les coïncidences heureuses, il y en a un paquet dans l’univers Star Wars, mais celle-là, c’est quand même la championne.