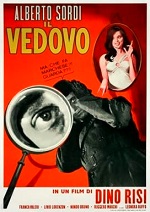Échauffements médiatiques


Don’t Look Up
Année : 2021
Réalisation : Adam McKay
Avec : Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Jennifer Lawrence, Timothée Chalamet, Cate Blanchett, Mark Rylance, Tyler Perry, Jonah Hill, Rob Morgan
Satire poussive qui a peut-être au moins le mérite d’exister. Ou pas. Ce qui a le mérite d’exister, c’est que la satire se double d’une allégorie sans grandes concessions d’un monde incapable de faire face à la réalité d’un réchauffement climatique. Le problème, c’est que si l’allégorie est claire, et si elle emploie le genre difficile de la satire, elle n’a en définitive rien de drôle, et si le film est parsemé d’infinis petits détails bien sentis et cruels, il plonge le spectateur le plus souvent dans une consternation gênée et muette.
La satire est le genre le plus compliqué qui soit, alors quand elle s’attaque en plus à un sujet tragique en gestation lente comprimé ici en quelques mois, le geste est certes louable, mais elle peine largement à convaincre.
L’allégorie donc est simple et plutôt bien trouvée : pour évoquer le réchauffement climatique (cela vaudrait tout aussi bien pour une pandémie), et le quasi-désintéressement du monde face à un désastre annoncé, le film met en scène la quête de deux astronomes soucieux de convaincre la population de la réalité d’une catastrophe imminente, celle qu’une comète foncerait sur la terre et dont l’impact prévu six mois plus tard assurerait à l’humanité une fin certaine. Le ton du film navigue alors tour à tour entre réalisme et farce. Et c’est là le principal défaut du film : chercher d’abord à reproduire plus ou moins bien la manière dont une telle découverte pourrait être faite puis amenée à la connaissance des instances dirigeantes, pour opposer ensuite ces éléments avec d’autres beaucoup plus clairement inscrits dans la farce. Ce mélange incessant de sérieux et de farce (voire de sentimentalisme) a tendance à égarer le spectateur. Si le personnage de Meryl Streep, dans ses outrances et son ridicule, n’a aucun mal à convaincre avec une combinaison présidentielle mêlant Trump et Hillary Clinton, si Leonardo DiCaprio réussit, dans un premier temps, le même exploit avec son rôle de scientifique gauche, on s’écarte définitivement du sujet quand il perd inutilement les pédales, abandonnent ses obsessions premières, et se grise face à sa popularité naissante. En temps de pandémie, surtout en France, cette transformation aurait eu un sens, mais en ce qui concerne le réchauffement climatique, j’avoue ne pas comprendre le message, ou la référence… Les scientifiques qui alertent sur les menaces présentes ou à venir ont le défaut de ne pas être entendus ou pris au sérieux, pas vraiment de tomber dans les travers décrits dans le film. Les grands événements de l’histoire révèlent la nature des individus, et ce dernier travers s’appliquerait davantage aux usurpateurs plus attirés par la lumière que leur offre une crise en mal de sauveurs que par la science.
Les autres personnages ne sont guère plus convaincants. On ne sait trop sur quel pied danser avec ce personnage de la doctorante qui découvre la comète tueuse : difficile de plaisanter à son sujet, le film joue pourtant avec elle dans un comique de répétition aussi peu drôle que malvenu. En appuyant sur le sexisme dont elle est victime et dont son professeur tire profit, à l’image du reste, le film finit par tomber dans ce qu’il semble dénoncer : Leonardo DiCaprio s’étonne d’abord que l’on ne prenne pas plus attention à son étudiante…, puis assume volontiers, seul, le rôle de leader et de caution scientifique (rôle que son étudiante semblait jusque-là assumer — du moins, c’est ce que laisse entrevoir Jennifer Lawrence dans son interprétation — avant de devenir la risée des réseaux sociaux). Ce choix malheureux permet à l’acteur de prendre la lumière, et Adam McKay étouffe dans l’œuf une des propositions intéressantes du film.


Avec celui de la présidente, le portrait fait de la présentatrice télévisée jouée par Cate Blanchett est ce qu’il y a de plus féroce. Seulement, je ne prête pas à l’actrice le même talent que Meryl Streep pour la comédie, encore moins pour la farce. Elle était déjà insupportable dans un Woody Allen de triste mémoire, et c’est à se demander si pour le coup prendre une réelle bimbo de la télévision dans le rôle n’aurait pas mieux fait l’affaire. On devrait pouvoir rire de ses outrances, de son masque botoxé, pas avoir de la peine pour une actrice qui correspond malheureusement un peu trop à la caricature proposée… La satire, comme la comédie, est toujours une question de bonne distance. (Et allez savoir pourquoi, après un début de carrière convaincant, je n’ai jamais pu supporter Cate Blanchett… C’est comme si elle choisissait en permanence des personnages contre-nature.)
Le fils de la présidente quant à lui, s’il a peut-être le mérite au moins de jouer les bons faire-valoir auprès de sa mère, il s’oppose surtout bêtement à la doctorante. Ce n’est pas assez drôle pour se placer réellement dans le registre de la farce, et l’acteur lui-même ne semble pas bien à l’aise à situer la nature ou le registre de son personnage. Un autre acteur est lui aussi perdu dans son rôle, c’est Mark Rylance : mix entre Elon Musk, Jeff Bezos et Steve Jobs, ses allures de téléévangéliste endormi jettent le plus souvent un froid, et la farce supposée jaillir d’une telle caricature d’entrepreneur high-tech patine affreusement dès qu’il a trois phrases à dire.
Deux autres personnages inutiles complètent cette riche distribution : le chef d’une organisation censée gérer les implications d’une telle découverte (personnage tellement inutile que les scénaristes, dans leur bonté, choisissent d’en faire un célibataire sans vie personnelle, sans famille, mais… avec un chat soudain devenu superflu le jour du grand soir — ne l’appelez pas Schrödinger, mais Oglethorpe), et un jeune délinquant joué par Timothée Chalamet dont l’unique utilité dans le film consiste, lui, à appuyer lourdement sur une des seules concessions faites par les auteurs du film à un monde en perte de sens total : la religion. Tout le monde en prend pour son grade, même Hollywood (petite séquence d’autocritique), même les scientifiques qui n’y sont pour rien, et qu’elle est la seule chose qui est préservée dans ce grand dérèglement médiatique ? La religion. On ne peut pas mieux se prendre les pieds dans le tapis. Vive l’Amérique… C’est vrai, quoi, si les scientifiques avaient un peu plus la foi, on n’en serait sans doute pas là tout de même…
Bref, parfois de bonnes idées, de bonnes intentions (difficile d’aborder l’aveuglement de nos sociétés face au grand défi de notre siècle dans un film autrement qu’à travers une satire), mais un résultat mitigé. L’image renvoyée de notre société est consternante, certes, mais ni drôle, ni parfaitement mordant comme il faudrait.



Don’t Look Up : déni cosmique, Adam McKay 2021 | Netflix
Liens externes :
Si vous appréciez le contenu du site, pensez à me soutenir !
Réaliser un don ponctuel
Réaliser un don mensuel
Réaliser un don annuel
Choisir un montant :
Ou saisir un montant personnalisé :
Merci.
(Si vous préférez faire un don par carte/PayPal, le formulaire est sur la colonne de gauche.)
Votre contribution est appréciée.
Votre contribution est appréciée.
Faire un donFaire un don mensuelFaire un don annuel