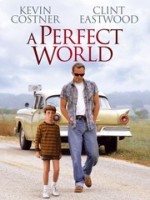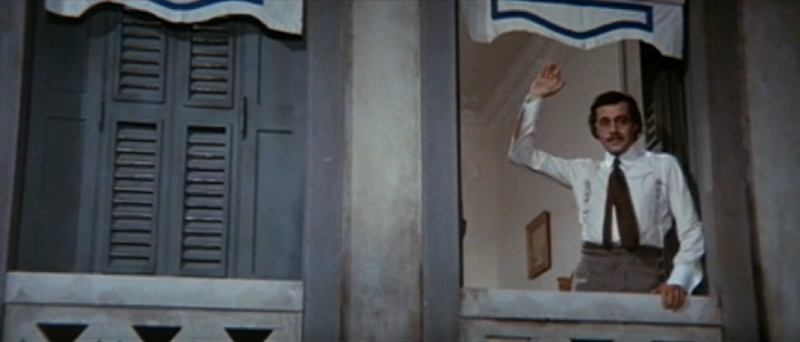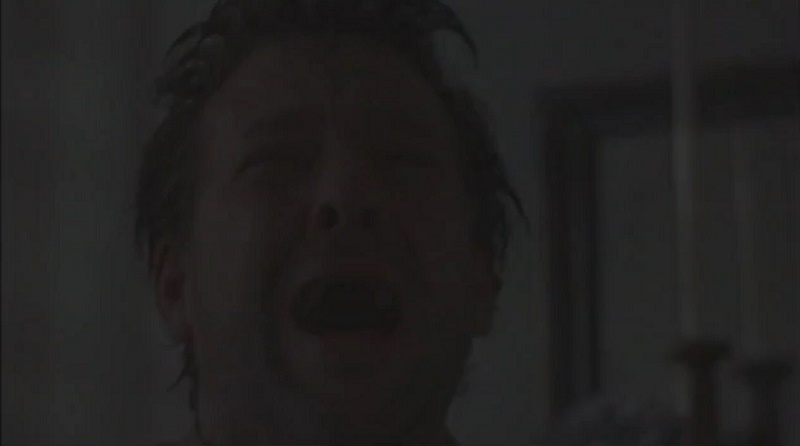Premières notes après la projection du film (c’est parfois dur à lire, à comprendre, ou à suivre, et je ne retouche pas le texte). Ensuite, quelques commentaires plus récents sur des points particuliers.

Usual Suspects, Bryan Singer (1995) | PolyGram Filmed Entertainment, Spelling Films International, Blue Parrot
Mars 1995 :
Extraordinaire, parfait. Un superbe thriller filmé différemment d’Hitchcock. Le cinéaste britannique est pur, simple et en fait toujours juste assez ; Bryan Singer, lui, au contraire, complique la réalisation. Elle est complexe et on a l’impression qu’il n’y avait rien à rajouter, ou à inventer. C’est un long travail de perfection dans la narration. Comme Hitchcock le faisait, et comme le thriller le demande, Bryan Singer joue littéralement avec le spectateur. Il adore jouer avec les différents points de vue et même avec la notion de point de vue. « C’est amusant d’utiliser des images pour convaincre le spectateur d’une chose, et, quelques minutes plus tard, de le convaincre du contraire. » Il comprend aussi que nos actes ne sont pas toujours inspirés par la logique ou par la raison et qu’ainsi parfois il n’y a pas d’explication. Il sait bien que le spectateur chercherait à savoir qui est Keyser Sosé, c’est pourquoi il ne se prive pas de l’induire en erreur même dans des éléments infimes de l’image. À un moment, on se doute que Keyser Sozé pourrait être Hockrey, car on reconnaît la manière du tireur de tenir son arme : horizontalement. Et là, on croit tenir le bon. Mais c’est un piège, car en apprenant à la fin que toute la narration des faits n’était que l’imagination du narrateur, Verbal, on comprend que les images passées n’avaient plus aucun sens. Et Bryan Singer, comme son narrateur, y a introduit des éléments pour tromper la police et le spectateur. Il le manipule magnifiquement en créant un nouveau langage cinématographique auquel le spectateur s’habituait et commençait à y savoir résoudre des intrigues par quelques images ; ou plutôt, il intègre un nouveau mode dans la grammaire cinématographique : un mode où le narrateur, véritable personnage, est en mesure de mentir comme tout autre personnage.
Bien entendu, ce film ne serait pas possible sans la présence d’un autre narrateur — plus traditionnel — : le réalisateur. C’est ainsi que parfois le film revient parfois à un même lieu de base où le réalisateur-narrateur montre au présent son narrateur-personnage raconter. C’est une séquence que l’on retrouve quelques fois tout au long du film, souvent à chaque nouvel élément ou transition, et on retrouve surtout cette séquence — type de séquence — à la fin où le spectateur, ainsi que le policier, comprend la machination du Verbal-narrateur-menteur. Ce moment de compréhension est un grand moment du film, à la fois épilogue tragique et surtout comique. On comprend alors que tout ce qu’on avait alors vu en image était de l’imagination. On ne s’attend pas à ce qu’on nous mente par des images. Autrement que par la parole. C’est une formidable prise de conscience sur ce merveilleux outil de narration qu’est le cinéma.
Pour être plus précis dans l’étude de la forme de la narration, il faut signaler l’originalité de la chronologie des faits. Elle est particulièrement intelligente. Bryan Singer avait des éléments à passer avant d’autres pour pouvoir, comme il le voulait, diriger l’esprit du spectateur. Ce type de narration — humaine et non chronologique, temporelle, logique — lui permet de jouer comme il le dit avec les différents points de vue et avec la notion de point de vue !
Outre la narration, la réalisation est aussi particulièrement réussie. Elle est stylisée. Pratiquement à chaque séquence il y a deux ou trois procédés. Soit dramatiques, soit en rapport avec la réalisation même. C’est-à-dire que le drame et l’idée de base — celle de la narration — permettent de procéder cinématographiquement, surtout en liaison avec le drame. Même quand le drame n’a pas été source d’inspiration, il se débrouille pour qu’il y ait un procédé de montage, certes gratuit même toujours spectaculaire, voire symbolique, comme aussi pour boucher un trou, un moment creux. Comme pour celui où il passe d’une sorte de grotte en forme de cercle pour arriver ensuite dans la séquence suivante à une tasse de café en gros plan sur sa forme circulaire. Simple et gratuit, mais c’est toujours une création intéressante pour le spectacle et pour le geste, sinon pour la transition.
Pour ce qui est du drame propre, si on ne compte pas la narration, il n’est pas mauvais et c’est le plus important. D’autant plus qu’il est rendu extrêmement intéressant par son suspense, sa forme. Ce qui est normal, car un drame, je pense, ne peut pas être fondamentalement hors du commun pour une raison simple, c’est qu’il doit être vraisemblable lorsqu’il ne s’agit pas d’un film fantastique. Il s’agit du réel — qui est narré, représenté : je parle du monde, uniquement — c’est pourquoi, il faut s’efforcer à ce que le drame, l’histoire, voire le canevas s’il y en a un, soit parfait, parfaitement écrit, car le jugement de la qualité, d’un type d’une histoire, plutôt qu’une autre, est subjectif. Alors, pour ce qui est d’une narration ou d’une narration (!), ce n’est plus une histoire qui est jugée mais la manière dont elle est mise en œuvre. Cela se juge sur des éléments précis : la réalisation, la (…) narration. Toutefois, un drame peut être immédiatement sans intérêt, auquel cas il est impossible de redresser la tendance. C’est une base sur laquelle un réalisateur s’appuie.
Ce qui est important dans une œuvre, ce n’est pas bêtement qu’est-ce qui est raconté, mais la manière dont l’histoire est racontée.

Notes 2 :
C’est toujours un peu idiot de jouer les enquêteurs pour savoir qui est le « coupable ». Soit tu trouves, mais t’es con parce que le fait d’avoir cette certitude pendant le film devrait être le signe que tu peux te faire avoir, soit tu ne trouves pas, tu pensais à un autre ou tu t’en foutais royalement, et tu passes de toute façon pour un con parce que c’est le but du film. La pirouette finale, le spectateur de 1995 ne s’y attendait pas forcément. Je l’ai vu à la sortie par accident sans savoir ce que j’allais mâter, et pour moi, pas question de twist (d’ailleurs, on n’en parlait pas autant à l’époque), mais de révélation attendue… Dans un film où on te présente des suspects et où tu sais que tu sauras à la fin que l’un d’eux est le grand méchant, t’attends moins un twist qu’une révélation tout à fait commune, un whodunit… Je ne crois pas que le principe là encore soit de chercher qui c’est. Le but du récit, c’est de nous donner des indices, pas de nous faire sortir du film pour qu’on pioche à chaque instant sur la question, ou sinon il faudrait s’amuser dans ce genre de film à arrêter à chaque indice et demander au public prétendant être capable d’imaginer la fin de rendre leur copie… Probable que ça ne ressemblerait à rien. Un film, c’est comme un rêve : tu peux penser à la vingtième minute un truc, puis le contraire dix minutes après sans le moindre souvenir de ce que tu pensais il y a quelques minutes de ça… Normal qu’à la fin tout le monde pensait avoir tout compris. C’est juste la preuve que tu t’es laissé embobiner comme tous les autres. Il n’y a pas de rêveurs plus intelligents que d’autres… « Hé, mais merde ! moi je savais que je rêvais hein ! »
Bref, le twist, ou le machin surprenant, il est moins dans la révélation du coupable, que dans la méthode et la nature de la révélation. Oui, le film nous prend pour des cons, mais c’est aussi peut-être un peu parce que tous les films nous prennent pour des cons. Entrer dans un film, c’est ça. Et ça, tu l’avais vu venir ? Bah non. Même en sachant que c’était un twist. Alors on retombe sur ses pattes en disant « oh, mais oh ! moi je savais qui c’était le coupable ! » alors qu’il n’a jamais été question de ça. Il n’est pas là le supposé twist. Et quoi que tu en dises, il est bien question là de mise en scène. Il y a même plusieurs niveaux de mise en scène, et c’est bien cette mise en abîme qui peut fasciner, ou donner la nausée. Y a un petit côté Inception dans le film qui peut laisser très vite sur le carreau. Chaque film étant un contrat, c’est à chacun de déterminer si on entre ou pas dans le jeu. Pour un spectateur qui n’a aucune idée de ce qu’il va voir en 1995, avec un petit film comme on croit qu’il en sort toutes les semaines, avec un réalisateur tout jeune qui est un nobody comme le reste du casting à part un vague « frère de », bah, on a probablement plus de chances d’accepter le contrat, c’est certain.
Mais faut aussi savoir regarder le film sans préjugés et se débarrasser de ce qu’on en sait. Et ça, c’est probablement impossible.
Concernant le « il est supposé être intelligent et il n’a rien préparé ». S’il se sent réellement supérieur, il peut être sûr de pouvoir improviser. Ce n’est pas l’incohérence la plus frappante du film. Et comme toutes les incohérences supposées ou réelles, on en revient toujours à la même chose : le crédit qu’on décide d’apporter ou non à un film. On joue le jeu, ou pas. Hé, parce que… un film, c’est un film, donc les incohérences tu en trouves à tous les coins de rue. Pourquoi vos personnages n’appellent-ils pas simplement les flics ? demandait-on à Hitchcock. Et il répondait que sans ça, il n’y aurait pas de film. Pas inutile peut-être de rappeler les poncifs du gros.

C’est moins sur la définition que sur la nature du twist. Si Seven par exemple jouait, là, sur la révélation du « qui » (le fait que ce soit Spacey ramenait le spectateur naturellement à Usual Suspects et toute la pub du film reposait sur l’identité d’un acteur qui n’apparaissait pas au générique), la révélation, ici repose surtout à mon avis sur le principe que le « narrateur » (lui-même certes, un des suspects) raconte des bobards. L’originalité du film, elle est là. Sans parler du principe de la révélation surprenante, ou du twist, qui n’était probablement pas autant à la mode à l’époque (je peux me tromper, mais c’est un type de récit, très foisonnant, qui n’existait pas, et qui sera paradoxalement plus la marque de Fincher par la suite). Aujourd’hui, on ne peut plus voir un film de ce genre sans s’attendre à un retournement, jusqu’à l’absurde (Scream est passé par là), alors qu’à l’époque, pas vraiment. Si l’effet peut paraître aujourd’hui un peu daté, facile, évident, il n’en reste pas moins que ça a très probablement été un tournant dans les productions de polars, tant donc sur la nécessité de proposer un twist (voire plusieurs) que sur l’aspect narratif, foisonnant, à la première personne. Quand tu parles d’impact de la révélation, pour le spectateur de 1995, il est nul puisque le film annonce un mystère, donc très probablement une révélation finale à la Columbo ou à la Agatha Christie. C’est bien différent du coup de pub de Seven où là on annonçait une surprise. On était donc doublement surpris : par le fait qu’on ne s’attendait pas à un revirement, mais aussi parce que tout le récit est remis en question. Plus qu’un vulgaire whodunit qu’on pensait venir voir, on se retrouve avec Rashomon questionnant le crédit qu’on apporte au récit même des événements. Si tu sais déjà que la fin propose autre chose qu’un vulgaire « c’est lui », y a de fortes chances d’être déçu.
Pour le mug… C’est un peu le même problème. Je pense qu’on est moins dans la justification rationnelle que dans l’acceptation d’un principe à travers une mise en œuvre. On marche, et on accepte le principe ; on ne marche pas et on trouvera toujours ça facile, incohérent, stupide… Pure question de rhétorique. Et au-delà de ça, c’est surtout une écriture. C’est peut-être facile, mais ça fait partie d’un style qui s’appuie sur les accessoires et les détails. Les années 90, c’est aussi la décennie d’American Psycho et Pulp Fiction, avec leur style qui balance des détails de ce genre (là encore, Fincher s’emparera du procédé, en particulier pour Fight Club). La cohérence ou l’incohérence, le spectateur a tous les droits ; reste que c’est « un style »… Ça en dit long aussi sur le caractère du personnage de Spacey, parce que si on peut trouver ça facile, c’est assez conforme je trouve à l’idée d’un génie psychopathe qui se plaît à donner des indices à ceux qui le cherchent.
Quoi qu’il arrive dans un film, on passe pour un con. Le principe du cinéma (ou du spectacle), c’est bien de nous présenter une image de la réalité, nous tromper, jouer avec notre perception… Bon, tu peux toujours proposer une œuvre distanciée, mais dans ce type de films, ce n’est clairement pas le but (et pourtant, la distance tu l’auras, puisque tu viendras à te questionner sur ton rapport au récit — si ça se limite à un « putain, je ne l’avais pas deviné », c’est sûr, ce n’est pas très bandant).
Il y a « prendre pour un con » et « prendre pour un con »… Le principe du Rashomon, tu es pris pour un con, mais tu as conscience, au final, ou tout du long, qu’il y a un truc qui cloche ; ça fait partie du contrat, et c’est un peu comme les procédés créant la frayeur dans les films d’horreur : on te prend pour un con, mais c’est justement ce que tu viens chercher. C’est différent par exemple d’un film dont tu sens que c’est une grosse machine commerciale avec des stars, mais que derrière rien ne suit (là, c’est bien le contraire sur ce point vu qu’il n’y a que des inconnus — à l’époque — et la star c’est censé être l’histoire). Comme je dis, on décide ou pas d’adhérer aux principes d’un film, et notre décision se fait probablement bien ailleurs, que dans le simple fait « d’être pris pour un con ». Quand on regarde Rashomon, les différents récits étant contradictoires, y en a forcément qui « nous prend pour des cons », et peut-être même tous. On l’accepte, sinon il n’y a plus de film comme dirait le gros. Ou pas (mais les raisons du refus sont encore une fois toujours ailleurs à mon avis : « tin, je n’aime pas cette actrice, elle me gonfle » « je ne vais pas me laisser avoir par un mug tout de même ! »).
Si on se dit « parce que l’image ment », c’est bien pour ça que c’est intéressant, et que c’est autre chose qu’un whodunit.

Suite sur Usual Suspects / Rashomon :
La différence entre les deux films, ce n’est pas que l’un est plus dans « le procès » en opposant des versions différentes et contradictoires (donc la notion de mensonge est là dès le départ), et que l’autre est dans l’enquête, dans le faux témoignage, puisque si mes souvenirs sont bons, le film ne s’appuie que sur un témoignage dont le but est essentiellement de nous cacher jusqu’au twist final la possibilité du mensonge. À mon avis la référence, il faut surtout la voir du côté de Tarantino qui avait donné avec Reservoir Dogs et Pulp Fiction le ton des années 90. On est dans la déconstruction du récit pour mieux arriver à une éjaculation finale. Un bon film alors à l’époque, puisqu’on n’a pas encore les films bourrés d’effets spéciaux, ça se joue sur le twist. Seven jouera peu de temps après sur le même principe avec un coup d’œil à Usual Suspects. Idem pour Memento (avec un point de vue unique, mais là encore déformé), Big Fish, The Fountain, Fight Club, Eternal Sunshine, Babel.
Il faudrait creuser les récits avec des différences de points de vue, c’est presque un genre en soi. Il doit y en avoir d’autres, mais je pense que plus que le Kurosawa, c’est bien Tarantino qui a ranimé le goût pour les histoires parallèles. On retrouvait ça assez souvent dans les films noirs (Usual Suspects peut être considéré comme un nouveau noir d’ailleurs) ou chez Mankiewicz. La comparaison est intéressante, mais je ne pense pas qu’elle soit volontaire. Une mode initiée par Tarantino, oui. (Tarantino serait également aussi un peu responsable de la fin des thrillers où les femmes ont une place de choix : très à la mode dans les années 80 et 90, ces films semblent avoir été beaucoup moins en vue par la suite – mais ce n’est peut-être qu’une impression.)
Tarantino pompait et connaissait Rashomon, mais ça doit beaucoup moins être le cas du scénariste de Usual Suspects. Puisque c’était dans l’air du temps, c’est plus probable que si référence il y a, que ce soit fait en rapport à Tarantino. À l’époque, il y avait également une mode d’interagir les séries les unes avec les autres. Le scénariste a participé à New York Police Blues qui justement a effectué ce genre de crossover. C’était vraiment très à la mode au cours des années 90 (et ça l’est encore d’ailleurs).

Notes 3 (à traduire):
Revoir Usual Suspects et son impact dans la production et la manière de raconter des histoires à Hollywood :
No point to re-watching it. Memory could be better than a re-evaluation. Cinema is an experience, blabli, blabla.
In my mind, Usual Suspect has had a very important influence on the way, then, films, had to be made. Talking about Tarantino, I don’t see much film trying to emulate Tarantino’s style since some tries late in the 90s. Tarantino creates comedies and he shows his love for cinema through various references. Usual Suspect put the first step in a new thriller planet. Before then, thriller films were generally focused on sexual content, marriage, treason, rip-off, like Basic Instinct or De Palma films, and with more than the influence of films like Scorsese films than Tarantino’s films, Usual Suspect showed the way of complex, confused, tricky plots, with bands/groups instead of couples. The smart one stops being only the characters trying to foul others, but the narrator, the plot, itself. The big difference before and after, it’s the pace, the density of sequences, the numbers of ups and downs. All sequences since Usual Suspect have to be short and most “commercial” films use a bunch of montage sequences (all the contrary of the long takes loved by cineaste like De Palma). The instant, the situations, became less important than the narrative, the storytelling.
It was a bit long to come, but nowadays, no mainstream films can use a 90 or an 80 pace or an “old” fashion narrative. It doesn’t only affect thrillers, but all films. Soderbergh renewed with success not using Sex, Lies, and Videotape way to depict a story, but with fast pace, confused, films with Erin Brockovich and Traffic. Then, it was the time of superhero films and who showed the way? Bryan Singer. There’s a huge difference of plot treatment between Tim Burton’s Batman and the new generation of super-hero films, where the sequence, the situation, the comprehension, are very important. Again, when you have a film with a lot of montage sequences, the notion of sequence doesn’t mean much. At the same times, Nolan landed on the same planet and started to use confused, complex and fast paced films. Even on TV shows, the complexity began to be the rule. And then J.J. Abrams arrived… Studios learned the lesson well, as the old fashion directors. Spielberg, Scott, Lucas, Scorsese, everyone had to jump on the bandwagon.
Another good example of directors using perfectly this new narrative style is David Fincher. Directing Alien, he wanted to honor old-fashioned way to tell stories; yet, the film is mostly remarkable for some montage sequences (à la Coppola). Next films, after Usual Suspect, and maybe the first film directly influenced by Bryan Singer film is Seven (commercials for the film said that there was a big surprise concerning the murderer; the surprise was… Keyser Söze: Kevin Spacey is not mentioned in the opening credits), Fincher used a denser storytelling and a plot based on a twist (the film still has some “soft” pace sequences, though). But since Fight Club, all Fincher films used this fast pace treatment in his storytelling; very few sequences are based on situations, long enough to establish new elements through a long share of dialogues. One sequence, one location, means one new information to put on the house of cards plot (a TV show with?…). And the music, till, has a very important role in this kind of storytelling; this is basically what combines all micro-sequences and suggests a meaning to the audience. For better or, most of the time, for worse.
This is for the benefit of blockbusters. You just have to put a lot of money on the number of sequences/locations, no matter if the plot is totally gobbledygook, you just have to cut it well, put some music to drive the audience’s emotions and comprehension, and that’s all. A lot of events/action, a lot of ups and downs, no long sequences/shots, a lot of CGI and that’s it. They create as others “produce” oil: faster, faster and faster, who cares what it is, just fill the van of success.
I don’t see a lot of other films than Usual Suspect being at the origin of this phenomenon. Nolan, Fincher, Abrams and all superheros or blockbuster films came after. It was predictable, for a generation of viewers used to watch MTV, TV shows and… Twitter. Each sequence of this type of story could be summed up in 140 characters. Each film, also. Like “what the fuck is this all about?!”
Never re-watched Usual Suspect. No need, it’s everywhere.





 Année : 1994
Année : 1994