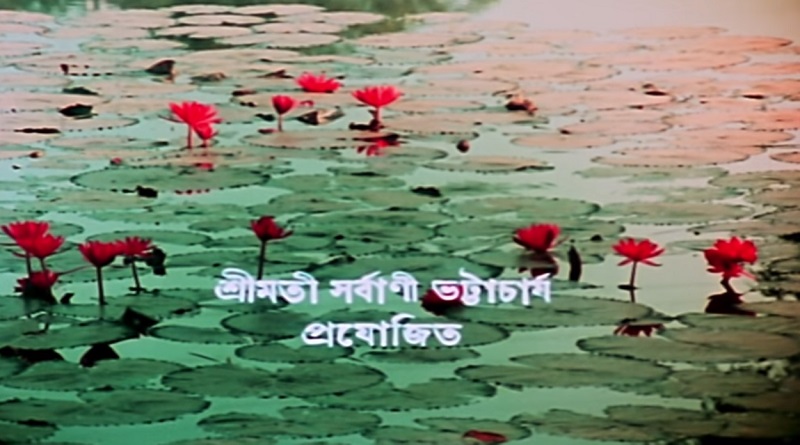Quel film ! Quand on voit : film iranien, on pourrait se dire, d’accord, ça va être du Guédiguian en Iran… ultra naturaliste, rien à se mettre sous la dent… on va se faire ****. Eh ben, c’est naturaliste, c’est sûr. Mais alors… quelle densité ! Un rebondissement toutes les deux minutes. C’est justement le naturalisme qui permet tous ces revirements. Parce qu’autant de péripéties dans un seul film, ce serait en temps normal difficile à croire. Sauf qu’on le sait, la réalité dépasse souvent la fiction. On le sait, et pourtant, je n’ai jamais vu un film arriver aussi bien à montrer ça.
Les gens heureux n’ont pas d’histoire. Tout le monde a des problèmes, mais c’est une autre histoire d’arriver à en faire un film. Tout est ordinaire ici. Un divorce, des motifs de divorce assez flous. Un homme qui doit prendre une femme pour se faire aider à la maison. Parce que son père est atteint d’Alzheimer. Tout se met en place, ça devient un énorme sac de nœuds, tout s’enchaîne, on n’a pas le temps de réfléchir, et tout d’un coup, on comprend qu’il y avait là comme une sorte de préparation qui va être la base de toute une histoire judiciaire. Jusque-là, c’est déjà magistral, ensuite, c’est parti pour le grand huit des apparences et des mises en danger involontaires. Un personnage dit quelque chose, n’en mesure pas les conséquences, et c’est l’engrenage.
Dans tout conflit qui termine devant la justice, il faut trouver qui a tort, qui ment. Sauf que parfois, on peut mentir sans être coupable. Et les personnages mêmes doutent de leur propre culpabilité. Et d’abord, les deux concernés. Ce sont ceux qui devraient savoir qui ont le plus de doutes. La fille finit par comprendre que son père a menti, elle lui demande d’aller dire la vérité, son père lui dit qu’il peut y aller si c’est ce qu’elle veut, et au final, c’est elle qui va mentir pour lui… Si c’est crédible, c’est que ça sonne chaque fois juste. Tous les autres sont prisonniers des apparences et croient déceler la vérité, donc la culpabilité de l’un ou de l’autre, en fonction de ces mêmes apparences. Mais comment pourraient-ils avoir des convictions alors que les deux concernés ont eux-mêmes des doutes ?! Il n’y a pas de vérité. En justice, le père le dit très bien, si telle ou telle chose s’avère être vraie, ça vous identifiera définitivement comme un coupable… La demi-culpabilité n’existe pas, elle sonnera toujours faux. Ainsi, tout n’est qu’apparences, et l’on en est totalement esclave parce qu’on en arrive même à les préserver pour cacher une autre vérité.
Sauver les apparences, toujours. Celles qui nous préservent du pire. Parce que ce qui se révèle plus important que la vérité, ce sont elles… On ne se compromet jamais par vice, mais pour sauver son honneur, sa réputation, son rang. Le mensonge, quand on le regarde à l’extérieur de soi, il est toujours dégradant ; quand c’est nous qu’il égratigne, on le pare d’excuses, d’explications, de circonstances atténuantes…


Voilà tout le côté judiciaire qui vous retourne le cerveau. Il y a ensuite une énorme qualité dans le film, c’est la sensibilité, la complexité non plus du jeu des apparences, mais des non-dits, des actions qui appellent une réaction, toutes les infimes subtilités de la vie qui font de nous des êtres complexes, souvent contradictoires, ne sachant pas précisément ce que nous voulons ; nous faisons des choses tout en espérant en être empêchés. Tout cela, c’est l’histoire intime de ce couple de divorcés. Avec, au milieu, leur fille. Ça ne peut être aussi simple que « je ne t’aime plus, je te quitte ». Pourtant, la première scène, du divorce, c’est presque ça. On est en Iran, passé le commentaire du juge, le divorce à l’amiable, ils l’ont. Au revoir les clichés. Surtout, on comprend vite, par des petites phrases, des aveux, qu’elle voulait que son mari la retienne. La fille était au courant mais ne l’a pas dit à son père… Et sa mère finit par douter de ça… Toujours la quête impossible de la vérité… Quand il est question un instant de revenir, c’est la même chose, ça se joue à rien pour que ça se fasse ou non. Le mot nécessaire à ce que tout rentre dans l’ordre et qui ne vient pas, alors tout dérape… Le même principe, rien n’est acquis, les choses ne sont jamais telles qu’elles paraissent être. L’ex-femme paie la caution de son mari, l’aide, pourtant…, elle le croit coupable… Parce qu’elle voudrait que son mari la rappelle, lui prouve son amour en exprimant son refus de la voir partir…, quand lui accepte la séparation parce qu’il la respecte. Plus on communique, moins on se comprend. Rencontrer l’autre, c’est prendre le risque de le brusquer. Un sac de nœuds, un imbroglio familier, parce que la vie est remplie de ça, de malentendus, de non-dits, de choix contradictoires, de revirements irréfléchis. Et qui, là, est montré avec une intensité et une justesse inédites.
Difficile de trouver des références à ce style de cinéma. On pense naturellement à Bresson pour le naturalisme, ou d’une manière générale, tout le cinéma français des rapports humains. Sauf qu’il faut bien l’avouer, c’est souvent lent et ils nous racontent en deux heures ce qu’il se passe en trois minutes ici… Le rythme s’affole. Pas le temps de s’appesantir, pas une pause, pas d’instant poétique pour respirer. Non, on est pris à la gorge, tout s’enchaîne rapidement, mais dans un même élan, dans la même continuité, donc on n’a aucun mal à suivre. Là encore, pour arriver à ça, soit c’est une belle chance, une alchimie trouvée par hasard, soit il y a derrière tout ça, un vrai savoir-faire. S’il fallait une référence, ce serait peut-être Cassavetes (il faut bien passer par là au moins au début pour situer une forme). C’est vrai que chez Cassavetes, tout s’enchaîne aussi vite, avec intensité et réalisme. Les thèmes diffèrent, même si l’on retrouve le couple au milieu de tout.

Certains parlent du manque de lumière, ou d’élévation, je n’ai vu que ça. Montrer les hommes tels qu’ils sont, c’est-à-dire avec leurs faiblesses, mais aussi la complexité de leurs rapports, pour moi, c’est une élévation. Glorifier les valeurs supérieures de l’être humain, c’est bien, mais c’est un peu facile et pas très productif (et c’est souvent lourd à voir).
La force du film, c’est justement de ne pas proposer de jugement sur ses personnages. Le film constate. Il nous présente tels que nous sommes, et c’est ensuite la réflexion du spectateur qui provoque cette « élévation » ou cette lumière. Après le constat, les conclusions paraissent évidentes. Mais elles sont posées à l’intention du spectateur, non imposées. Oui, le sujet est en quelque sorte l’incommunicabilité des êtres, l’impossibilité d’établir un jugement en rapport avec la réalité. Noir tableau, sans doute, mais éclairer un problème pour envisager une élévation, un meilleur, c’est mieux que de rester dans ses illusions, esclave de ces apparences.
On peut aussi voir le film comme un exercice de style. Chaque scène apportant son lot de révélations, contredisant ou précisant un élément antérieur pour en montrer la complexité. Au début, tout est simple, on se laisse prendre par le jeu des petits conflits qui prennent forme. On a la possibilité de disposer de tous les points de vue, si bien que l’on comprend tous les enjeux de chacun, sans les juger. Parce qu’à chaque rebondissement, ils sont obligés de s’adapter. Peu importent les faiblesses : on condamne les faiblesses humaines quand elles sont gratuites ou cruelles, quand quelqu’un agit en conscience de cause contre les autres et pour son seul profit. Mais les faiblesses qui s’expriment au milieu d’un grand dédale de confusions et d’incompréhension, sans volonté de nuire à autrui, quand elles sont l’expression non pas de faiblesses individuelles, mais quand elles sont propres à des situations inextricables, on peut les excuser (au contraire des personnages qui continuent de s’opposer). Parce qu’on a sans doute tous vécu ce même genre d’expériences dans lesquelles les apparences semblent nous trahir et dans lesquelles notre bonne foi demeure invariablement vaine ; ou au contraire, dans lesquelles on se laisse aller à des petites bassesses, par facilité, par méconnaissance, par bêtise, et par peur des conséquences…

Ces personnages n’apparaissent jamais antipathiques. Quand ils s’opposent, ils sont dans leurs illusions, esclaves et ignorants, à travers le prisme étroit de leur seul point de vue. Aucune agressivité ne se manifeste en eux, même quand ils s’emportent les uns contre les autres. Ce n’est pas de la haine qui est montrée (ce qui les rendrait antipathiques), mais de l’incompréhension. Tous réclament justice. « Comment avez-vous pu lui faire ça ? » Ces personnages possèdent leur propre lumière. Ils se refusent toujours à cette facilité du mépris de l’autre. Leur véhémence naît de l’incompréhension. Et ils ne font ainsi que mettre en lumière, un peu plus, pour nous, cette incapacité qu’ont les hommes à adopter un même point de vue ou à imaginer celui de son voisin. C’est d’autant plus réussi que Farhadi prend deux familles aux mœurs différentes qui auraient tout pour s’opposer. Plus il les oppose, plus on comprend leur trouble, plus on prend les deux camps en sympathie. Qu’importent leurs différences, ils se ressemblent, non pas par leur origine ou leur rang, mais par leur vulnérabilité. Si deux familles que tout oppose peuvent être si semblables, c’est que nous sommes vulnérables aux mêmes pièges des apparences, à la même justice aveugle, et à la même incompréhension.
Élever les hommes avec des injonctions simples et toutes faites, du genre « il faut être heureux » ou « il faut être entreprenant », ce n’est pas bien compliqué et ça ne mène nulle part. On n’a pas besoin de films pour nous rappeler ce qu’on sait déjà et qui est facile à exprimer. Enfoncer des portes ouvertes, c’est en général assez pénible à voir, alors qu’être dans le constat, la démonstration de situations peu évidentes, qui nous sont toutes familières mais que l’on peut difficilement exprimer, c’est déjà plus enrichissant et plus stimulant. Comment faire entendre à quelqu’un que les choses sont compliquées, qu’on n’a pas voulu agir mal ou que les choses sont différentes de ce qu’elles semblent être ? On se retrouve, comme dans le film, à ne pas pouvoir en faire la démonstration. Au moins ici, en deux heures de film, la plupart des spectateurs ressortiront avec ce même constat que les choses sont compliquées à juger, à interpréter, à voir. La lumière, elle est là : au moins pour une fois, tout ce petit monde sera sur la même longueur d’onde, et pourra, par la suite, bénéficier de cette expérience pour regarder autrement les choses. Se garder de tomber, par facilité, ignorance ou intérêt, dans un jeu qu’on pourrait tout aussi bien perdre. Croire aux apparences, c’est s’en rendre esclave et avoir déjà perdu. Une leçon de vie, ça élève toujours plus qu’une prière béate faite de poncifs à la gloire de la grandeur humaine.
« Soyez heureux (et cons) ! Gavez-vous ou un autre le fera pour vous ! » Hum, oui. Préférons rester béats d’admiration devant un film (un mensonge) qui illustre l’idée de vérités partielles, et qui rappelle que la vérité qui prétend se montrer toute nue n’est parfois rien d’autre qu’une pute.
Un mot sur la mise en scène. Un réalisateur qui arrive à faire deux scènes de tribunal (une à la fin et une au début) sans montrer la gueule du juge tout en nous laissant croire que c’est la plus évidente des choses, est un génie. D’accord, il y a peut-être une volonté de rappeler que la justice n’a pas de visage…, un de ces symboles quelconques… Je veux y voir surtout l’expression la plus élémentaire de ce qu’est la mise en scène : faire des choix, montrer ou ne pas montrer, se focaliser sur certains éléments et pas d’autres. Ce sont deux scènes de tribunal, pourtant c’est déjà un tête-à-tête entre les deux personnages. Le reste, on s’en moque. Le sujet, ce n’est pas qu’ils divorcent, c’est qu’ils s’étripent au milieu d’une dernière salade de malentendus. On montre ce qui est significatif à la loupe ; les personnages secondaires, hop, hors-champ !

Une séparation, Asghar Farhadi 2011 Jodaeiye Nader az Simin | Asghar Farhadi Productions, Dreamlab Films, MPA APSA Academy Film Fund