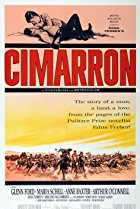On est en pleine émergence du film parlant. La technique est surtout utilisée pour des films musicaux dont celui-ci fait partie sans être véritablement un « film musical ». La transition se fait en douceur : en Europe et au Japon, on continue de faire exclusivement des films muets. C’est l’année où Pabst par exemple en Allemagne fait Loulou, avec Louise Brooks, où Bunuel tourne Un chien andalou. Bref, ce con de cinéma sonore tue irrémédiablement l’utopie d’un cinéma réunissant les peuples autour d’une langue commune. Dès lors, ce sera les studios hollywoodiens qui imposeront leur vision et leur culture au monde. Le chaos en Europe obligera plus tard les créateurs européens à enrichir la production hollywoodienne. Parce qu’il s’agit bien de production : au pays du fordisme, il est question de créer des œuvres de masses, à succès. Le procédé du parlant, plus qu’un outil de création pour de nouveaux auteurs, est surtout au début, un gadget publicitaire pour faire venir les foules.
Pour être franc, je ne connais pas bien cette période de transition qui ne semble pas bien prolifique en chefs-d’œuvre (ce serait comme pour les films 3D : ce qui compte, ce n’est pas l’histoire mais le procédé donc les bons films…), contrairement aux derniers muets sortis cette même année 29. Cela faisait donc un moment que je voulais voir ce film de Vidor, son premier sonore, reconnu lui comme un grand film. Les chefs-d’œuvre montrent la voie, celui-ci se contentera donc d’être un grand film en… montant la voix.
Hallelujah ! est un ovni. Le parlant n’a encore aucun code, il faut les inventer. On est encore parfois dans le muet… avec du son. Le résultat est assez particulier.


Parmi les particularités des films, son sujet d’abord. L’un des premiers films tournés avec une distribution composée uniquement d’acteurs noirs. La première image du film sonore qui reste dans les esprits, c’est cette figure d’acteur blanc grimé en Noir du Chanteur de jazz… Ici ce sont donc de vrais Noirs, qui dans leur vie du Sud, la journée, récoltent le coton. Le soir venu, ils dansent et chantent. Pas de misérabilisme, au contraire, on se croirait presque au paradis. La même vision de l’humanité de Vidor qu’on retrouvera cinq ans plus tard dans Notre pain quotidien. À ma connaissance, on ne tournera plus de film de ce genre jusqu’à Cabin in the Sky de Minnelli (autre ovni dans son genre). Hollywood avait là la possibilité de créer un genre, de mettre les Noirs au cœur de celui-ci, de leur donner une légitimité au cœur du système et ainsi leur donner une visibilité dans la culture populaire américaine en même temps que la musique noire américaine (jazz et blues qui tirent leurs racines des chants religieux et chantés dans les champs qu’on voit dans le film) : la Californie ne devait pas être encore mure pour le Jazz… Il en aurait peut-être été autrement si Hollywood était née à la Nouvelle-Orléans ou à Chicago… Un peu plus tard on retrouvera Paul Robeson dans Show Boat, chantant Ol’ Mand River, occasion manquée encore. Les génies noirs tapent à la porte du cinéma, mais ne seront pas aussi bien accueillis que les scénaristes blancs d’Europe centrale. Déjà Robeson (plus tard blacklisté pour ses engagements politiques) avait retrouvé en Angleterre où il avait étudié, Nina Mae McKinney, héroïne éphémère de cet Hallelujah!
L’histoire du film semble tout aussi “endémique”… Une famille récolte le coton dans les champs. Le petit fils, Zeke, commence à devenir adulte, et certaines pulsions le tyrannisent. Envie de sexe (sans le dire aussi explicitement), c’est surtout pendant tout le film une lutte dans son esprit entre le côté clair et obscur… Lui dirait qu’il est tenté par le diable. Ce n’est pas un mauvais garçon, mais il succombe vite à la tentation, à la facilité, à la luxure… Zeke est donc chargé avec son frère d’aller vendre en ville le coton récolté. Il en tire une grosse liasse de billets. Au même moment, dans la rue, des joueurs de dés sont hypnotisés par la danse de la belle Chick, surnommée « café-crème » dans les sous-titres français. D’une beauté à tomber. Nina Mae McKinney bien sûr. Elle n’a que 16 dans le film, et en fait dix ans de plus. Ces yeux, ces yeux !!!… Zeke tombe sous son charme. Elle le suit en voyant son d’argent, et l’entraîne dans un bar. Un petit déhanché, histoire de nous faire tourner la tête, puis elle présente Zeke à Hot Shot, un dandy un peu louche qui va lui piquer son fric aux dès. Zeke est persuadé que Hot shot a triché. Il prend un arme et tire accidentellement sur son jeune frère…

La péripétie paraît peu crédible : revenant avec le corps de son cadet chez ses grands-parents, il n’est jamais ennuyé par la police, et sa famille ne l’accueille pas non plus comme un assassin… Pour se racheter une conscience toutefois, Zeke devient prédicateur. Il donne des leçons à ses ouailles quand lui est sans cesse tiraillé par « le démon ».
Un jour qu’il traverse une ville à dos de mulet, il est reconnu par Chick et son ami Hot shot, qui ne manqueront pas de se foutre de sa gueule… L’opposition entre les crapules de la ville, et l’innocent campagnard. Seulement Chick n’est pas insensible au charme de Zeke et finit par se faire baptiser de ses mains (il faut la voir se la raconte grave, imaginer les séances d’hystérie lors des baptêmes collectifs dans la rivière du coin). Elle finit par s’enfuir avec lui, laissant en plan toute sa famille, sa future promise et sa communauté…
On les retrouve quelques mois après. Zeke travaille dans une scierie. Chick en desperate housewife reçoit toujours la même crapule qui lui ressemble si bien : Hot shot. Chick embobine Zeke à son retour de travail et s’enfuie avec le dandy escroc par la porte de derrière… Zeke les poursuit dans le bayou. Chick meure dans les bras de Zeke après être tombée de la charrette, et Hot shot est tué par Zeke. Après une période au bagne, Zeke revient auprès de sa famille. Quoi qu’il fasse le mec reste un saint…
Pas le film du siècle, mais une vraie singularité. À voir et à apprécier surtout pour les chants et les deux ou trois pas de danse de Nina Mae McKinney. Ainsi que pour voir l’unique réussite d’un genre mort-né. Si le parlant utilisera bien la comédie musicale pour faire son âge d’or, les gold diggers on ira les chercher du côté de Broadway. Les Niggers, avec leur gospel ou leur jazz, pourront bien rester où ils sont. « Niggers all work on de Mississippi, Niggers all work while de white folks play »… in Hollywood.




 Année :
Année : 











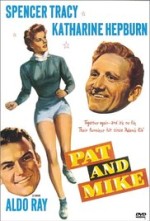 Année : 1952
Année : 1952