
Fish Tank
Année : 2009
Réalisation : Andrea Arnold
Avec : Katie Jarvis, Michael Fassbender, Kierston Wareing
Billy Elliot meets Lilya 4-ever.
Depuis Sans toit ni loi ou Rosetta, on sait que les portraits d’adolescentes en marge, réalisés avec la caméra sur l’épaule pour suivre les déambulations souvent pédestres du personnage principal ont du potentiel. Existe-t-il des exemples de films notables qui se situeraient entre Doisnel et le Sandrine Bonnaire/Agnès Varda, voire entre le Varda et le Dardenne, avec le même modèle féminin de l’ado écorché vif dans le cinéma naturaliste ? Je garde en mémoire un très bon court-métrage de Lynne Ramsay, mais le résumé semble me contredire… La Vie rêvée des anges, mais mes souvenirs, là encore, s’évaporent… Et si l’on prend par exemple Insiang, sans être un apôtre du « male gaze » (j’en parle dans ma critique du film), on remarque assez aisément ce qui distingue l’approche de Brocka et celle d’Andrea Arnold : le personnage d’Insiang est victime des agissements des hommes et peut ainsi être perçu comme un objet plus que comme un sujet (d’où l’argument qui consisterait à dire, et qui vaudrait pour tous les films japonais de l’âge d’or centrés sur des protagonistes féminins — j’évoque cette question dans mon article sur les films de femmes indépendantes et célibataires —, que le regard posé sur le personnage est forcément masculin). Mia, en revanche, est pleinement maîtresse de son destin (ou essaie tout du moins de l’être), ce qu’illustre son besoin constant de bouger (je pars, j’arrive, je me déplace, je réagis, etc.). Elle ne subit pas comme Insiang, elle agit (là où un « male gaze » aurait une tendance supposée à faire de ses personnages féminins des rôles passifs, attentistes — et cela ne produit jamais du bon cinéma).
Quoi qu’il en soit, Andrea Arnold façonne une histoire exactement là où l’on pouvait l’attendre une fois les dix premières minutes du film amorcées (et c’est très bien).
Rien de bien original donc : une ligne dramatique principale (la chronique d’une famille pauvre uniquement composée de rôles féminins — une mère et ses deux gamines — alors qu’elles font mine de se détester, que la mère s’est trouvé un nouveau petit ami, et que le récit adopte le point de vue de la fille aînée) et deux ou trois « actions d’ambiance » comme je les qualifiais à une époque (l’axe jument/amour gitan, l’axe de la danse/audition, l’axe services sociaux/école/amis). Mais une exécution sans fausses notes et une efficacité au rendez-vous. La fermeture du volet sur l’audition de danse m’a semblé un peu trop entendue, pour le coup, mais jusque-là, Andrea Arnold parvenait à surprendre avec des passages obligés et un type de récit désormais plutôt bien formaté.
Le sens de tout ça, je n’en ai aucune idée. Je garde ma préférence pour Lilya-4-ever et Ayka. Plus radicaux dans leurs propositions, ils tirent sur la corde sensible sans pour autant provoquer l’effondrement du décor à forcer de manquer de finesse. Ils tiennent aussi de la tragédie contemporaine plus que de l’exploration des limites de la société. Et dans un style plus antonionien (mutique donc, mais avec le même motif, presque symbolique, de la marche censée illustrer une forme d’action vaine et désespérée), récemment, citons le chef-d’œuvre de Hu Bo, An Elephant Sitting Still. Bref, en tant que simple chronique sociale d’une époque, Fish Tank tient… la corde.
On pourra noter surtout l’extrême habilité de la cinéaste à produire sur la toile ce que l’on attend de l’art : qu’il dévoile les limites des principes, des règles, des lois d’une société. Je pointe souvent du doigt ici le manque d’ambiguïté de certains films qui enfoncent les portes ouvertes et qui n’ont rien d’autre à proposer que leur exposition brutale des évidences (Hope, Les Chatouilles…). Fish Tank joue au contraire toujours sur les frontières, les limites, il parvient à évoluer sur la… corde raide. Connor prend ainsi plaisir à séduire les deux adolescentes, mais on ne peut alors savoir s’il le fait par jeu malsain, pour se faire accepter, ou s’il s’agit d’une manipulation pour arriver à ses fins. Le spectateur n’en sait rien parce qu’Andrea Arnold prend bien soin d’éviter les explications et la psychologie.
Dans la grande tradition des films qui mettent à l’épreuve sociétés, environnements et époques, la cinéaste pose un constat et démontre que même en assistant aux événements, il n’est pas simple de juger une situation, un comportement, un acte. La cinéaste ne se limite pas qu’aux motivations troubles de Connor. L’âge du personnage et de l’actrice n’est sans doute pas choisi au hasard. Le spectateur apprend, explicitement, et un peu sur le tard, que l’adolescente a quinze ans, l’âge justement auquel les lois établissent les limites du consentement éclairé. L’actrice, elle, avait dix-sept ans lors du tournage (au-delà de l’âge du consentement, mais toujours mineure). Quand les deux personnages passent à l’acte (préparé de longue date), peu d’éléments vont dans le sens d’une prise par surprise ou d’une sidération. La question du viol ne se pose alors qu’en fonction de l’âge réel du personnage, et tout le film s’appuie sur l’opposition entre l’éveil du désir (et la jalousie de l’adolescente envers sa mère) et l’autorité effective qu’il exerce, par sa position d’homme majeur, sur la fille mineure de son éphémère petite amie : elle souhaitait clairement cette relation interdite lorsque cela reste flou pour lui. Mais, au regard de la loi, lui est responsable de ses actes, tandis qu’elle est à la limite de l’âge du consentement (à la limite, mais théoriquement en deçà). Qu’importent les circonstances (désir réel et exprimé de l’adolescente, excuse de l’ivresse), pour la loi, il serait qualifié d’agresseur.
Andrea Arnold met donc parfaitement en scène les limites que la société fixe pour protéger les victimes. Chaque spectateur prendra alors parti pour une interprétation plus que pour une autre, et il le fera, influencé par ses propres biais (sauf s’il est conscient que le but de l’expérience peut aussi consister à suspendre son jugement). Dans d’autres films moins réussis, le personnage féminin aurait été plus franchement en deçà de l’âge limite, n’aurait pas été consentant ; l’homme aurait très tôt manifesté, à travers des allusions et des expressions, son désir d’avoir un rapport sexuel et aurait nié toute responsabilité ou faute. Fish Tank rejoint ainsi quelques films qui interrogent avec habilité ces limites, non pas pour les dénoncer, mais pour les mettre à l’épreuve, comme La Rumeur ou Les Dimanches de Ville-d’Avray par exemple.
Un film réussi peut rarement faire l’économie d’une bonne direction d’acteurs et de jolies répliques. La palme des meilleurs dialogues revient à la cadette. Arnold semble s’être amusée à lui réserver les insultes les plus colorées dont la pique finale qui résume la sororité contrariée des deux adolescentes, et dont le jeu de mot intraduisible (« baleines »/« Pays de Galles ») a joliment été traduit en français par « Et n’oublie pas de saluer ces lépreux de Gallois pour moi ». Excuse my French, mais, il y a, en effet, un côté « je t’aime moi non plus » typiquement français.
Fish Tank, Andrea Arnold (2009) | BBC FilmUK , Film Council, Limelight Communication
Listes sur IMDb :
Liens externes :
Si vous appréciez le contenu du site, pensez à me soutenir !
Réaliser un don ponctuel
Réaliser un don mensuel
Réaliser un don annuel
Choisir un montant :
Ou saisir un montant personnalisé :
Merci. (Si vous préférez faire un don par carte/PayPal, le formulaire est sur la colonne de gauche.)
Votre contribution est appréciée.
Votre contribution est appréciée.
Faire un donFaire un don mensuelFaire un don annuel




























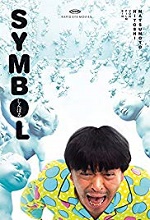


 Année : 2009
Année : 2009












