
Jardin d’été
Titre original : 夏の庭, Natsu no niwa
Aka : The Friends
Année : 1994
Réalisation : Shinji Sômai
Avec : Rentarô Mikuni, Chikage Awashima
Une forme largement empruntée aux animes : un rythme de séquence rapide, des angles de caméra recherchés, des costumes travaillés qui répondent à une logique de carte postale ou d’images d’Épinal, une musique directive et un style général très expressif, très classique.
Cela a son efficacité, mais cela a aussi au début ses limites. Quand on a des cinéastes ainsi tout dévoué à la forme, le jeu d’acteurs laisse parfois à désirer. Les êtres humains ne suivent pas la même logique que les formes inanimées… : il ne suffit pas de les placer ici ou là pour avoir fait le travail. Résultat : les trois gosses agacent rapidement à crier leur texte comme d’autres le font en classe quand ils ont appris leur leçon ou comme les personnages d’animes. Aucune nuance, aucune logique à porter ainsi la voix dans des situations où les garçons doivent se cacher, aucune justesse dans les comportements. Ça jacasse jusqu’à donner mal à la tête.
Et puis, la présence de Rintaro Mikuni apporte plus de sérénité et un contrepoint bienvenu (d’autant plus que le récit manque d’inclusivité : avec les filles qui apportaient gentiment leur soutien et avec les deux camarades qui s’intéressaient à leurs « aventures », vites exclus par les trois « friends »).
L’histoire n’a rien de bien original, mais elle est touchante bien que parfaitement prévisible. Le conte laisse assez peu de place aux développements personnels, aux détours, à la mise en profondeur des uns ou des autres. Le rythme se ralentit et le sujet se focalise alors sur l’unique sujet du film : une fois le jardin défriché et aménagé, c’est le vieux solitaire qui se dévoile.
La caméra semble toujours se désintéresser autant des petites subtilités de « l’âme » adolescente (en se refusant à laisser plus de place aux jeunes acteurs). Les trois bambins entrent en quelque sorte dans le terrier d’Alice, et c’est à travers leurs yeux que l’on découvre le monde du vieil ermite. Leur destin n’a alors plus vraiment d’importance.
Quand, sur la fin, le film tourne franchement au mélo, la force du récit l’emporte sur le reste, et ce sont les vieux (au centre du jardin secret se trouve évidemment une femme), avec leur lenteur, leur imagination, leurs défaillances et leurs doutes qui focalisent l’attention. Les enfants ne sont plus là, avec leur agaçante vivacité, que pour servir la fonction de contrepoint, au début assumée par le personnage du vieillard.
Magnifique dernière séquence pour illustrer le temps qui passe, l’effacement de l’humanité, de sa présence, de sa mémoire, derrière l’espace (celui du jardin). Elle nous ramène ainsi, d’une manière très poétique et désincarnée, à ce que nous sommes. Des passants, des êtres éphémères, face à la quasi-immuabilité des choses. Les bâtiments et les jardins gardent un temps les traces de notre passage, mais comme un verni, ils s’altèrent, se craquellent et tendent à disparaître pour nettoyer la terre et l’espace de toute présence humaine. Derrière ces artifices se cache la réalité du monde.
Je me suis soudainement souvenu du film après une séance ratée précédente. Il se compare aisément avec Un été chez grand-père d’Edward Yang qui vient de me laisser un goût d’inachevé. Je préfère d’un cil celui-ci pour l’efficacité de son écriture (sa radicalité — pour reprendre ma logique du moment — en assumant jusqu’au bout son côté anime/manga), mais les enfants du film de Yang (comme l’ensemble des personnages) me sont cent fois plus sympathiques. Un été chez grand-père prend également la forme du conte (estival, comme il en existe énormément, notamment dans le monde soviétique : on peut citer par exemple Le Jardin des désirs, La Belle ou Cent Jours après l’enfance), preuve que Shinji Sômai aurait très bien pu demander à ses jeunes acteurs de prioriser la justesse, la délicatesse (et une certaine forme d’attention à la tranquillité de l’autre et de respect toute japonaise) à la force et à la surexpressivité (d’autant que Sômai est déjà auteur de l’excellent Typhoon Club, épargné par ces outrances vocales). Tout n’est pas bon à manger dans l’anime.



Jardin d’été, Shinji Sômai 1994 | Natsu no niwa Yomiuri Telecasting Corporation
Listes sur IMDb :
Liens externes :
Si vous appréciez le contenu du site, pensez à me soutenir !
Réaliser un don ponctuel
Réaliser un don mensuel
Réaliser un don annuel
Choisir un montant
Ou saisissez un montant personnalisé :
Merci.
Si vous préférez faire un don par carte/PayPal, le formulaire est sur la colonne de gauche.)
Votre contribution est appréciée.
Votre contribution est appréciée.
Faire un donFaire un don mensuelFaire un don annuel






























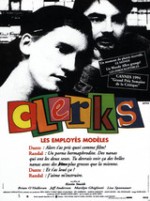 Année : 1994
Année : 1994












 Année : 1994
Année : 1994


 Année : 1994
Année : 1994

