Misumi peut être le réalisateur de grands chambaras comme Hanzo the Razor, Baby Cart ou La Légende de Zatoichi, ce Kiru n’est pas un film de chambara à proprement parler (d’ailleurs Le Sabre non plus). S’il est question de samouraïs ou de duel au katana, l’approche est concentrée ailleurs que sur l’action. La force du film, c’est son récit. Épique, elliptique, concis, il adopte sans doute les qualités du roman dont il est tiré, et il profite d’un des meilleurs raconteurs d’histoires, adaptateurs et metteur en scène de la seconde moitié du XXᵉ siècle : Kaneto Shindô. Le but est donc moins de montrer les diverses galipettes des sabreurs que de raconter une histoire, un destin, et de ne s’intéresser à des détails que pour accentuer une tension, celle qui résulte d’un duel, avant, après, mais rarement pendant : le cling cling des lames d’acier étant finalement toujours le même, autant s’en passer.
Ce qui ne change pas en revanche, c’est le cling cling pour découper la structure d’un récit traditionnel. J’y reviens souvent, mais les principes et les techniques restent immuables. L’isolationnisme finalement, ça peut avoir du bon. Pendant des siècles, la culture japonaise s’est construite sur des modèles de récits anciens, tellement communs aux cultures qu’on peut se demander s’ils ne relèvent pas de traditions communes à une époque où les petits humains se racontaient des histoires au moyen d’une protolangue originelle (qui fait toujours débat, faute d’enregistrements grommelesques d’époque). J’aurais tendance à dire que l’intelligence, voire le désir de partager, précède la capacité à articuler des phrases. On pourrait donc voir dans ces similitudes la preuve d’une transmission d’histoires, de mythes communs, bien avant que la langue puisse se fixer, et finalement s’articuler autour d’une multitude de protolangues à la base de toutes les langues de la planète. À moins bien sûr, que tous ces principes résultent d’une logique des choses. Ma logique reposant sans doute plus sur un brouillamini d’australopithèque que sur un homo rationnicus academicus, j’opterais pour la première option (l’origine de mythes anciens, fondateurs, dont les codes communs à toutes les cultures seraient les derniers vestiges).
Peu importe. Le Japon a su préserver une certaine tradition dans sa manière de raconter des histoires. Avant le roman, invention occidentale qui traîne en longueur, les contes, les récits épiques, les fables, les chroniques animaient l’imaginaire commun. Et tout ça est sorti, villes et jardins, de la tasse de thé de mon conteur australopithèque. Au contraire du roman usant de grossières digressions, de piteux bavardages ou de considérations personnelles, tous ces styles de récit vont à l’essentiel et ne s’attachent le plus souvent qu’à raconter une chose : le destin d’un homme. La transmission d’une telle histoire avait sans doute valeur d’initiation. Parler des malheurs des autres aidait à se préparer à la vie dure préhistorique. L’imagination comme meilleur outil de l’homme afin de s’émanciper des contraintes de l’environnement. Raconter, c’est prévoir ; raconter, c’est vivre à la place de : le monde virtuel avant l’heure.
J’y reviens presque toujours quand je m’extasie (en pauvre australopithèque que je suis) devant le génie narratif de certains auteurs… Parmi ces techniques, la plus efficace, la plus évidente, la plus utilisée, c’est probablement l’ellipse. Elle résulte d’une logique, d’une fin en soi. On ne coupe pas une chronologie des événements comme on s’amuse avec son katana pour découper une à une les fleurs d’un cerisier. Il faut comprendre et donner un sens à la fable. Ce qui compte, comme chez l’acteur, c’est la finale (l’intention finale). Toutes les actions référencées sont tournées vers un même but. Tout ce qui sort de ce cadre doit être supprimé ; on ne garde que ce qui reste au fond de la batée. Miette par miette, on réunit une suite chronologique d’événements qu’il faut désormais lier. La magie du récit fait qu’entre deux événements, s’ils sont intrinsèquement signifiants, ce sera à l’intelligence du spectateur d’en faire le lien. Pourquoi expliquer ce qu’on peut comprendre tout seul ? On va non seulement plus vite, mais le spectateur tient essentiellement son plaisir dans ce travail d’imagination. C’est le pouvoir évocateur de l’ellipse.

Tuer !, Kenji Misumi 1962 Kiru | Daiei



Les ellipses structurent le film. Les plans ne s’intègrent pas dans une logique de tableaux ou de scènes, mais dans une logique d’ensemble. Le montage alterné apparaît naturellement, sans insister : un plan pour évoquer une idée, puis une autre. Le récit avance et ne redonde pas. Si l’on parle souvent de langage pour le cinéma, c’est surtout significatif dans ce type d’histoire. Il n’est pas question d’un langage de tous les jours où l’on cherche à reproduire une impression de réalité. C’est toute une rhétorique de l’image qui s’agglutine pour construire un récit. Les images ne parlent pas, elles racontent. Avec leur part de malentendu et de liberté. Derrière chaque plan, on pourrait presque entendre la voix d’un narrateur suivre le cours du récit. Tel un conte. Ce n’est pas pour rien que la plupart des films japonais muets utilisaient des benshi. Le benshi appartenait à une tradition de l’oralité dans laquelle une histoire était racontée par une voix unique. Le cinéma a fini par adopter naturellement la longueur de ces contes qu’on imagine suivre les soirs au coin du feu. Une heure et demie, deux heures… En dehors de ses expérimentations, le cinéma muet occidental ne faisait pas autre chose : les images, parfois soulignées d’une musique, suivaient le fil d’un récit qu’on racontait à travers des images, mais le sens et le rythme étaient là. C’était déjà celui des contes, de la littérature, et beaucoup moins celle du théâtre ou de la vie où l’on reste esclave d’un espace fini. Eisenstein avait vu juste quand il pensait que deux images montées ensemble avaient un sens (l’effet Koulechov utilisé comme base ou lien sémantique). L’idée était bonne, l’exécution, faute d’être intégrée dans un récit et d’une logique plus large, l’était un peu moins. Ce qu’il faisait à l’échelle d’une scène pour accentuer des effets, des enjeux ou une tension propre à une séquence, il aurait fallu le mettre au service de l’histoire : ne pas jouer sur les séquences, mais sur la fable, comme on dit à un acteur de ne pas jouer sur chaque mot, mais de chercher le sens général d’un texte.
Ce cinéma est donc encore du cinéma de benshi. La voix reste muette, mais les images et le montage parlent à sa place. La technique est d’ailleurs employée assez souvent dans d’autres films : en transition, on rajoute un titre, une voix off. Mais là, tout pourrait être commenté par un narrateur : s’il a besoin d’évoquer dans son récit une scène qui peut être résumée en une phrase, il n’hésite pas, il va droit à cet essentiel et se désintéresse du reste, ça fait partie d’un tout. Ne reste que le murmure, le souffle du conteur : la musique.
Un autre procédé commun, employé le plus souvent de la même manière, si bien qu’il finit par ne plus être que la preuve d’une utilisation systématique de ce « langage » narratif : le plan large d’introduction, voire le gros plan sur un détail du décor (un objet, des animaux, des arbres…). Même principe dans tous les arts, une fois que l’on connaît les codes et qu’on sait les utiliser pour éveiller l’imagination du lecteur, du spectateur, il faut arriver à le surprendre à l’intérieur même de ces codes. Si l’on use toujours d’une même ponctuation pour distiller les événements, on appauvrit considérablement le sens de son histoire. Un écrivain ne doit pas seulement choisir les événements les plus significatifs, mais aussi utiliser les mots les plus justes pour sortir de la banalité des choses. L’auteur possède de nombreuses possibilités par exemple pour traduire le passage d’une période à une autre, créer un lien signifiant entre deux événements (on reste dans l’ellipse), par le biais de connecteurs logiques : « plus tard », « après le… » « lorsque… » « en arrivant à… » « d’ordinaire… » « en marge de » « ce ne fut que… ». Si l’on ne cesse de répéter les « pendant ce temps » ou les « et puis », la saveur est tout autre. Ici par exemple, Misumi commence direct par un gros plan, d’abord de profil, puis de face. C’est un angle fort qui ne s’écarte pourtant pas du cadre qui se dessinera tout au long : il nous décrit ce personnage avant de la mettre en action. Et l’on entend la petite voix du benshi nous dire que ce visage appartient à un personnage important, mais qu’il faut bien le regarder parce qu’on ne le verra plus : on comprend petit à petit, non pas en nous l’expliquant, mais en nous distillant des informations qui nous mettent d’abord sur la voie, avant d’en être certains. Toutes les entrées en matière se ressemblent (il faut mettre en scène l’élément déclencheur, celui qui va tout provoquer, la faute originelle), mais la liberté, on la trouve dans la manière d’évoluer à l’intérieur des contraintes. Mille angles possibles une fois que l’on connaît le cadre à ne pas dépasser.
Le film est ainsi constitué d’évocations multiples. Des plans qui n’auraient aucun sens pris séparément, mais qui, en se combinant, prennent tout leur sens. Comme en littérature ou dans un récit oral quand on peut évoquer facilement certains détails du passé. On trouve ici beaucoup d’inserts de plans reliés à l’histoire de sa mère, donc la sienne. Aujourd’hui, on dirait que ce sont des images qui dévoilent ses pensées. On reste dans une logique de voix narrative : au lieu d’un « je me rappelle », ce serait plutôt un « il se rappelle », voire un « rappelez-vous, spectateur ».


On bannit également tout mouvement accessoire ou détail non signifiant. Quand le héros retrouve son maître assassiné, il le prend d’abord dans ses bras, puis le relève pour le coucher sur le dos. On peut remarquer un léger faux raccord entre les deux plans. On pourrait presque penser qu’il a traîné son maître sur vingt kilomètres pour le faire changer de pièce, et comprendre ce faux raccord comme une ellipse temporelle. Ça aurait été logique de sucrer cette action ridicule assez peu signifiante du samouraï traînant son maître pour le coucher ailleurs… Il s’agit de la même pièce, et pourtant le faux raccord ne saute pas tant que ça aux yeux. Parce que peu importe si le raccord de mouvement n’est pas exact ; la logique, l’essentiel, est là. Il ne s’agit pas de la même phrase. Un plan le montre d’abord prendre son maître dans ses bras ; un autre (son contrechamp) dévoile sa réaction… Même logique, même phrase, qu’on ne pourrait scinder en deux paragraphes : le samouraï découvre son maître assassiné. Mais ensuite, peu importe le raccord : désormais, ce qui compte, c’est d’illustrer ses excuses. Un idiot se serait soucié du détail chronologique et aurait tenu à reconstruire la scène telle qu’elle aurait pu se dérouler dans un monde réel ; or, on s’en moque, on sait que c’est du cinéma, donc une histoire racontée, on n’est pas plus gênés par cette légère incohérence quand c’est un benshi qui commente et joue tous les personnages, ou quand c’est un orateur qui nous évoque des images par la seule puissance des mots. Un récit, c’est le contraire du réel : c’est du réel sélectionné. On ne garde que le signifiant, et le meilleur.
On retrouvera la même idée dans l’utilisation des scènes dialoguées. Encore et toujours le même principe qu’un conte ou un roman. Les mauvais conteurs se perdent en bavardages. Le spectateur n’a pas besoin de beaucoup : quelques informations, un contexte, une situation, une ligne dramatique cohérente, une atmosphère… Une fois qu’on a donné l’essentiel, il faut passer à autre chose. Alors on parle peu, on évite de s’échanger les banalités d’usage ; on n’arrive pas, et l’on ne repart pas d’une scène, on y est déjà : si l’on y est, c’est qu’on y est bien arrivé, et si l’on est arrivé ailleurs, c’est donc bien qu’on l’a quittée, non ?… (C’était bien l’accumulation de ce genre de péripéties anodines que je reprochais au 47 Ronin d’Inagaki où chaque séquence était ponctuée par l’arrivée ou le départ d’un personnage avec tambours et trompettes.)
Le seul écueil quand on joue du katana au montage, c’est la possibilité d’un manque d’identification au personnage principal, à sa quête, son destin. C’est le seul reproche que je puisse faire au film. Je ne sais pas si c’est parce que je peine à trouver Raizô Ichikawa particulièrement brillant, ou si le film manque de chair autour de cette structure bien léchée, mais j’ai bien l’impression qu’un peu moins de rectitude pour nous laisser nous familiariser avec le personnage principal n’aurait pas fait de mal. Manquait un grand acteur capable d’attirer la sympathie et l’adhésion en un rien de temps, entre deux ellipses. Le personnage est certes un idéaliste, une bonne âme, mais Raizô Ichikawa, avec son œil de biche, fait justement un peu trop ton sur ton. Le trait noir, ce n’était pas sur les cils qu’il aurait fallu le faire, mais en travers. Une bien grande, façon balafre. « Fais gaffe à ce que tu dis, toi, sinon je te fourre mon cerisier bien profond ! » Raizô, The Cherry Razor.








 Année : 1962
Année : 1962


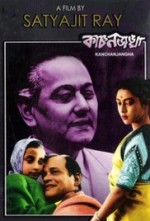 Année : 1962
Année : 1962




















 Année : 1962
Année : 1962










































