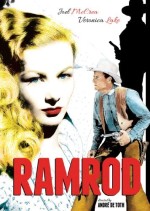Né pour tuer
Titre original : Born to Kill
Année : 1947
Réalisation : Robert Wise
Avec : Claire Trevor, Lawrence Tierney, Walter Slezak, Phillip Terry, Audrey Long, Elisha Cook Jr., Esther Howard
L’intrigue mêle certains archétypes du thriller (tueur en série, ingénue, détective corrompu…) avec des éléments plus inattendus (le tueur est un psychopathe, mais aussi bel homme, ce qui lui permettra de séduire à la fois la fille de bonne famille ainsi que sa « sœurette », et toute sorte encore de détails singuliers). Certaines relations révèlent une telle originalité qu’elles pourraient sortir d’un rêve. Le récit évite pourtant de tomber dans l’invraisemblance. Les deux sœurs de lait semblent avoir bénéficié strictement de la même éducation. La divorcée reste un sujet rare au cinéma à cette époque. Le tueur en série, ensuite, est étrangement flanqué d’un confident (les tueurs pathologiques s’avèrent en général plutôt de nature solitaire, bientôt même, au cinéma, ce seront des tueurs impuissants vivant chez maman, et quand ils appartiennent à un groupe, il convient alors de parler de complices et leurs meurtres sont crapuleux). Enfin, l’enquête est commanditée par une vieille amie alcoolique d’une des victimes, non par la police (qui n’arrive dans le récit que sur le tard) ; on serait loin de penser qu’un tel personnage puisse par amitié s’impliquer autant dans la recherche d’un assassin.
Avec autant d’étrangetés, si l’on évite l’invraisemblable, on devrait au moins frôler le baroque, le mélodrame. Pourtant, tout se tient relativement bien.
Un ressort est activé pendant tout le film pour agrémenter le récit, complexifier les aspirations d’un des protagonistes, et l’on peine à concevoir qu’il ait pu passer la censure : le vice envahissant, refoulé de la sœur et qu’il faut mettre en perspective avec les propres travers pathologiques du tueur en série. Cet axe dramatique permet de faire avancer le film sur trois rails bien distincts : l’enquête à proprement parler (celle du détective embauché par la vieille amie) ; les différentes relations sentimentales ; et enfin, donc, les tendances vénales et prédatrices de la sœur divorcée qui se trouvent comme révélées par la seule présence du tueur, un peu comme un seigneur Sith qui éveillerait le côté obscur alors contenu d’un padawan… Si le tueur en série est déjà un personnage fascinant, ne répondant à aucun code, cette sœur partie divorcer à Reno ressemble à peu de personnages connus à l’époque. Le spectateur est exposé à ses penchants dès le début du film quand elle renonce à appeler la police après avoir découvert les deux corps dans la cuisine de la pension qu’elle avait occupée le temps de son divorce. Elle continue ensuite sur de dangereuses voies obscures en s’entichant de l’assassin, tout en faisant mine du contraire, et en courant un parti capable de lui assurer le confort bourgeois qu’elle a connu en grandissant aux côtés de sa sœur de lait.

Dans les films noirs, les deux « amants criminels » se disent volontiers l’un à l’autre qu’ils s’accordent comme personne. Mais ici, en dehors du renoncement initial à appeler la police, la sœur n’a commis aucun crime et c’est son cheminement intérieur vers le côté obscur qui fournit au récit une part de son suspense. Ah, si, j’oubliais : au regard du code Hays, elle est déjà coupable, puisqu’elle a divorcé.
Et selon le bon principe du code, d’ailleurs, à la dernière bobine, la « morale » sortira gagnante : la justice des balles perdues s’occupera du sort de ces déviants.
Réalisation d’un grand classicisme : on est loin des films noirs âpres et lugubres ou des séries B. On aurait plutôt affaire à un drame criminel avec de subtils accents mélodramatiques. Pour interpréter ces étranges monstres animés par on ne sait quelles pulsions destructrices, des stars auraient définitivement fait passer le film au rang de série A, mais la production a réussi malgré tout à réunir d’excellents acteurs habitués aux seconds rôles. Claire Trevor et Lawrence Tierney forment un duo de qualité, mais s’ils sont très précieux venant en appoint d’une ou deux vedettes, pour tenir ensemble le haut de l’affiche, ça manque d’un je-ne-sais-quoi.
Pour interpréter l’amie alcoolique, respect surtout à Esther Howard et à son visage de Janus (un côté de son visage semble lorgner constamment sur l’autre pour lui reprocher ce qu’il exprime). On l’aura rarement vue autant à la fête. Elle peut ici démontrer toute l’étendue de son talent jusque dans une scène émouvante où son personnage, rincé, déconfit, après avoir échappé de manière plus qu’inattendue à son assassinat, perd d’un coup sa vitalité et sa puissance habituelle pour gagner subtilement en simplicité.
Le film parvient souvent à nous surprendre d’ailleurs, mais pas dans un sens hitchcockien où les surprises se substitueraient au suspense. Ces surprises surgissent plutôt de l’écart entre les attentes du spectateur et la singularité des éléments narratifs venant leur répondre.
Né pour tuer, Robert Wise 1947 Born to Kill | RKO
Sur La Saveur des goûts amers :
Liens externes :
Si vous appréciez le contenu du site, pensez à me soutenir !
Réaliser un don ponctuel
Réaliser un don mensuel
Réaliser un don annuel
Choisir un montant
Ou saisissez un montant personnalisé :
Merci.
(Si vous préférez faire un don par carte/PayPal, le formulaire est sur la colonne de gauche.)
Votre contribution est appréciée.
Votre contribution est appréciée.
Faire un donFaire un don mensuelFaire un don annuel






































 Année : 1947
Année : 1947