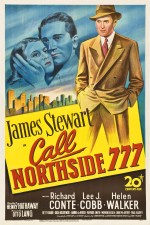Le Spoiler noir

L’Escadron noir

Titre original : Dark command
Année : 1940
Réalisation : Raoul Walsh
Avec : Claire Trevor, Walter Pidgeon, John Wayne
(Pas une critique, mais des notes sur l’intrigue, donc gros spoiler.)
John Wayne est Bob Seton, véritable « cow-boy » du Texas, rustre, bagarreur mais inflexible et incorruptible. Bref, l’archétype du héros us moderne. Il arrive dans une ville du Kansas, Lawrence.
Deux choses à savoir ici pour nous qui n’avons pas étudié l’histoire des États-Unis : le Kansas semble avoir été un État clé dans la guerre de Sécession, tiraillé par les deux camps. Et Lawrence est une ville où se sont déroulés des massacres perpétrés par une bande de pilleurs se réclamant d’abord des Confédérés (Sudistes) profitant du chaos de la guerre, appelée Quantrill’s raiders. Pour le spectateur américain, dès qu’il entend ce nom de Lawrence au Kansas, ça doit lui évoquer quelque chose et se douter qu’on est avant les massacres. Ce serait un peu comme faire un film sur Pompéi : le calme avant la tempête. Le titre du film fait donc directement référence à cette guérilla.
Après l’incertitude d’un vote qui doit rallier le Kansas à la réforme qu’implique l’élection de Lincoln, la ville de Lawrence doit voter pour élire un nouveau marshal. Bob Seton (John Wayne donc) se laisse convaincre de se lancer dans la campagne pour gagner les faveurs de la petite-bourgeoise du coin qu’il a essayé de séduire sans réussite. Mais celle-ci n’a d’yeux que pour l’instituteur de la ville qui se présente lui aussi à élection. Son nom évoque tout de suite le chef de la guérilla qui mettra quelque temps après le feu à la ville : Cantrell (Quantrill dans les livres d’histoire). Il se croit presque assuré de gagner l’élection face à un cow-boy sans éloquence et inconnu dans le coin. Cantrell surtout en a assez de voir malgré, sa « grande intelligence », n’être qu’un instituteur (Walter Pidgon est excellent dans le film au passage). Ce poste devrait lui apporter le respect et la reconnaissance qui lui est dus. Dans le langage du western, un personnage avec autant d’ambition et autant de culture, c’est de la graine de salaud.


Pourtant, face au grand orateur qu’est Cantrell, c’est Seton qui va l’emporter. En mettant l’accent sur son honnêteté. Cantrell l’a mauvaise et l’érudit se fait bandit en se lançant dans la contrebande. Seton prend ses fonctions et la belle Mary McCloud qu’il courtisait au début, se rapproche de lui. Intéressée plus par sa situation que par son charme…
C’est alors que son frère Fletch (qui avait aidé Seton dans son entreprise de « séduction » envers sa sœur), après une altercation dans un commerce, tue l’homme avec qui il se chamaillait.
Ici, magnifique interprétation d’acteur qui à elle seule peut expliquer les revirements soudain et les actions terribles dont on peut se rendre coupable sans en mesurer les conséquences immédiates. Le jeune homme, habituellement gentil et doux, comprend tout de suite son coup de folie et ne cherche pas à fuir. Toute l’ambiguïté et la difficulté de juger les hommes sont ici exprimées en une scène, en une seconde, quand Flech lâche son arme et comprend la folie de son geste. Il n’a rien d’un monstre, pourtant il est bien un meurtrier… Par la suite, on comprendra qu’on se laisse facilement corrompre dès qu’il s’agit de sauver sa peau, car il n’assumera en fait jamais son acte et deviendra un petit con. (Ce qui montre sans doute qu’on devrait chercher plus à juger le comportement après les crimes, pas les crimes en eux-mêmes.)
Sa sœur Mary supplie Seton de le libérer. Il refuse, fidèle à l’implacable intégrité du héros. Alors même que c’était son ami. Cantrell voit donc là l’occasion de se rapprocher de Mary. Il lui propose son aide et lui jure qu’il ne sera pas condamné. Cantrell intimide les jurés en leur rendant visite avec toute sa bande… Fletch est acquitté. Le renard a la voie libre pour se faire la poule.


La Guerre de Sécession éclate. Cantrell part immédiatement vers les plaines pour profiter de l’occasion de se faire un nom et du blé. Suite aux nombreuses exactions et pillages perpétrés dans la région par Cantrell et sa bande, la panique s’empare de la population qui croit son argent peu en sécurité dans les banques et qui veut le retirer. (On reconnaît ici un épisode de Silver City). Et qui est propriétaire de la banque à Lawrence ? Le père McCloud… Il prend la parole au milieu de la foule, leur assure qu’ils seront payés, mais pas tous en même temps le même jour…, et on le tue. Cantrell apprend les malheurs de sa belle, part la rejoindre et la demande en mariage. Elle lui dit qu’avec les derniers événements, elle n’est plus vraiment un bon parti, même que si elle le considère comme un ami fidèle, elle n’est pas amoureuse de lui. Il répond qu’il a de quoi les faire vivre (et pour cause…). Et la naïve colombe, toujours attirée par ce qui brille, accepte.
Cantrell et Mary n’ont même pas le temps de consommer leur mariage : le pilleur apprend l’existence d’un convoi de ravitaillement de l’armée (laquelle, peu importe : Confédérés sans doute). Il part pour l’intercepter. Seton était à sa tête, et il réchappe de justesse à l’attaque de Cantrell.
Cantrell ne revient pas auprès de sa femme et continue de mener ses atroces pillages dans toute la région. Pourtant à Lawrence, on commence à se poser des questions sur lui et la rumeur enfle selon laquelle il ne serait d’aucun des deux camps mais qu’il courrait pour lui-même. La population commence à venir se plaindre devant la riche demeure de Mary, et il faut l’intervention de Seton fraîchement débarqué de son poste (je l’ai vu en VO intégrale, pas compris le détail, je crois que l’État est passé dans le camp de l’Union quand lui roulait pour les Sudistes) pour les calmer. Seton lui propose de la tenir loin des dangers du Kansas en la ramenant auprès de son mari, tandis que lui compte rentrer au Texas. Sur le chemin, il lui dit qu’il l’aime toujours et qu’il sait qu’elle l’aime aussi (le cow-boy a presque autant de flair pour ces choses-là que ses bêtes). Mais elle se refuse toujours à lui… Il la laisse rejoindre son mari…
Mary retrouve son homme dans un camp qui compte plusieurs centaines d’hommes dont son frère Fletch qui a rejoint Cantrell. Elle découvre que loin de vivre comme un commandant d’armée, il vit comme un pacha. Elle comprend alors que toutes les rumeurs sur son compte, sur les pillages, sont vraies.
Seton se fait alors capturer sur le chemin du retour au Texas et est amené à Cantrell. Sa femme réussit à ce qu’il considère Seton comme son hôte, mais Cantrell prend plaisir surtout à lui montrer sa réussite.

Dark Command, Raoul Walsh 1940 | Republic Pictures