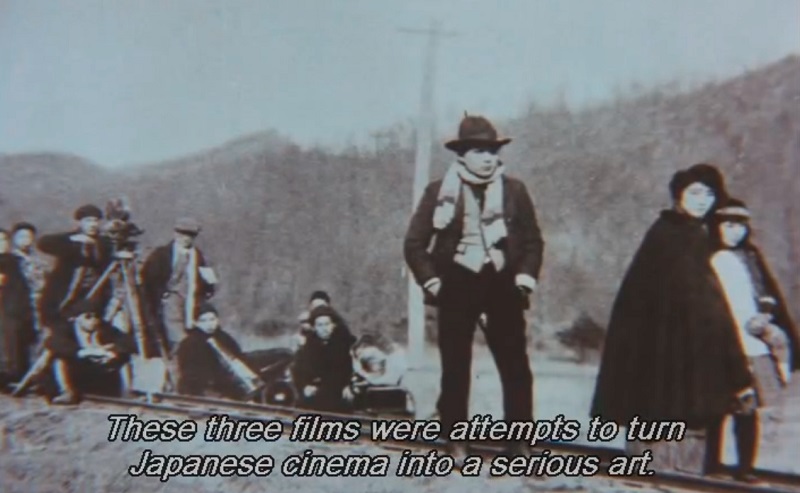Double programme populaire

Komako, fille unique de la maison Shiroko
Titre original : Shirokoya Komako / 白子屋駒子
Année : 1960
Réalisation : Kenji Misumi
Avec : Fujiko Yamamoto, Katsuhiko Kobayashi, Mieko Kondô, Ganjirô Nakamura, Ryûzô Shimada, Minoru Chiaki, Fujio Murakami, Chikako Hosokawa
— TOP FILMS —

Le Palais de la princesse Sen
Titre original : Sen-hime goten / 千姫御殿
Année : 1960
Réalisation : Kenji Misumi
Avec : Fujiko Yamamoto, Kôjirô Hongô, Katsuhiko Kobayashi, Tamao Nakamura, Ganjirô Nakamura, Isuzu Yamada, Takashi Shimura, Osamu Takizawa, Ryûzô Shimada
— TOP FILMS —
Cela en devient un peu indécent de voir autant de drames tragiques ou de beaux mélodrames réalisés par Misumi invisibilisés parce qu’ils ne répondent pas au genre qu’on attend de lui ou que les distributeurs se sont fait de lui. Il ne faut pas s’y tromper, Misumi réalise ces tragédies exactement de la même manière qu’il tourne ses histoires de samouraïs ou de joueurs errants. Dans le genre jidaigeki pur (sine katana), il n’a parfois pas grand-chose à envier à Mizoguchi, par exemple.
Ses séquences sont toujours d’une intensité folle. Ses acteurs ne font jamais un geste de trop. On sent même avec les quelques extraits de théâtre kabuki que l’on peut voir ici ou là qu’il y a une filiation dans la logique de jeu : on est encore dans un jeu très codifié, mais si on adopte parfois des postures ou un petit temps d’arrêt pour exprimer ostensiblement la situation, grâce à ses nombreux gros plans et son montage très resserré, Misumi et ses acteurs reproduisent cette logique, mais l’adaptent aux regards et souvent aux seuls mouvements de tête. Grosse impression de puissance et de tension en retour. Et cela, que Misumi dirige un acteur de comédie, de chambara ou de drame, il s’y prend exactement de la même manière (ou les acteurs qui l’accompagnent répondent toujours aux mêmes codes épurés issus de la scène kabuki).
Tout au long de la riche carrière de Misumi à la Daiei, on l’a vu entouré des mêmes personnes ; plus encore ici avec ces deux films sortis la même année : équipe technique et acteurs sont identiques. On se demande presque sur combien de films une équipe pouvait travailler sur une seule journée… Mais la précision des acteurs et le génie de Misumi à les mettre en scène ne seraient rien sans des histoires fabuleuses à raconter. Ici, on est servi. Ces deux histoires, inconnues du grand public occidental, sont vraisemblablement de grands classiques au Japon. Elles font toutes deux références à des événements ou à des légendes connus ayant fait l’objet de multiples adaptations au théâtre et au cinéma.
Komako semble être inspiré de la vie tragique de Shirakoya Okuma, fille aînée d’un négociant en bois au 18e siècle et condamnée à mort pour des faits qui diffèrent largement de ce à quoi on assiste dans le film puisque celui-ci prend résolument fait et cause en faveur des amoureux déchus. Il s’agit d’une variation des Amants crucifiés. La fille d’une maison mal gérée est amoureuse depuis son enfance de celui qui a grandi avec elle, l’intentant du clan (ou de l’entreprise), mais sa famille cherche à la marier à un homme pas très beau, gentil, mais excellent gestionnaire qui aidera la maison à recouvrer la prospérité. Le père a la tête continuellement dans les nuages et la mère fricote en secret avec son coiffeur attitré (les joies de l’hypocrisie de la société japonaise derrière les paravents dorés des apparences et de l’honneur familial). À ce quatuor adultérin assez classique dans le genre des films de double suicide (ou d’amants crucifiés, donc) s’ajoute une étonnante note serial avec une sorte de Fantômette qui va et vient dans l’histoire en coup de vent tel un deus ex machina égaré du plateau de tournage d’à côté. Même ce personnage fantaisiste, avec ses talents de voleuse et d’espionne, n’arrivera pas à déjouer le complot dont les deux jeunes amoureux seront victimes. Dans l’histoire originale, ce serait plutôt eux qui se rendraient coupables de complot ; ici, la mort du mari est fortuite, et le complot est ourdi par l’amant de la mère, complot consistant à accuser l’amant de la jeune Komako pour l’écarter d’elle. Le plus étonnant dans l’affaire, c’est encore le finale. Comme dans toute bonne tragédie qui se respecte, le récit réunit tous les protagonistes (enfin ceux qui ne sont pas encore morts), et de manière assez remarquable, il ressort de cette grande scène à faire un constat pas si tragique que ça : tous ont leur raison. Mieux, ils cherchent à trouver la meilleure solution pour le couple adultérin (on insiste sur le fait qu’ils s’aiment depuis l’enfance). Le père finit par marier symboliquement les deux amants illégitimes. Avant, bien sûr, que l’honneur des apparences soit sauf et que tout ce petit monde soit généreusement humilié en place publique.
Pour les images, filer voir ici.
Avec Le Palais de la princesse Sen, on monte dans la hiérarchie de classe. D’une maison frôlant la faillite, on passe aux aventures amoureuses, voire sexuelles, de la fille du shogun. L’histoire semble avoir été maintes fois adaptée (la Daiei avait produit un Princesse Sen six ans auparavant avec Machiko Kyô et un tout jeune Raizo Ichikawa ; l’histoire serait inspirée de la vie de Senhime). Comme à son habitude, Misumi filme les histoires d’amour comme des thrillers. Et peut-être plus ici comme un film d’épouvante. Tous les codes du film du fantôme au début du film sont là : on sent poindre la femme croqueuse d’hommes, la sorcière qui envoûte ses victimes, et le récit prend un aspect de conte (façon Histoires qui sont maintenant du passé) fantastique qui montre déjà qu’on n’est pas tout à fait dans des récits en costumes ou des romances sages imbriquées dans des luttes de pouvoir, mais déjà un peu dans du cinéma de genre (entre Alexandre Dumas et Barbey d’Aurevilly, quand l’Histoire sert de prétexte à développer des récits populaires). Mais un fantastique ludique : on s’amuse du côté répétitif du destin des hommes que la fille du shogun voit débarquer devant elle avant de les voir systématiquement disparaître. L’histoire prend une tournure encore plus mystérieuse quand, forcément, le shogunat s’en mêle et cherche à s’enquérir de ce qu’il se passe réellement au sein du château, car les rumeurs vont bon train, et il en va de la réputation des Tokugawa.
On appâte ainsi la princesse avec un jeune et beau garçon. Celui-ci est vite invité à rejoindre le château où il est appelé à danser devant l’objet de sa mission, la princesse. La princesse Sen, comme avec tous les autres avant lui, s’entiche du bel homme, et bien sûr, à ce moment-là du récit, on se dit qu’on va peut-être en finir avec les assassinats dispersés dans les douves (dans les contes, il y a toujours un basculement où la répétition cesse). Toutes mes conquêtes passées finissaient par connaître cette technique que je ne manquais pas d’appliquer à chacune d’entre elles : c’est quand on se refuse à une femme qu’elle vous porte le plus d’attention. Bon, évidemment, il faut arriver déjà à un certain point de proximité, j’ai maintes fois tenté ma chance dans la rue, et l’indifférence… laisse étrangement indifférent. Vous voyez où je veux en venir : c’est parce que monsieur prétendument danseur itinérant est espion qu’il ne peut totalement (encore) s’adonner aux plaisirs de la chair ou prétendre (comme tous les autres, aveuglés surtout par l’ambition de plaire à la fille la plus en vue du pays) éprouver des sentiments profonds pour la princesse. Et c’est alors parce qu’il lui résiste qu’il lui plaît, et parce qu’il lui plaît… qu’elle lui plaît.
C’est ici que s’opère un autre basculement majeur du récit : adieu l’aspect conte fantastique tendance comico-scabreuse, bonjour le drame politique qu’on sent vite devenir tragédie. Pas d’histoires d’amour contrarié sans complot, et pas d’histoires d’amour interdit sans opposition ou dilemme, très cornélien, entre devoir et passion. Chacun des deux amants est contrarié, d’ailleurs, par un devoir propre (et forcément contradictoire avec celui de l’autre). Celui de l’espion, bien sûr, est de ne pas révéler sa nature… Quant au complot dont ils seront victimes, il vient de loin et propose là encore une vision revisitée de l’histoire originale. Il est imaginé par la sœur d’un ancien amant de la princesse qui, aidée de son propre clan, est parvenue à rentrer au service de la princesse, lui mettre entre les bras des hommes dont elle ignorait jusque-là le sort funeste : les tuer une fois sortis permettant aux comploteurs de répandre à l’extérieur du château des rumeurs qui entacheraient la réputation de la princesse… Tout ça pour finir par assassiner la princesse le jour anniversaire de cet ancien prétendant déchu. (Certains ont la vengeance facile.)
C’est tellement tordu (et joliment grotesque) qu’on reste dans le conte ou la fantaisie. Mais on y croit, justement parce que tout est joué avec gravité et justesse (là aussi, en art, un mariage rarement heureux et durable).
Comme dans le film précédent, les dernières minutes sont remarquables à la fois d’intensité et de tact (autre mariage impossible). Comme tous bons amants dont la condition est divulguée en place publique, il convient de préserver honneur et apparences. Et cela commence, contrairement aux deux amants du film précédent, par les séparer. À l’un, la mort par seppuku, à l’autre, l’obligation de se faire nonne (ou de bonzesse, tel que traduit dans le film).
Je garde les clés de la grande scène à faire du dénouement (un personnage mystère n’a pas été évoqué dans ce joyeux dévoilement de l’intrigue) par respect pour ceux qui voudraient encore voir le film (ou qui sont ennuyés de me lire)… Sachez juste, en guise de pied de nez, qu’il est pour l’heure impossible, pour les raisons plus ou moins exactes détaillées en introduction de ce commentaire, de se procurer ces deux films. Mosfilm et les archives coréennes rendent disponible leur catalogue (voire leur patrimoine) gratuitement sur le Net. Ici, bien que les deux films semblent avoir fait l’objet des soins de rénovation des archives japonaises (comme un carton introductif semble l’indiquer), ces drames de Misumi restent sagement dans des boîtes. Vous n’avez plus qu’à vous porter volontaire comme espion et, au nom du shogunat et du droit à la distribution libre des films du patrimoine mondial de cinéma, accéder aux films jalousement gardés au château des archives nipponnes sans vous faire repérer. Les douves des archives du film, dit-on, sont pleines de corps mutilés de cinéphiles enamourés, jetés là par on ne sait quelle princesse sans scrupules… « Si c’est vrai, c’est grave. »
Pour les images, filer voir ici.