Si Kirio Urayama s’était aidé de Shôhei Imamura pour écrire son premier film (La Ville des coupoles) il s’adjoint ici les services au scénario d’un collaborateur d’Oshima, Toshirô Ishidô, qui travaillera également plus tard aux scénarios des films de Yoshida et qui adaptera pour Imamura dans les années 80, Pluie noire. Politique des « auteurs » oblige, les scénaristes sont rarement mis à l’honneur dans notre vision historique du cinéma ; pourtant on y retrouve très certainement une même pâte réaliste, voire naturaliste, et très sociale dans ces histoires, et une certaine manière aussi, très imamurienne, à proposer des chroniques foisonnantes sur des personnages en marge.
Le premier film réalisé par Urayama se faisait autour d’un personnage féminin d’une quinzaine d’années qui se battait pour sortir de sa condition. On n’en est pas loin ici : même principe, mais on plonge un peu plus dans la misère puisqu’il est question ici de ce qu’on pourrait appeler une sauvageonne. La première scène (le générique) du film donne le ton et on goutte déjà tout excité à la provocation qui sent bon la nouvelle vague nippone : Wakae, quinze ans, au comptoir d’un bar, fume, boit, et peste sur tous les hommes alentour qui voudraient lui mettre la main dessus. La jeune fille aurait pu vite tomber dans la vulgarité et devenir antipathique, mais on y voit surtout grâce au talent de Urayama une adolescente perdue qui noie sa misère et sa solitude dans l’agressivité et la provocation. Quand un homme la touche, c’est volée de gifles, bagarres et injures. Plusieurs fois dans le film revient cette rengaine qui semble avoir été crachée mille fois aux hommes pour les fuir : « Pervers ! ». Les raisons de l’errance mentale de Wakae viendront plus tard : la perte d’une mère, un père alcoolique, et sans attaches une plongée inévitable dans la misère.
Très vite, le titre paraît un peu trompeur car au lieu d’avoir affaire à un récit tournant autour de ce seul personnage féminin, on suivra en fait celui, croisé, de deux adolescents amenés à s’aimer et à lutter ensemble pour survivre. Rien de bien original, c’est Roméo et Juliette transposé dans un Japon misérable ; au moins peut-on suivre le développement de cette histoire d’amour naissante avec des acteurs qui ont l’âge de leur personnage sans qu’on en fasse non plus des imbéciles. L’adolescence (avec ses écueils identitaires, ses tourments) est finalement assez rarement bien rendue. La meilleure approche sans doute est justement de ne pas tomber dans le piège de la complaisance : les adolescents ont les mêmes aspirations que les adultes, la même cruauté sinon plus, la même capacité à se jouer des autres, les mêmes désirs. La grande réussite de l’approche du film, comme souvent chez Oshima ou Imamura quand ils montrent de tels personnages en marge à cette époque, c’est bien de montrer une forme de brutalité de la vie, et de parvenir à montrer des situations et des personnages en lutte sans dénoncer, se moquer, caricaturer ou tomber donc dans l’excès inverse, la complaisance. C’est souvent cru tout simplement.
Wakae rencontre donc Saburo, à la fois plus âgé et de « meilleure famille ». Pour lui sa place est ailleurs qu’auprès des siens, il se sent asphyxié par l’ambition de son frère aîné et les attentes que place en lui toute la famille. Saburo ne fait rien, ne s’intéresse à rien, ne vaut rien, et c’est donc tout naturellement qu’il s’éprend de Wakae la sauvageonne. Mais leur passion est aussi destructrice que bienvenue comme si la place que prenait l’autre pour le soutenir devait finir fatalement par le pousser dans le précipice. « Non, Orphée, ne te retourne pas ! » Conscient que leur amour ne fait que les détruire, Saburo trouve à s’émanciper du poids de sa famille (et de l’amour destructeur de Wakae) en s’entichant d’une autre fille, modeste mais sérieuse ; mais Wakae, en lui courant après, met le feu accidentellement au poulailler de cette famille où Saburo avait trouvé refuge. Les voilà séparés pour de bon. C’est le début du placement de Wakae en maison de redressement (Nippon mécanique).

Rapports extérieur/intérieur, des vitres, de la neige, et de la musique lyrique… un côté Docteur Jivago pour nos adolescents cabossés | Nikkatsu
Le film aurait pu tourner au misérabilisme. L’une des nombreuses réussites du film, c’est de ne pas dénoncer bêtement et systématiquement toutes les figures de l’autorité en prenant chaque fois fait et cause pour ses personnages adolescents. (La compassion est bonne pour ceux qui veulent jeter une petite larme et repartir avec leur conscience assagie.) La vie y est rude dans cet établissement, les adolescentes ne se font pas de cadeaux, mais tous y sont mieux qu’à l’extérieur, et l’ensemble du personnel a un véritable désir de montrer la voie à ces sauvageonnes pour leur permettre de rebondir. Pas de complaisance, mais une infinie bienveillance pour des êtres chahutés par la vie. Le constat sonne juste, car s’il y a de l’espoir dans cette maison où se « redresser », on n’y nourrit aucune illusion. La vie est cruelle, en dehors comme à l’intérieur du refuge, car le monde est identique, et les règles rigoureusement les mêmes. L’une des phrases-clés du film est ainsi prononcée par une des locataires que Wakae surprend en train de fumer dans sa chambre quand toutes les autres regardent un film : « Mais nous ne serons toujours que des parias ». Au Japon, peut-être plus qu’ailleurs, la condition, le statut, est déterminée par la naissance, et aussi, comme elle le dit, par le « passé ». Son passé à elle lui collera toujours à la peau. La même fille avait crié, plus tôt, alors qu’elles participaient à une course et se faisaient chahuter par des villageois : « Nous sommes des êtres humains ! ». Wakae, pour échapper à cette logique, ou à cette fatalité, trouve avec l’aide des éducateurs une place de couturière dans une autre ville. C’est là que la tragédie prend corps. La fuite est depuis cinq mille ans un excellent moteur dramatique. Comprenant, comme Saburo avant elle, qu’ils devaient d’abord arriver à se construire individuellement plutôt que de satisfaire à la possibilité à court terme de se reposer sur l’autre, sachant que dans leur situation, agissant comme une drogue, ils se consumeraient mutuellement, elle décide, et parce qu’elle aime Saburo, de quitter la ville sans le prévenir. Prévenu à temps, Saburo la rattrape sur le quai, et le film prend alors une autre dimension.
Ce qui aurait pu se jouer en trente secondes sur le quai, Urayama et Ishidô en font un dénouement qui s’étire en longueur et sur différentes séquences d’anthologie. La facilité aurait été d’opposer le désir de l’un et la conviction de l’autre et de finir sur quelques lignes de dialogues. Seulement ces deux être-là s’aiment et ils savent que même s’ils doivent prendre des chemins différents quitte à se retrouver plus tard, c’est un choix qu’ils vont devoir prendre ensemble. La force du film social presque : le conflit ne se fait pas entre les personnages ; l’opposant, il n’est pas caractérisé à travers les traits d’un persécuteur, c’est au contraire un contexte qui pèse sur le destin des personnages.
Voilà donc nos deux jeunes amoureux autour d’une table de restaurant au milieu d’autres voyageurs attendant le départ de leur train. Un classique, et pourtant.

Ce dernier quart d’heure est d’une grâce rare. L’histoire, le sujet, les situations ne comptent plus, il n’y a plus que la mise en scène de deux êtres face à leur choix. On oublie qu’il s’agit d’adolescents. Le temps n’est plus rien, le premier et le second plan se mêlent. Tout se brouille et tout se concentre autour de ce choix qui devra décider du destin de deux êtres qui s’adorent : Wakae doit-elle ou non partir et s’éloigner de Saburo. La situation pourrait être commune (bien que, le fait de décider « ensemble », ou plutôt « en accord » — Wakae attendant que Saburo accepte de la laisser partir mais lui laisse le choix —, n’a rien de commun), sa mise en forme tient du génie. Ralentissement de la situation pour en augmenter la tension (quitte à reproduire les mêmes plans) ; accélération et transformation du rythme une fois la décision prise (mouvement lent, mouvement rapide) ; et comme dans ces chefs-d’œuvre où les fins sont interminables, touchées, oui, par la grâce, les dénouements ne cessent de faire des petits — quand il n’y en a plus, il y en a encore. Comme quand, à la fin du spectacle, les lumières s’éteignent, et qu’il ne veut plus nous quitter. Il faut imaginer la fin du Lauréat dilatée sur une quinzaine de minutes. Du coup d’éclat au coup de… grâce. Il y a des films qui s’élancent pour ne jamais retomber. Ainsi Saburo et Wakae se retrouvent dans le même train, et c’est Saburo qui expliquera à sa belle la marche à suivre : leurs chemins se séparent, mais s’ils s’aiment encore, ils pourront se retrouver, changer, sans que la présence de l’autre ne les intoxique. Deux êtres qui s’aiment, laissés à la dérive d’un bout à l’autre de l’océan.
La scène du restaurant, c’est donc là que tout commence, une des meilleures scènes du genre avec le traitement le plus hallucinant de l’arrière-plan jamais vu. Ce qu’on verrait dans n’importe quel film banal ce sont des figurants ; là on y voit des acteurs réagir, agir même, face à la “scène” qui se joue tout près d’eux ; jusqu’à offrir en toute fin un contrepoint idéal… et presque satirique : la futilité d’un spectacle télévisé qui aguiche comme des mouches nos clients dans cette salle de restaurant animée, face à ce choix qui tarde à se faire entre deux adolescents. Quand l’arrière-plan vient rehausser le premier, lui donner le relief presque du réel ou l’harmonie tragique d’un jeu de destins où chacun jouerait sa propre partition tout en composant un ensemble cohérent et indivisible. Point, contrepoint. On dit qu’un bon acteur c’est un acteur qui sait écouter, alors que dire des figurants qui écoutent ?… et qui finissent par s’animer au milieu d’un décor qui ne se contente le plus souvent que de ne proposer un tableau immobile de figures sans histoires. Sidérant de justesse pour la scène la plus cruciale du film. (Avant ça le réal avait déjà montré dans quelques séquences son intérêt assez singulier pour l’arrière-plan, à la Orson Welles presque. À un moment, je pense même avoir vu la caméra perdre le point pour le retrouver aussitôt ; ça ne pourrait être qu’un accident mais cela illustrait pourtant parfaitement la sensation du spectateur à laisser son attention vagabonder en arrière-plan ou simplement avoir l’œil qui se trouble pour réfléchir ou se distraire…)
C’est beau le talent quand même, parce qu’il vous cloue le bec et vous fait mijoter encore longtemps en pensées la force de leurs évidences…
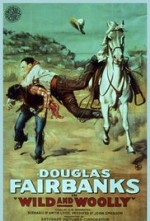



































 Année : 1934
Année : 1934




 Année : 1937
Année : 1937












 Année : 1990
Année : 1990








