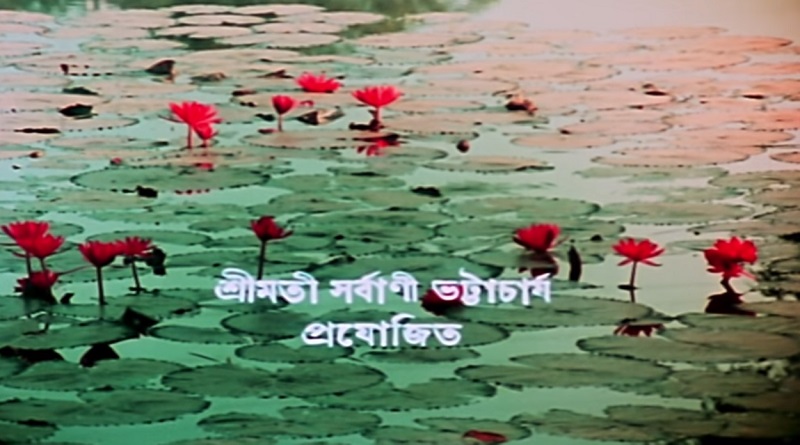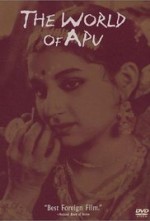Qui regarde les pigeons se faire la cour au printemps comprend tout de l’amour : ce qu’il a d’universel, d’abord, puis le systématisme tout newtonien auquel il obéit sans faille chez tous les êtres vivants de la planète. Le mâle parade et voudrait que sa force d’attraction séduise au plus vite sa belle, qui elle, pas fille facile, se devra d’abord de résister, avant pourquoi pas, de consentir à l’union céleste. Celui qui se montrera trop pressant aura peu de chance de voir la belle se donner à lui, et celui qui paradera comme un coq à se voir plus beau que la belle n’arrivera pas plus à ses fins, car un autre viendra lui plumer sa belle dès qu’il aura le dos tourné en exécutant la danse de trop.
Dutt a parfaitement compris les lois de l’attraction et les applique au mélo. Bien sûr, les amours d’un homme et d’une femme se parent d’une sophistication étrangère aux pigeons, mais le principe reste le même. Je te désire, je montre que je te désire ; le désir que tu montres pour moi fait naître en moi un peu de désir, alors je me laisse regarder, je regarde à mon tour, je toise tes attentions, je sais qu’il ou elle toise les miennes, etc. Je te regarde moi non plus. Une véritable cour à l’échalote. Ce qu’il y a de remarquable, en plus, chez les êtres humains, c’est que l’amour baigne dans une soupe de conventions à laquelle les protagonistes ne peuvent bien sûr s’affranchir ; il faut bien jouer, en plus, avec cette force d’inertie cosmique, sans quoi on végète dans le vide stellaire, seuls et misérables. Mais cette force d’opposition fait naître aussi une tension entre les deux entités qui jouent à ce jeu d’attirance et de répulsion : qui dit résistance en amour (vers la résolution attendue, le dénouement, l’accomplissement, la jouissance consommée…) dit aussi suspense et tension fébrile pour le spectateur. Dans un mélo indien, ce suspense a ses codes, ainsi cette soupe d’opposition est dense et interdira jusqu’au bout l’amour de ces êtres, faisant du film une longue parade, souvent tragique, au dénouement impossible. Et c’est la règle, la cour est longue d’au moins deux heures.
Deux heures, c’est long, mais les Indiens semblent avoir une endurance (comme certains pigeons) bien plus importantes que la nôtre. Il est vrai qu’on est désormais habitués aux amours rapidement consommées, multipliées, transversalées en une Ronde sans fin, résultat d’un siècle de culture consumériste où l’individu même est le produit ultime de cette consommation sans fin. Le suspense amoureux au cinéma procède d’une logique simple : le spectateur tient moins longtemps que ses héros tout constipés par cette indicible soupe de conventions et de devoirs, et l’amour qu’on peut offrir à la ou aux vedettes tenant souvent plus du fantasme, on est certes plus prompts à nous jeter dans leurs bras. Un mélo est toujours un prétexte à se mettre à la place du lièvre, sautant d’un fantasme à l’autre, plongeant allégrement dans le brouillard, défiant les embûches avec une svelte fureur que rien n’arrête… et nous n’en finissons pas de vouloir bousculer ces difficiles tortues paradant mille ans sans succomber et qui semblent toujours à la traîne de nos rêves. Une nouvelle force est là, invisible mais aux effets certains, la matière noire de ce système que l’on pensait d’abord double : notre regard, nos attentes, notre impatience, une force d’attraction qui ne stimule en rien la danse de ces deux tortues mais qui, peut-être, en est à l’origine… et qui finit par nous, affreux lièvres sautillants, plonger dans le désespoir. Le mélo, comme le film d’horreur, est une torture masochiste. On y vient pour ne jamais y trouver ce qu’on voudrait voir, entendu que notre plaisir, on le trouve à imaginer ce qu’on ne verra jamais… Roucoulons donc, nous ne verrons jamais ces tristes oiseaux chanter… coït-coït. Guru Dutt le montre bien d’ailleurs en faisant de ses intermèdes chantés de véritables pauses rêveuses, ou des projections d’un monde commun affranchi de toutes ces forces contraires, là où seuls peuvent s’exprimer les élans amoureux des personnages.



Une pause, tiens, de diversion pour m’émerveiller, seul, du pouvoir d’attraction des saris. Étrange plumage qui corsète la femme indienne comme une seconde peau, une peau qui peut dignement s’offrir au regard mais qui ne fait surtout que souligner les traits gracieux des corps nus. Rien de plus sensuel bien sûr qu’un vêtement qui cache à un endroit pour mieux mettre en évidence le peu qu’on dévoile. L’Occident a vu ses femmes se libérer de ces mêmes carcans sensuels et son corps, tout en se refusant autant aux hommes, s’est lâchement dévoilé pour mieux se cacher. Quand on montre tout, on ne voit plus rien. Le corps nu, libéré du vêtement qui lui donne forme, densité, et retenue, devient un objet, beaucoup moins de désir que de consommation ; un produit comme un autre ayant perdu sa capacité à attirer le regard ; une « fadesse molle » sans maintien et sans envergure. Un trou noir invisible et glouton. Pour espérer passer à la casserole le pigeon farci, en somme, il faut d’abord se laisser séduire par un joli gigot à la ficelle… ou au sari.
Coït-coît donc, revenons à nos moutons. La tension de l’amour naissant qui se cristallise, quand chacun sait ou devine que l’autre se refuse de s’avouer ce que chacun sait et cache, et que l’attention de chacun est tendue vers le moindre geste de l’autre, qui pourrait être le signe, la révélation, l’aveu de son amour… « Toi » « Non, toi ! » Attendre et espérer les preuves de l’attention de l’autre. Chacun se montre et prend soin d’être vu sans se dévoiler totalement, en feignant l’indifférence, mais bien là oui dans son champ de vision. On prend alors prétexte de tout pour tromper les attentes et provoquer l’aveu de l’autre : l’attention feint d’être professionnelle, misanthropique, puis bientôt, à force d’habitude, elle devient celle d’un frère ou d’une sœur. Ah, pouvoir toucher du doigt ce à quoi on se refuse, sentir ce regard tendre, bienveillant, ces mouvements doux et tendus vers nous, même obligés de feindre toujours autre chose que ce qu’on sait être ! Oh ciel ! Puissions-nous nous étreindre enfin ! Mais ce n’est qu’une parade en sourdine, voilée, muette, où le moindre geste devient un signe d’amour et d’attention caché ! Ah… J’attends et je sais que tu sais. Nous sommes pris au piège mais ces gestes, je sais que tu vois que je les fais pour toi… Quel beau système stellaire double plongé dans une danse d’attraction majestueuse, et sans fin… Déjà, le pigeon qui feint mal et montre surtout son impatience à conclure se voit aussitôt rejeté. Les lois de la gravitation universelle, il faut y mettre les formes. La parade ne sert pas à montrer mais bien à cacher ses intentions, et on ne s’attache jamais qu’à ceux qui feignent le mieux.
Ainsi, Guru connaît la musique et nous sert sans fin le même 33 tours : quand c’est fini, ça recommence pour un tour. Boléro sur boléro, indéfiniment, ravelement. Ceux qui se refusent sont les plus désirables et certaines étoiles gravitent ainsi sans fondre en une même nébuleuse. Il en est ainsi dans ce cinéma indien où jamais on ne succombe aux dénouements, aux baisers, aux étreintes faciles, aux « je t’aime ». Quand dans un système hollywoodien, on ellipse, et on passe à l’après pour commencer une autre histoire, dans ce cinéma d’évitement et d’interdit, on se fige comme des statues tragiques gravitant à l’infini dans une parade fascinante puisque chaque fois que l’une d’elles semble succomber à l’autre, une force opposée les y interdit tous deux. Un rêve de jeune fille pour qui le chevalier sur son cheval blanc la séduit sans jamais en venir à bout… Si certains concluent sur un malentendu, d’autres n’ont que ça, le malentendu. L’incertitude de ne s’être jamais rien avoué. Une autre forme de foi.
Bon, assez de mièvres pigeons et de gravitation amoureuse. Si l’histoire est attendue, l’exécution, comme déjà dans Assoiffé, frôle le génie. Guru Dutt semble avoir le don de trouver pour chaque plan le mouvement, la distance, le décor, la composition de lumière et de plan, l’axe idéal pour illustrer toujours au mieux son histoire. Même si en 1959 certains de ces effets semblent un peu datés (on sent l’influence toujours du film noir et des grandes fresques romantiques hollywoodiennes comme A Star is Born) on reconnaît la filiation avec Orson Welles. Le jeu des lumières, le choix des lentilles, les postures, les compositions en contre-plongée, le goût pour le mélange des genres, et même une capacité à mêler réalisme et théâtralité (la théâtralité forcément à travers les parties chantées, le jeu, et le réalisme à travers la psychologie des personnages ou le contexte social car malgré les grands écarts que réserve le destin à son héros, Dutt raconte bien une histoire contemporaine, faite à la fois de strass et de crasse). Du grand art donc.
Et bien sûr… Waheeda Rehman est belle à finir figé dans sa propre béatitude. Pas de parade possible avec une telle déesse. Reste à mourir dignement en évitant d’être cueilli la bouche ouverte. La toile se mue et on se fige : feignons l’indifférence.
Cui-cui-cui.
Fleurs de papier, Guru Dutt 1959 | Ajanta Pictures, Guru Dutt Films Pvt. Ltd
Listes sur IMDb :
✓
✓
✓












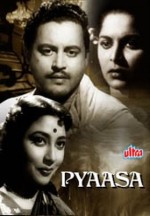







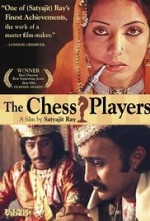 Année : 1977
Année : 1977