Thème-Anathème-Synthème

La Fièvre dans le sang

Titre original : Splendor in the Grass
Année : 1961
Réalisation : Elia Kazan
Avec : Natalie Wood, Warren Beatty, Pat Hingle
THÈME
Début du film bien construit, mais lent à s’installer. L’ennui arrive vite : j’ai attendu l’annonce du problème un petit moment avant de comprendre que je l’avais sans doute ratée quelque part entre la troisième et la trente-deuxième minute de film. D’habitude, ces errances rêveuses se manifestent plutôt à la lecture d’un roman. Plus facile de revenir trois pages en amont que de rembobiner un magnétoscope qu’on a oublié de lancer. Ça m’apprendra.
Kazan donc bien mes fesses dans un siège de prétention, je m’applique à me rattacher à ce que je peux comprendre. Pour le reste, je fais confiance à l’imagination. C’est comme rater les premières minutes d’un film. Et alors ? L’expérience n’en est pas moins intéressante. On se laisse juste suggérer deux ou trois choses que le cinéaste n’avait pas prévues. Si une grande part de l’art de raconter une histoire est de jouer avec les sous-entendus, les non-dits, les ellipses, pourquoi ne pas expérimenter l’art de la recevoir en se bouchant les oreilles ou en tournant le dos au film ? Et en ratant les premières minutes d’introduction, qui, il faut bien le dire, sont souvent pénibles à suivre, je jouis d’une liberté d’interprétation qu’aucun spectateur attentif ne pourra se vanter d’avoir (na !). « N’explique pas ! » me disait mon professeur de diction. Je n’explique pas…, j’imagine.
Bref, sans bien comprendre les enjeux de départ et finalement le réel sujet du film, je peux toutefois affirmer qu’il y a là un léger déséquilibre, un manque d’unité, qui semble plus lié, j’en suis certain, au manque de clarté du scénario qu’à la mise en scène. C’est bien grâce à cette dernière que les personnages finissent par m’émouvoir. Qu’est-ce qu’il en aurait été si j’avais dû m’absenter durant ce deuxième acte où insensiblement les enjeux du film commençaient à se faire jour dans mon esprit évaporé ? Le manque de considération de certains scénaristes à l’égard d’esprits frivoles comme le mien m’étonnera toujours…
ANATHÈME
Le film commence réellement pour moi au moment de la rupture. Une rupture, c’est toujours un nouveau départ, le moteur d’une action, un coup de volant pour réajuster la direction du film ; inutile d’avoir assisté à ce qui précède parce que tous les enjeux passés s’évaporent à la lumière de cet « accident ». T’as raté ta rupture ; t’as raté ta vie. Je le rappelle comme une évidence, mais comme il y a des petits malins qui font exprès d’oublier l’heure de leur enterrement, d’autres s’arrangent pour ne pas être là lors de leurs ruptures…
L’intérêt d’une rupture, c’est qu’elle produit sur le spectateur une explosion rêveuse lui permettant d’imaginer toutes les possibilités à venir. Mais gardons-nous de nous projeter trop loin. Certaines déflagrations spéculatives m’ont parfois éjecté du film en me laissant orphelin dans un rêve verrouillé de l’intérieur. La suite qui importe ici, c’est la folie de Deannie. Deux éléments attendent leur résolution : la question de sa guérison et celle de cette séparation.

SYNTHÈME
Comme dans tous les bons films, la fin se conclut sur un tableau incertain. Surprendre avec ce qu’attend le spectateur : une fin répond à l’exposition de cette résolution attendue, mais d’autres questions doivent apparaître. « Que vont-ils devenir ? » Sans oublier que si rupture il y a, il est probable qu’elle soit suivie d’une rencontre, d’un affrontement final (on voit ça très bien dans la série des Rocky). Tous les dénouements procèdent de cette façon. Le récit articule une action autour d’événements formant une unité dialectique. Début, milieu et fin. Si une histoire donne au moment où on la suit une impression de réalité, le sens de toute cette structure doit se dévoiler dans son dernier acte. Dénouement, morale, catastrophe… que de termes savants pour s’appliquer à une seule chose : remettre en avant le sens d’une histoire plutôt qu’un gloubi-boulga d’événements sans but (autrement appelés « vie », que certains individus, se faisant appeler « amis », ont souvent la bonne idée de nous raconter). Mieux vaut commencer un film par une sieste pour s’assurer de ne pas rater la fin. Quoi que puisse avoir été le problème annoncé au début du film, il est rare que le dénouement vienne répondre exactement à la question posée. Depuis les possibilités évasives (et franchement sibyllines) du début, on ne cesse de se resserrer vers l’évidence d’une chute. La morale est souvent triviale, équivoque, parce qu’une histoire ne fait que transmettre depuis la nuit des temps des leçons accessibles pour tous. Si la fin ne sonne pas comme une évidence molle (et comme une compréhension soudaine qui s’étiole dans les graves : « Ah, heu… »), elle nous perd en explications lourdes et complexes. Ici, on pense donc : « il faut affronter les problèmes en face pour continuer à vivre ». Idée facile à comprendre (le « ah ! oui ! »), suivie immédiatement d’une seconde interrogation qui conteste la morale présentée (le « heu »). Leçon > réaction. Cette réflexion vague qui suit le dénouement de tous les grands films, c’est le silence qui suit une musique de Mozart « et qui est encore du Mozart ». Si c’est cette musique des anges qu’il convient de ne pas manquer, alors peu importe si certains ont un autre son de cloche durant le film.
En guise de catastrophe tragique, laissez-moi dire qu’à partir d’une morale évasive, l’imagination peut alors voir voler mille aphorismes à anses flexibles. Je vais me limiter à deux pour ne pas prémâcher vos propres errances aphorisantes : « Qu’importe le transport, pourvu qu’on ait la destination. » Et : « On n’explique pas une histoire, on en fait l’expérience. »
Merci de m’avoir lu. Retour à mon gloubi-boulga de vie.


La Fièvre dans le sang (1961) | Newtown Productions, NBI Productions









 Année :
Année : 
 Année : 1953
Année : 1953




















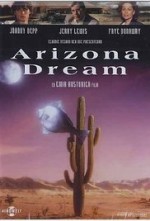
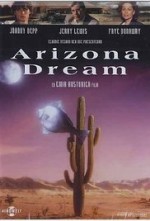 Année : 1993
Année : 1993







