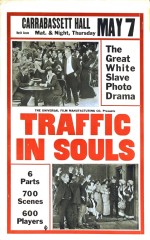Au même titre que Yoshida, Shinoda est un formidable plasticien de la lumière. Il crée des ambiances comme personne, il mène d’un bout à l’autre une idée de mise en scène et s’y tient jusqu’au bout jusqu’à l’obsession. Mais là où Yoshida est souvent chiant à mourir, obscur dans le mauvais sens du terme, avec une beauté froide, désincarnée, comme une gueule de bois antonionesque au petit matin, Shinoda n’a aucune autre ambition (en tout cas dans celui-ci) que de proposer une chorégraphie des images. Yoshida est dans la géométrie froide, Shinoda est dans la transparence, l’évocation, la chaleur, et la densité des espaces : son noir et blanc scintille dans la nuit, il ne laisse entrevoir que l’apparence des choses, pour se concentrer sur les visages de ses deux acteurs principaux. Yoshida pouvait être glaçant comme Kubrick, à vouloir tout montrer sous la lumière, mais on se lassait vite de cette froideur. Alors que Shinoda crée ici une ambiance chaude et onirique qui fascine jusqu’au bout.
L’histoire est réduite au minimum, et même quand de nouveaux éléments apparaissent, ils glissent sur Muraki comme la pluie sur un imper. Parce qu’il se fout de tout depuis sa sortie de prison, résigné, blasé, seul. Ou presque. Parce que s’il n’a plus grand intérêt pour le monde dans lequel il gravite, il est fasciné par cette fleur pâle au milieu des parieurs. Pas la peine d’expliquer la relation, c’est un classique. L’attirance des opposés. Ça permet l’économie de dialogues. Parce que si Yoshida adore blablater, Shinoda se contente de monter son film autour des jeux de regards. L’art de la suggestion et du non-dit. On peut fantasmer. Qui est-elle ? que fait-elle ici ?… Y répondre ? Aucun intérêt. Elle est là, et si elle est là, c’est qu’elle aime le jeu, point.
Muraki, c’est donc le Samouraï de Melville, version noire. Ryô Ikebe en loup solitaire assure. La même classe de Delon, la même autorité désinvolte, le même charisme tranquille et désabusé. L’inspiration du film noir est évidente, et le film assure même une sorte de transition avec la série des Parrains. Coppola avait le même goût pour la chorégraphie des images, la mise en place des ambiances, le récit distendu. Pas pour rien d’ailleurs que Shinoda utilise à la fois ralenti et musique d’opéra. Parce qu’on est dans l’opéra, dans le lyrisme. Mais un lyrisme lourd, mystique, comme la musique de Bach chez Pasolini. À quoi bon parler, quand l’histoire, on la connaît déjà, et qu’on a la musique, quelle qu’elle soit, celle des images ou celle d’un compositeur qui saura rester à la surface des choses, sans chercher à les brusquer, comme le font trop souvent les dialogues.
Si on aime Melville, James Gray, Wong Kar Wai, on ne peut qu’aimer celui-ci.

Fleur pâle, Masahiro Shinoda 1964 Pale Flower / Kawaita hana | Bungei Production Ninjin Club, Shochiku
Comme chez Zurlini, par exemple, dans ce polar presque muet de Shinoda, et plus que chez un Melville sans doute, le travail sur le dialogue des regards est essentiel, sinon le véritable cœur narratif du film. Si certains films manquent de mise en situation des dialogues, interdisant aux acteurs d’offrir à la caméra une forme de sous-texte nécessaire à la mise en perspective du personnage qu’ils représentent, ce film-ci joue au contraire principalement sur la mise en évidence d’un tel sous-texte, rendant presque superflus les énoncés brefs et toujours trop verbeux sortant de leur bouche. Quand ce travail est réussi, les dialogues ne sont plus une discussion entre les personnages entre eux, mais entre une forme de texte explicité et une autre implicite dévoilée par les regards.
Loin de penser, comme beaucoup, que le champ-contrechamp est une forme de montage facile et sans substance, je pense qu’on trouve au contraire dans cette technique l’essence même du pouvoir de fascination du cinéma. Il peut servir de base à beaucoup d’autres formes de techniques (à commencer par le montage des attractions ou de l’effet Koulechov, même involontaire), et dans sa forme la plus élémentaire, un champ-contrechamp opposant deux visages qui se répondent, cela reste une des techniques, quand elle est bien employée, qui peut être pour le spectateur une source puissante d’attention, et pour le réalisateur, un formidable terrain où exprimer sa créativité.
Pour illustrer cette idée, quelques exemples tirés du film avec ce qui se retrouve avec insistance au fil du récit : des parties de cartes dans lesquels on parle peu et se toise beaucoup, des séquences à deux où ce jeu de dialogue entre les plans (plus qu’entre personnages) se met en place et où texte et sous-texte se mêlent savamment l’un à l’autre pour produire tension et mystère dans l’esprit du spectateur (que ce soit au comptoir d’un bar ou couchés dans un lit).
Exemple 1, expressivité du champ-contrechamp :

On remarque d’abord ici l’intérêt de l’emploi d’un objectif à longue focale. Si les courtes focales permettent un « regard » presque objectif et une mise à distance avec le sujet, les longues focales obligent le regard du spectateur à littéralement se focaliser sur un objet, un personnage ou un espace dans le champ. C’est une marque d’attention. Ici, on remarque par exemple que cette focalisation est accentuée par les mouvements des personnages annexes dans le champ, voire hors champ (aperçu dans des plans précédents et dont on peut se représenter mentalement la place et les activités une fois la caméra focalisée sur des éléments plus particuliers), tandis que le sujet au centre de l’attention (au centre de l’écran ou sur lequel la caméra fait le point, parfois même sans être dans l’axe de la caméra) reste statique. D’un point de vue narratif, ce n’est pas neutre, cela permet d’amorcer le « dialogue » futur avec l’autre sujet d’attention de la scène, mais aussi de faire mine d’entrer dans la « pensée » du personnage ainsi exposé. C’est facile à comprendre, un personnage qui s’agite… agit. Il est dans l’action plus que dans la réflexion. Tandis qu’un autre qui bouge peu semblera tout de suite plus réfléchi, voire pensif. Le regard des autres personnages, là encore, permet d’accentuer, si c’était encore nécessaire, la focalisation sur le sujet principal : ils ne s’agitent pas seulement à leurs affaires (ici, poser des mises sur la table de jeu), ils tournent parfois leurs regards sur le premier sujet (la joueuse, à gauche, Mariko Kaga).


Vient le champ-contrechamp avec l’introduction du second sujet qu’on reconnaît grâce aux mêmes principes de focalisation. Si le sujet (ou personnage) est tout aussi statique que le premier, et si on peut, d’une certaine manière, dire qu’il est également plongé dans ses pensées, il se distingue du premier sujet par le fait que lui le (la, en l’occurrence) regarde. C’est là qu’on retrouve ce que Zurlini sait parfaitement faire : montrer les personnages en regarder d’autres (Cf. Été violent par exemple). Pas besoin de dialogues, ce qu’on imagine a toujours plus de valeur que ce qu’on pourrait entendre. On a donc ici, un second personnage (Ryô Ikebe), que la caméra met en évidence dans un coin de l’écran (ce qui est presque une invitation, à travers le montage, à une forme de champ-contrechamp plus conventionnel dans lequel on attribue à chacun des personnages une partie de l’écran pour suggérer la présence de l’autre, hors-champ), et qui apparaît net derrière un premier plan flou (la force, toujours, de la focalisation des longues focales). Un personnage en regarde un autre avec insistance alors que la situation reste banale (on joue dans une salle de paris). L’attention se concentre alors sur cette relation, et on peut alors imaginer le type d’interactions que ces personnages pourront alors avoir : plus on attend, plus on suggère les possibilités d’un lien (caché ou non, mais certainement à venir) entre les deux sujets, et plus on a de temps pour l’imaginer et s’énumérer toutes les hypothèses possibles. Du même coup, le premier « champ », ou plan, devient une vue subjective du plan qui suit, ou contrechamp, renforçant une idée de subjectivité qui ne fera que s’accentuer par la suite. « Montrer un personnage en regarder un autre, puis montrer ce qu’il regarde », vous n’avez pas besoin d’autre chose pour faire du cinéma.
Le principe, ensuite, lors de séquences montées en champ-contrechamp, c’est bien souvent que les personnages papotent et se regardent au bon vouloir des sensations des acteurs. Or, quand on ne dit rien à des acteurs, ceux-ci auront toujours la tentation de gesticuler, de regarder leur partenaire, regarder ailleurs, puis jeter un regard à ce même partenaire… Une soupe de gesticulations voulue pour être naturaliste, qui peut bien recréer une vague sensation de réel, mais qui détourne l’attention du spectateur, noie la compréhension de la situation derrière mille gesticulations inutiles, et empêche surtout à ce même spectateur d’imaginer lui-même ce que pensent, désirent ou cachent les personnages.
Rien de tout ça ici. Au contraire. Puisque la volonté de Shinoda semble bien être de ne rien faire au hasard et de limiter les postures, les gestes, parfois même les échanges de dialogues : quand on regarde, on regarde longuement, que ce soit mutuellement ou non, et quand on regarde ailleurs, c’est souvent pour avoir un regard fixe mais non pas inexpressif. Le non pas inexpressif ici est tout relatif, la difficulté étant précisément de réclamer à des acteurs d’en offrir le minimum pour ne pas trop en dire au spectateur et lui couper toute envie de tenter de percer leurs pensées. Quand je lis bien souvent qu’il y aurait les acteurs expressifs et les autres (sous-entendu les mauvais) qui sont inexpressifs, j’ai peur, là encore, d’aller contre l’avis général : un acteur impassible, qui en montre le moins, c’est bien souvent une expression qu’il appartient au spectateur de définir ou d’imaginer. J’en reviens à l’effet Koulechov, qui n’est au fond rien d’autre qu’une forme d’expression, à travers le montage, du sous-texte, et un procédé purement suggestif. Autrement dit, aucun acteur n’apparaîtra comme « inexpressif » s’il est opposé à un autre (qu’il soit ou non tout aussi impassible), si le montage est pensé pour le rendre expressif, ou même s’il est plongé dans une situation correctement définie : c’est le spectateur qui, toujours, donnera une expression à ce personnage, si tant est que ce « plan », que son visage « vide » (un peu comme il y a un espace vide cher à Peter Brook) puisse répondre à une situation prédéfinie. C’est le propre du montage qui est donc de faire parler les images entre elles, et de proposer un récit jaillissant de ces oppositions, de ces rencontres, entre divers plans.
Exemple 2, possibilités du champ-contrechamp :

Inutile même parfois de « couper » pour proposer ce genre de dialogue entre les images (souvent des personnages). On peut même offrir au regard du spectateur des exemples de champ-contrechamp… sans montage, sinon dans un montage à l’intérieur même du plan. Avec un résultat identique : un personnage au regard fixe, lui-même regardé par un personnage. Ici, dans un bar, le serveur au comptoir permet, au premier plan flou, de symboliser cette « coupure ».
Shinoda montre également les mille manières de cadrer un champ-contrechamp… Ce qui est barbant dans un tel procédé, c’est de revenir à un plan précédent, quand un plan B répond à un plan A, puis qu’au plan B répond le même plan A… Alors que les possibilités ne sont peut-être pas infinies, mais dans le cadre d’un champ-contrechamp, il est toujours possible de varier et de faire travailler sa créativité.



On peut même intégrer à son montage, en guise de ponctuation, le plan d’un observateur tapi dans l’ombre : montrer celui qui regarde sans que lui-même ne soit vu… Un classique du cinéma pour assaisonner son film… Le même principe, encore et toujours : rien n’est plus expressif qu’un personnage montré en train d’en regarder un autre… Regarder, rien de plus : il regarde, il ne fait pas autre chose, et la force évocatrice d’un tel plan vaut mille exemples (réussis) de collage Koulechov. Vous voulez des réponses à vos interrogations ? Comprendre le pourquoi du comment ? Trouver les acteurs expressifs ? Eh bien, regardez de mauvais films. Pour les autres, tapissez-vous dans l’ombre, faites coulisser les shoji, et abreuvez-vous des champs-contrechamps de Shinoda.

Un autre exemple proposé ici par Shinoda : dans le même plan, toujours, un personnage au regard fixe, et un autre, ici flou et au second plan, qui regarde le premier. Non pas un champ-contrechamp, mais le principe dans un même cadre reste le même. On fait dialoguer entre eux les personnages à travers un sous-texte, à travers des postures, à travers des regards. (Et bien sûr, ce ne sont pas ici des captures furtives : Shinoda joue sur la lenteur, le vide, l’absence d’action ou de mouvement, pour insister sur ces oppositions auxquelles il appartient au spectateur de donner un sens).
Exemple 3, « visage vide » :

Retour à la salle de jeu. Un plan moyen avec le personnage principal bien au centre avec des personnages annexes qui s’agitent et qui jettent des regards au personnage central pour renforcer encore et encore son poids à l’écran.

Puis, raccord, plan rapproché. Longue focale pour réduire la profondeur de champ et donc se « focaliser » sur le sujet. Le visage est net, le regard… flou. Qu’on le veuille ou non, en deux plans, on comprend la situation sans qu’aucun mot ne soit prononcé.

Le contrechamp intervient. Presque brutal. Comme pour accentuer la tension de la situation : plan rapproché, mais cette fois de face sans autre sujet annexe. Et le personnage principal regarde avec intérêt l’autre personnage principal perdu dans ses pensées, dans ses hésitations. Au spectateur d’y coller ailleurs l’expression souhaitée : est-ce qu’il s’inquiète de voir sa comparse hésiter et troublée, est-ce que son regard a quelque chose d’ironique ou de provocateur ?…

Contrechamp attendu. On revient au plan précédent, mais avec un fait marquant : elle le regarde en retour. Lui demande-t-elle de l’aide ? Répond-elle à son intérêt ? Répond-elle à son regard provocateur ? On n’en sait rien, et c’est sans doute pour ça qu’on regarde presque ces plans comme des images fixes en espérant qu’elles viennent tout à coup à nous révéler quelque chose de plus… expressif. Des « visages vides » qui se répondent, s’interrogent, se font « face », et tout est dit de l’incommunicabilité entre deux êtres, deux joueurs, qui se sont trouvés on ne sait pourquoi, face aux autres joueurs, face au monde, face à eux-mêmes.
Exemple 4, texte et sous-texte :



On est dans un lit comme on pourrait être dans un bar ou dans la rue : l’incommunicabilité jusque sous la couette. Des regards fixes en plongée, puis des champs-contrechamps d’abord muets. Avant de passer à l’acte. Autrement dit ici, avant la parole (qui dans ce cas encore sera un bel exemple de « texte » répondant à un « sous-texte », l’un n’illustrant pas bêtement l’autre, mais le contredisant parfois, lui servant de contrepoint, au moins).
Exemple 5, champ-contrechamp sans coupage comme il y a des montages sans coupage :

Shinoda arrive même à faire parler les nuques. C’est assez commun dans le cinéma japonais (Mizoguchi adore le faire aussi par exemple). On a donc ici l’écran séparé en deux, avec un dialogue symbolique entre les deux personnages, entre deux formes, deux nuques allant de pair comme des as. Ils regardent vers la même direction (sans qu’on les voie d’abord regarder ce qu’ils voient ou voient venir…). C’est peut-être encore la dernière communion possible dans un monde où on est condamnés à être seuls. Jeu, encore une fois, sur la profondeur de champ (les nuques parlent mal avec des courtes focales).

Et nul besoin de jouer des ciseaux pour offrir au regard un montage narratif : le personnage de droite quitte le champ, le second le suit du regard, ce qui nous permet de mettre un visage (vide) sur cette nuque. Rat des villes, rat des (hors) champs…
Exemple 6, incompréhension et situation en suspens (dernière séquence) :

On retrouve le principe du personnage qui en regarde un autre sans que celui-ci se sache regardé. Shinoda s’amuse même ici en dévoilant dans son jeu une paire de relations croisée « vu sans être vu ». Premier plan, l’homme arrive et regarde fixement quelque chose ou quelqu’un après avoir cherché dans la salle. On ne sait pas encore qui. (Montrez quelqu’un regarder quelque chose avec insistance, même sans qu’on sache quoi, et le spectateur se surprendra toujours à trouver un intérêt à cette situation.)

Deuxième plan, un contrechamp. Ce qu’on pense être du moins un contrechamp. En réalité, la femme regarde bel et bien l’homme du plan précédent, mais l’homme ne la regarde pas, et on ne l’a pas forcément encore compris. Son regard est même presque un regard caméra (nous mettant presque dans la peau de l’homme…) : chez les joueurs, pour mettre fin à une partie, on propose parfois une dernière mise « pour voir ». Dernière séquence, dernière mise. On se dévoile.

Nouveau contrechamp. La position de l’homme n’a pas évolué : il regarde toujours (ce qu’on pourrait penser encore à ce moment-là être la femme) fixement quelqu’un, mais cette fois, c’est la caméra qui a changé de position : l’échelle de plan est légèrement plus rapprochée et l’espace à droite a étrangement laissé place à un autre à gauche sans que cela n’offre au spectateur un quelconque indice sur la nature de la situation qui est en train de se mettre en place (si on est un peu joueur, on a déjà tout compris de ce qui allait se jouer).

On change d’angle de vue. Cette fois, on comprend assurément que ce n’est pas la femme qu’il regarde (et donc que la femme le regarde sans être vue), et que lui-même regarde quelqu’un sans (manifestement) être vu. (Puissance de l’observateur, toujours. Suspense, car on attend que la situation se dévoile plus clairement sous nos yeux.)

Le plan suivant montre un balayage de la salle, puis un raccord dans l’axe permet de se focaliser sur le personnage ainsi « ciblé » par notre personnage principal. On comprend alors mieux la situation : un homme et sa proie.

Contrechamp classique. On revient exactement au plan de face précédent (sans d’ailleurs qu’on puisse y remarquer un quelconque changement, preuve que ce qui joue ici, c’est bien plus les ciseaux du monteur que « l’expression » de l’acteur). Mais cela a beau être strictement le même plan (jusqu’à être pourquoi pas la même prise), effet Koulechov oblige, on ne le regarde plus de la même façon que dans le plan précédent (pourtant exactement identique) : on ne voit plus un homme répondant (potentiellement) au regard lancé par la femme, mais bien un homme en regarder un autre, et vu sa tête (qui semblait pourtant jusque-là « inexpressive », « vide »), ce n’est probablement pas pour lui demander l’heure qu’il est.

Shinoda propose alors à nouveau le contrechamp de la femme qui regarde et qui semble comprendre ce qui va se passer (« semble », parce qu’on est encore dans une interprétation fortement suggérée par un effet Koulechov). Sa position est identique, mais le cadrage légèrement différent (plus d’impression de regard caméra), et l’homme, derrière, a disparu.
Je vous laisse deviner la suite, mais à nouveau, le jeu de nuque de la femme, hiératique jusqu’à la fin, sera magistral…
Il y a chez Shinoda d’autres films noirs plus bavards et moins contemplatifs comme One Way Ticket, ou un film un peu hybride comme Shamisen and Motorcycle. Et puis il y a des films plus « exigeants », moins contemporains, comme Double Suicide, Himiko, Orine, Under the Cherry Blossoms, La Guerre des espions, Ansatsu ou Silence.