Les Cahiers de la consanguinité

Travolta et Moi
Année : 1993
Réalisation : Patricia Mazuy
Avec : Leslie Azzoulai, Hélène Eichers, Julien Gerin
Film typique qui marque la fracture intellectuelle imposée depuis plusieurs décennies par un groupe de pseudo-intellectuels français, Travolta et moi est avec son petit frère US Go Home, de la toute aussi insipide Claire Denis, une merde irregardable. Des petits films sur le sujet, aussi mal montés, sans aucune connaissance de la direction d’acteurs, accumulant les clichés sur l’adolescence et les scènes toutes faites, on peut en trouver à foison dans la production de l’ombre de notre pays. Seulement, quand on a les amis qu’il faut, on a la carte, on se fait bien voir, et on finit dans les festivals ou dans les listes des Cahiers ou des Inrocks.
Ce qu’on vante dans ce genre d’escroqueries intellectuelles, c’est la médiocrité (ou la nullité) des éclairages, du jeu des acteurs, la paresse de la mise en scène, les facilités du scénario. Une médiocrité qu’on viendra ensuite badigeonner de références fumeuses, de symboles, et de sens en interview comme si c’était les intentions qui étaient à juger dans un film et non plus le film lui-même. En réalité, s’il y a symbole, c’est celui de films monstrueusement anecdotiques présentés comme des chefs-d’œuvre grâce à leur vide et leur bavardage rohmeriens, très largement méprisé du public (ou au mieux ignoré) alors qu’un petit groupe de critiques continue d’en faire la promotion. S’il y a longtemps que le cinéphile français ne porte plus grand intérêt de l’avis des petits cons des Cahiers (la connerie est une épidémie qui, pour l’occasion, s’est même répandue jusqu’aux Inrocks — l’avantage de la consanguinité sans doute), force est de constater que paradoxalement ce torchon porte encore la voix de la France à l’étranger. C’est que si ces critiques et ces cinéastes (qui sont souvent potes ou de la même famille) forment une sorte d’aristocratie, ils ont en eux une sorte de folklore très parisien qui séduit le petit intellectuel étranger cherchant à s’insérer lui aussi dans la cour des « gens qui en sont ». Apprécier la culture française, c’est d’une telle sophistication, que ça ne peut être pour aimer Audiard ou de Funès, mais ce qu’on peut trouver de plus élevé dans l’échelle de la prétention creuse. Les Cahiers donc, ou apparentés.
Si on pouvait se dire que ce que pensent les étrangers de notre cinéma domestique ça nous préoccupe finalement assez peu, il y a tout de même que ça crée un énorme hiatus entre deux visions, deux cinémas, deux spectateurs. Ce ne serait pas dramatique si cela était à l’origine d’une diversité et si on continuait à produire de grands films quel que soit le parti qu’on revendique. Seulement voilà : nos productions dites commerciales sont trop grossières pour être crédibles, et nos films dits intellos ne sont la plupart du temps que pseudo-intellos. Étant plutôt réceptif à toutes les approches possibles, même tolérant quand il est question de vouloir « faire comme », il faut bien reconnaître la pauvreté de ce cinéma hexagonal, non pas en valeur absolue (car on continue, et c’est encore heureux, à produire de temps en temps des films qui sortent du lot) mais en comparaison de ce que nos cinéastes ont produit depuis l’origine du cinéma. L’enfermement de chacun dans l’une ou l’autre forme n’a fait qu’appauvrir encore plus la production, étant devenu certain, une fois lancée, qu’une production gagnerait à sa cause la foule des cinéphiles déjà convaincus. C’est l’étiquette qui donne la valeur à l’objet, donc sa marque, donc l’auteur, la maison qui le produit, plutôt que l’objet en lui-même.
Le paradoxe, c’est que si ceux qui font du cinéma ouvertement populaire n’allaient jamais se souiller dans les ruelles obscures de l’intellectualisme, et s’ils se contentent très bien de faire de la merde et d’en être récompensés, on retrouve souvent des indices chez leurs collègues de la rive d’en face qu’ils rêveraient aussi un peu de temps en temps, au succès, aux lumières. On commence souvent avec un film fauché, monté grâce à ses relations chéries, mais qui, plus il semblera fauché, sera loué par ces mêmes relations dans la presse ou dans les festivals. Et puis, on se lasse de voir que malgré un premier film très bien accueilli par la presse (ou une certaine presse), on peine à en produire un second, parce que oui, même quand on a la carte et qu’on est un petit-bourgeois, il faut bien vivre, et courir les cocktails ou les festivals où on est jury, ce n’est pas de tout repos. On se dit que finalement, on peut mettre un peu d’eau dans son vin, accepter les impératifs des distributeurs, tendre vers plus de spectacle, parce que finalement, si « eux » peuvent le faire, c’est que ce n’est pas bien compliqué. Le cinéaste pseudo-intello se met donc à faire des films, toujours intello, mais en costume, et avec l’ami d’une amie qui est bien connue du public et qui pourra convaincre les télévisions de parier sur un projet. « Mais on ne perd pas son âme ». On reste dans la prétention, c’est-à-dire qu’on garde le papier cadeau, on joue des apparences comme on l’a toujours fait, mais cette fois avec certains codes de la rive d’en face, et l’intérieur reste creux (hou la, c’est bien trop compliqué, si on fait un film en costume, il faut apprendre aux acteurs à se tenir, à parler ? mais, moi-même, je ne sais rien de tout ça !).
Rien que le titre est évocateur. Travolta, c’est le symbole d’un cinéma pauvre, commercial, pour midinette, et puis bon, finalement…, on fout de la disco tout au long du film, et merde, c’est vrai que c’est bon ! Enfin, on ne le dit pas trop fort… Il aura fallu attendre 70 ans pour que les intellos s’approprient Fantômas (pas celui de de Funès, hein) et les Vampires (des films qui n’avaient à l’époque aucune autre ambition que de divertir), donc on va attendre que Travolta soit totalement oublié pour en faire clairement une icône. Mais là, on frôle… La gamine se fait initier à la « philosophie » par son don juan et brûle son Travolta, belle initiation, mais alors qu’on aurait pu continuer vers cette voie, non, il reste un peu de fascination non avouée pour ce que par ailleurs on dit exécrer. On pourra toujours servir comme prétexte que c’est un film d’ado, seulement on finit par une boom avec une série de hit « ringard » de la fin des années 70, et celui qui se fout en l’air, c’est bien le pseudo-intello, pas la gamine fan de Travolta… On retrouve d’ailleurs toute une série de clichés propres aux films pour ado, qui, quand ils sont présentés dans la Boom avec Sophie Marceau, sont forcément la preuve de la niaiserie de ce cinéma, et qui présentés autrement, avec encore moins de savoir-faire, sont forcément la preuve d’une grande qualité (la recherche de l’effet grossier, face au non-effet…, on les oppose quand en fait on fera mieux de s’interroger sur le sens de ce qu’il montre plutôt que la manière).
À l’arrivée, seule la forme, toujours la forme, change ; et elle ne dit toujours que : « Ma lumière est dégueu, je ne sais pas diriger des acteurs, mes dialogues sont dignes d’Hélène et les garçons ou de Rohmer, et je ne sais rien du découpage technique, donc je fais des plans séquences (que j’alterne avec des plans très rapides parce que je sais épeler Eisenstein ». (Qu’on déchire l’emballage et il ne reste rien.)
Il y a tout de même quelque chose qui me fascine dans ce cinéma. Si le fond est creux et qu’on y regarde que l’emballage, que le savoir-faire est inexistant, on ira donc convaincre de notre génie après-coup. Et c’est là qu’on touche à l’irrationnel. On multiplie les tortillons de l’esprit, les commentaires et les interprétations qui sont habituellement le privilège des spectateurs, et souvent cela est assez pour convaincre. Les bonnes intentions réussissent pas mal quand il est question de faire du populaire assumé, donc pourquoi est-ce que le même procédé ne marcherait pas à l’intention des pauvres pseudo-intellectuels toujours plus sensibles à la forme qu’à un fond qui les échappe et pour cause. Qu’est-ce donc que ce pays soi-disant cartésien qui se vautre aussi facilement dans les pièges des apparences, de l’apparat et l’irrationnel ? Est-on à ce point détaché de la réalité ? Bah, ça m’en a tout l’air (je suis Français, je me fis principalement aux apparences). Le monde est en crise, et on refuse de la voir ; on roule comme des malades sur les routes, on y meurt, et ça nous fait ni chaud ni froid ; nos jeunes fument comme des pompiers, et on continue de trouver ça cool ; on trouve que l’astrologie, c’était plutôt amusant ; on porte un crédit phénoménal à la psychanalyse ; nos hommes politiques ne sont jamais meilleurs que quand ils font du vent et ne bouge eux pas d’un iota ; et donc, on s’émeut devant le génie de films tout à fait médiocres. Ah oui, le déclin de la culture français qu’on dit… Une chute irrémédiable et je n’y vois pas beaucoup de motifs d’espoir. Quand le système marche par copinage, consanguinité, et qu’on a comme ambition que d’entrer dans ce système sans le contester, qu’on en accepte les règles en opposant systématiquement œuvres intellos et œuvres populaires, qu’il est plus important « d’en être » que d’être productif et d’apporter du sens, eh bien non en effet, il n’y a aucun espoir à avoir. Qu’on crève dans notre médiocrité et nos certitudes. Et que les Cahiers continuent d’éclairer le monde sur la grandeur de l’esprit français. Travolta et moi… je te le fais pas dire.
Allez, tiens, puisque cette critique ne vaut pas grand-chose, qu’elle est vite chiée sans lumière artificielle et sans répétitions, je vais la laisser sans même la relire, pleine de fautes, d’incohérence et de grosses bêtises ; parce que j’aurais l’excuse toute trouvée : c’était le cœur qui parle. Oui, ma critique est belle et de qualité parce qu’elle est honnête. Parce qu’elle est longue, elle doit donc être construite et réfléchie. Parce qu’elle est véhémente, on devra l’applaudir, pour sa liberté de ton, son audace. Son franc-parler ! Mais merde quoi ! Écoutez donc cet art du point-virgule et de la digression ! Cet éloge de la bêtise sophistiquée face à la toute-puissante bêtise crasse ! Voyez comme je crie ! Qu’on s’indigne donc avec moi ! Tout cela n’est-il pas l’évidence même ? Ou si on vient — même si c’est peu probable vu qui me lit, qui me lit jusqu’au bout, ou qui regarde ce genre de films — me vilipender pour avoir massacré un tel chef-d’œuvre sans rien y connaître sur la phase d’adolescence, très bien décrite dans le film, nommée par la psychanalyse « phase d’identification du Lui », autrement dit cette perversité infantile qu’ont les adolescents à structurer leur Moi à travers la représentation idéalisée d’une idole qui ne peut plus être le parent, objet du désir précédent la phase de latence sexuelle, mais au sortir de l’enfance, un « autre », une image lointaine, reflet de nos passions perverses et résultat du réveil impulsif et brutal de la sexualité d’adulte, eh bien oui, foi d’incrédule, ces critiques pourraient être justifiées, parce que je n’y entends rien, et ne veux rien y entendre ; mais je ne suis pas de la secte des idolâtres de Freud, comme je ne suis pas partisan des rédacteurs de phrases simples et correctes ! Si nos cinéastes sont médiocres, si le SAV est assuré par des tortillons informes de grandes prétentions et de phrases creuses, je veux me mêler à leur volute pour les dissiper, m’agiter, gesticuler, avec ce même non-sens pseudo-organisé, cette même nullité, cette même profondeur lourde. Crions donc « hourra ! » Pourquoi ? Parce que je crie !… Mais criez, impies ! Incultes ! Pourquoi ne criez-vous pas ? Je ne crie pas assez fort ? Je ne dis pas assez de conneries ?… Quoi ? Ah…, j’oubliais. Je n’ai pas la « carte ». Je m’en fais donc courir les cocktails, user de ma sympathie et de ma repartie coutumières, échanger des numéros de téléphone, me coucher à l’horizontal avec n’importe quel cul qu’importe qu’il soit haut placé. Et je montrai ainsi les escaliers de la légitimité. Alors, une fois en odeur de sainteté avec le Tout-Paris, mais surtout avec les bonnes personnes pour m’assurer un travail et des louanges, je reviendrai dans cinq ans, après un chef-d’œuvre et une merde en costume que personne n’aura apprécié mais que tout le monde aura vu. Les Cahiers ou pas, il faudra m’écouter et donner du crédit à toutes mes conneries. Pourquoi ? Parce que j’ai la carte. Et que si on la veut aussi, il vaut mieux ne pas me contrarier.
Ou pas. Être courtisan, c’est une vocation. Qu’on juge donc ma prose pour ce qu’elle est. Des niaiseries qui ont la lèpre. Mais faut pas avoir honte. Sourire de sa médiocrité. Parce que je n’irai pas prétendre aux Petits Papiers de la Presse ou du Populo. Ça me semble au moins, et à la fois, légitimer et discréditer ces litres de vomis déversés, non seulement sur ce film, mais sur tout ce qui y ressemble. Et en premier lieu, comme je l’ai déjà fait, sur son petit frère, US Go Home. Il paraît que la consanguinité rend fou, je confirme. Je m’égosille peut-être seul dans le désert, mais ceux-là aussi. Je peux donc bien crever le premier, je sais que tous les autres suivront. Dans le désert, les illusions ne durent qu’un temps. Et c’est la médiocrité qui nous achève. Mesdames, salut.



























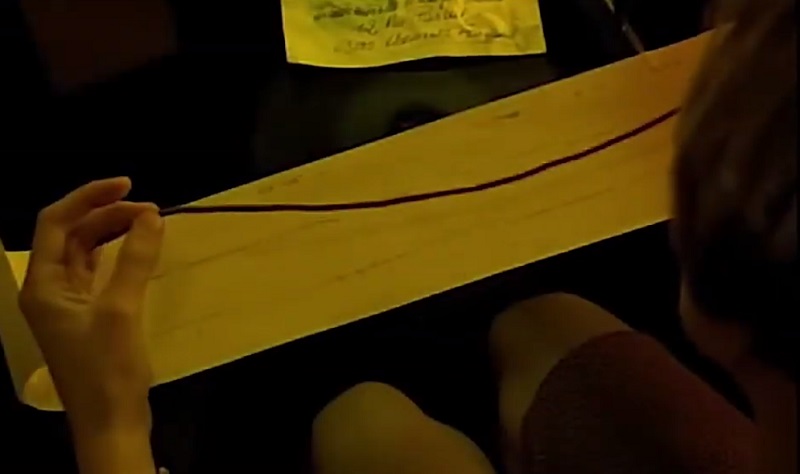








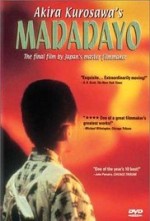







 Année : 1990
Année : 1990




