
Interstellar
Année : 2014
Réalisation : Christopher Nolan
Avec : Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Matt Damon, Michael Caine, Casey Affleck
Diverses notes sur Interstellar, plus généralement sur la perception du cinéma de Christopher Nolan, suite à l’excellente critique de blig :
Sémantique des images et paréidolie du spectateur dans le cinéma de Christopher Nolan
Trop dur à te suivre, mais merveilleusement bien écrit. Tu me donnes en tout cas quelques pistes pour mieux appréhender ce monolithe étrange qu’est Nolan… S’il faut y voir des références et/ou du symbolisme, je suis totalement hermétique à ces procédés. D’abord, parce que ce serait du chantage exercé sur le spectateur : si tu n’aimes pas mon film, c’est que tu ne l’as pas compris… au fond. Ensuite, parce qu’une histoire ce n’est pas un assemblage (une collection presque) de références plus ou moins poussives. Une histoire doit tenir la route par elle seule, autrement, tu ne fais que prouver ta totale dépendance envers les références que tu jettes dans ton film et que seuls les plus avisés pourront comprendre. Quand tu dis « dans 2001, le nihilisme passif dénoncé par Nietzsche était celui de la soumission de l’Homme à la machine et de son aliénation consécutive à la technique », j’aurais envie de transposer ça aux références et à Nolan : le cinéaste « philosophe » ne s’aliène-t-il pas une partie de son public en soumettant ainsi son récit un peu trop à des références ? Tu enlèves toutes ces prétentions, et il ne reste rien, sinon un joli catalogue d’images et d’émotions.
D’ailleurs, pour ma part, parce que je suis sensible à ces images plus qu’à ces références, à aucun moment je n’ai pensé à 2001. À Armageddon oui, à Apollo 13, à La Guerre des étoiles (« je vais arriver à foutre mon asticot dans cette saloperie de trou ?… »).
Les idées, il les pompe ailleurs et ça doit encore masquer son incompétence. Ou mon inculture philosophique. Le pire c’est aussi un peu ça : le fait d’arriver à planter dans ses films, et en particulier ici, tous les passages obligés des grosses machines hollywoodiennes. Un cinéma d’effets et de l’esbroufe. Tu as tes passages obligés (de bravoure, de fraternité, de révélations, de confessions, etc.), et tu dois les réunir d’une manière ou d’une autre. Et parfois, tu repères de telles failles dans le récit que tu es obligé d’y revenir pour expliquer la scène (ce qui, à mon avis, ne fait que souligner la faille en question) en profitant pour en faire un nouvel instant de bravoure (notamment quand il est question de revenir sur la « poignée de main avec les autres-nous »). C’est amusant en fait, quand on fourre son histoire avec plein de références, c’est comme dans les nuages, on finit chacun dans son coin par y trouver une logique différente. S’il y a plusieurs logiques, c’est donc que par paréidolie, il n’y en a aucune. Voir des formes ou des idées là où il n’y a rien, c’est aussi ça, le principe de l’art. Seulement, Nolan utilise des ficelles tellement vulgaires, il s’amuse tellement à multiplier les nuages dans le ciel pour espérer y voir former des images évocatrices, que ça me fascine de voir à quel point il arrive autant à embobiner son monde. Quel artiste… !
J’ai déjà expérimenté le retournement de cerveau au second visionnage (ça marche avec les filles qui réclament un second rendez-vous comme avec les films). Il y a plusieurs explications possibles, et l’expérience est fascinante. D’abord, si on accepte de revoir un film (même si ça peut être fortuit et dépendant de notre volonté), c’est qu’on n’était pas bien convaincu par un premier visionnage ; on se dit alors « merde, c’est quand même joli et bien burné », j’aurais intérêt à revoir mon jugement. Ensuite, probable qu’au second visionnage (encore plus pour les suivants), connaissant déjà les défauts et l’intrigue, on se focalise sur autre chose, sans doute de plus accessoire (les filles qui réclament un second rendez-vous s’arment souvent de ce genre d’outils pour impressionner). Et là où il faut reconnaître du génie à Nolan (cette fois, ce ne sera pas forcément un compliment de ma part), c’est bien dans sa capacité à se focaliser sur l’accessoire. Dans Memento, il y avait une idée, un exercice de style au départ, qui conditionnait tout le reste, et il n’avait pas besoin de s’appliquer sur l’intrigue (je mets au défi qui que ce soit d’être capable de recomposer la logique d’une intrigue servie à l’envers), et c’est bien la seule fois, ou pour moi, Nolan réussissait son coup. Quand on propose un exercice de style et qu’on fait la croix sur tout le reste, c’est l’accessoire qui devient la raison d’être d’un film. Tout le reste est noyé dans un grand feu d’artifice qui impressionne, mais tout cela est surtout là pour masquer le manque de cohérence de ce que d’autres préféreront éclairer et servir parce qu’ils comprennent où est l’essentiel d’une histoire. À la recherche de nouveaux indices et de nouvelles explications ou références, on finit par se faire son propre film (ce qui est de toute façon toujours le cas). Même si Nolan est fort en jeu de piste, il n’en reste pas moins que là n’est pas l’essentiel.


L’intelligence de Nolan (là encore, pour moi, ce n’est pas un compliment), il devrait être capable de la mettre en avant (en la laissant paradoxalement en retrait) dès le premier visionnage. Il a de la chance, chaque spectateur vit le cinéma comme une expérience unique, et il semblerait qu’avec les films qu’il propose, le public aime s’y sentir intelligent (si ça ne se fait pas au premier visionnage, ce sera donc au suivant parce que, libérés des contraintes dramatiques, on s’agitera comme deux neurones dans notre cerveau à essayer de trouver des rapports entre elles, preuve d’une interaction intelligente, d’une intrication entre les choses qui fait sens, d’une « intriguation » réussie).
En multipliant les références plus ou moins cachées, il est facile de comprendre que notre œil s’éclaire à mesure qu’on parvient à en reconstituer un puzzle que Nolan prétend nous livrer en pièce détachée. Nolan nous laisse alors faire le travail, et comme on a le cerveau plutôt malléable, on ne s’embarrassera pas, s’il le faut, à forcer les pièces pour qu’elles s’emboîtent entre elles. En livrant au public différentes idées, en suggérant mille et une images ou points lumineux dans le ciel, par analogie, le public finira toujours par y déceler des combinaisons parlantes qu’il s’efforcera d’attribuer à un « auteur » autre que lui-même. Nous sommes ainsi faits. Ce n’est plus Nolan l’intelligent, mais nous, et c’est peut-être ça qui nous plaît tant dans ses films.
Je pense alors qu’on ne juge plus le film en lui-même, mais l’expérience qu’il nous procure. Un peu comme le principe des faux souvenirs, ou des souvenirs altérés à force de révisions, et comme des pas répétés sur la plage, sans cesse nettoyés par le passage des vagues. La mémoire (et donc la perception de ce qu’on a vu) évolue malgré nous. On y ajoute des détails, on en oublie d’autres, on théorise sur ce qui s’est passé ; et les “revisionnages” de ces souvenirs seront alors conditionnés par ce qu’on en a compris. Il faut que ça colle. On oublie ce qui fâche (ou le contraire) pour en forger un bloc cohérent quand la vie souvent ne l’est pas, et ça rejoint l’expérience du film revu où tout à coup l’intrigue passe au second plan. Il n’y a plus à juger un film (ce qui a toujours été très relatif), mais l’expérience qu’on en tire. Chaque révision altère non pas le film tel que Nolan l’a pensé (parce que lui, au contraire d’un souvenir, est, en principe, immuable), mais l’idée qu’on s’en fait. Et plus que le film lui-même, c’est bien cette idée qui importe.
La révision peut parfois étonner. Fight Club a pour moi changé de nature au second visionnage. J’avais trouvé l’histoire idiote (elle l’est sans doute toujours autant), et je m’étais dit « merde, c’est Fincher, revois le film ». Et je me suis pris à mon propre piège. Une jolie fille, même si au premier rendez-vous, elle se montre idiote, tu te dis que tu peux bien l’avoir, parce que « je suis un homme oh… comme ils disent » (je ne suis pas sûr d’avoir compris les paroles d’Aznavour). Le malentendu, tu l’espères toujours à ton profit dans le regard de l’autre. Comme disait Jean-Claude Dusse : « Forcez, forcez, vous en tirerez toujours quelques-unes ». Et peut-être devrions-nous voir chaque film comme si c’était déjà un second rendez-vous… Et comme si les escrocs, capables de violer la réalité d’un film, c’était nous.


Trou noir
La traversée du trou de ver ressemble à une scène de voiture dans les films des années 40 avec une projection arrière. La différence ici, c’est qu’on l’a projetée en face et sur les côtés et qu’elle est cylindrique. Aucune profondeur, comme si c’était une toile peinte à l’intérieur d’une paille. C’était plutôt laid et étrange. Même supervisé par un scientifique, ce n’est pas une raison pour en faire quelque chose de si peu efficace ou de laid. Et de fait, j’ai été déçu, on voit quantiquement rien.
Avec Gravity et Interstellar, on a l’impression, plus qu’avec 2001, que certains cherchent un compromis entre le cinéma spectacle de Spielberg ou de Lucas, et celui jugé plus ambitieux des années 70 qu’il a fini par étouffer. L’alliance de la fantaisie et du naturalisme… Cela trouve certaines limites. La justesse toute kubrickienne de chercher à coller à la réalité technologique se heurte aux obligations d’un récit qu’on force à faire rentrer dans les clous d’un récit convenu (j’ai attendu naïvement que le père nique avec sa fille ; ç’aurait été plus intéressant, plus subversif, plus Nouvel Hollywood). D’un côté, on se force à montrer qu’on ne tombe pas dans le panneau des incohérences devenues célèbres et propres aux films dans l’espace. C’est bien gentil d’attendre qu’il y ait de l’air dans une pièce pour appuyer sur le bouton on du son, sauf que le résultat est bidon et casse le rythme. Au moins, c’est cohérent avec l’ensemble, d’accord. Et d’un autre côté, on ne peut pas échapper à certaines incohérences, surtout quand on s’applique à tout expliquer (au moins, les ellipses permettent de ne jamais trop en dire… sur ses lacunes). Comment arriver ainsi à nous faire croire que sur une planète où les ressources sont si difficilement disponibles, une poignée de chercheurs de génie (pour ne pas dire un seul, alors même qu’il révélera lui-même être un escroc) parvient à réunir tout le matériel et toutes les connaissances nécessaires pour envoyer autant de sondes et de vaisseaux à l’autre bout du système solaire ? Ce qu’on n’arrive pas à faire aujourd’hui, ils seraient capables de le faire avec moins de moyens et moins de ressources ? (Même principe avec le robot qui est plus un fantasme de Nolan qu’une éventualité technologique crédible…)
Brièvement, sur Nolan :
Nolan est plus apprécié encore depuis qu’il fait de la merde (dans mon esprit : après Memento). Et pour tout dire, je suis même surpris que ses films aient du succès. Ce n’est pas un metteur en image, ce n’est pas un directeur d’acteurs, ses scénarios sont englués dans la prétention et le mystère artificiel. S’il a du succès, c’est que ses films sont baroques : des effets et encore des effets. Que des spectateurs intelligents se soient perdus à apprécier son travail, oui, ça m’avait étonné. Preuve, encore une fois, que le talent d’un cinéaste, il est surtout de convaincre ; et ce pouvoir de séduction n’a rien à voir avec la raison, quoi qu’on fasse pour rationaliser, après coup, notre adhésion à telle ou telle démarche créative. Son succès, je m’en moque, ça n’entre pas en considération dans ma grille de lecture. Si, aussi, d’autres se retrouvent pour ne pas l’apprécier, c’est moins parce qu’il a du succès que parce qu’il gonfle sérieusement à agiter les mains comme un prestidigitateur sans jamais venir au bout de son tour de magie. Normal que ça en agace certains. Les premiers s’en servent peut-être pour leur brushing.
Interstellar, Christopher Nolan 2014 | Paramount Pictures, Warner Bros., Legendary Entertainment, Syncopy
Sur La Saveur des goûts amers :
Sujets abordés dans les commentaires de films
Top des meilleurs films de science-fiction : hard SF, horror et space opera
Critique d’Interstellar vu par un fan
Liens externes :


 Année : 2008
Année : 2008















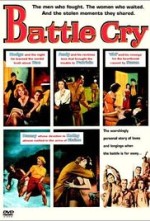


 Année :
Année : 






























