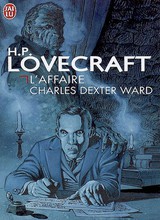Ayant vu mon intervention sur une vidéo Youtube mise « sous silence » à cause de sa longueur (on ne rit pas), je rapatrie l’ensemble de ma discussion (avec trineor, essentiellement sur SC) ici. Trop compliqué pour en faire un article, je me contente de reproduire les quelques échanges qui avaient commencé en bas d’un “post” sur SensCritique traitant des méprises historiques exprimées par un youtubeur sur une de ses vidéos-critiques consacrée au film de Martin Scorsese, Silence. M’étant comme d’habitude un peu emballé sur la longueur de mes réponses, et habitué encore à supprimer le plus souvent mes commentaires sur ce site, je reprends mes billes après en avoir prévenu le principal intéressé (quant à ma réponse sur la vidéo Youtube, n’étant pas visible, je l’ai également supprimée).
Le sujet m’étant particulièrement cher (la question de l’interprétation des œuvres cinématographiques), mes deux ou trois interventions se sont résumées (si on peut dire) à des longs monologues. Le présent “article” a donc surtout un intérêt personnel et me servira de notes pour y retrouver les idées à l’occasion d’un improbable et futur article relié à cette même question de l’interprétation des œuvres…
L’article n’ayant là encore pas vocation à prolonger le débat, les commentaires y sont comme d’habitude fermés. Après quelques jours en “privé”, la retranscription de ces “changes” est désormais publique (et partagée sur les lointains réseaux). À ceux, les improbables lecteurs et/ou contradicteurs, qui liraient cette enfilade et qui trouveraient un intérêt à y répondre, ils trouveront encore toujours moyen de le faire ailleurs… Que chacun dépose ses monologues dans son coin, c’est encore peut-être la meilleure manière de changer le monde…
Non ? Question de vision… du monde.
Pour moi, tout a donc commencé en réaction à un « post » de trineor et de Pilusmagnus dont voici la longue introduction (le lien pour l’ensemble du fil est un peu plus loin) :
Pour la suite de la démonstration et les commentaires, c’est ici : ancien post senscritique
Mon premier commentaire : Je n’irai pas voir la vidéo, ce que je peux dire en revanche, c’est qu’il me paraît bien naïf de croire, de prétendre même, qu’il y aurait des contrevérités exposées par un spectateur-critique face à des faits bien objectifs que seuls quelques spectateurs avisés ou cultivés sauraient voir. Durenmachin n’est pas critiqué pour ses goûts comme vous le dites, ni même pour ses propos, mais parce qu’il est écouté, or comme tout le monde il a le droit à la connerie et surtout droit au privilège accordé à chaque spectateur d’offrir à ceux qui l’écoutent une vision qui ne saurait être autre chose que personnelle sur une œuvre en particulier. Pas une opinion, pas un goût, mais une vision.
Que Durenmachin, ou d’autres, puisse balancer ce qui semble, à d’autres, des contrevérités qui ne sont que des interprétations qui, sorties de leur contexte, auraient encore moins de sens. Même l’histoire (celle du Japon ou des religions) peut être vue à travers le prisme de l’interprétation ; parler de faits historiques objectifs aurait encore un sens s’il était question précisément d’histoire ; or il n’est pas question ici de faits historiques mais d’événements narrés, autrement dit des faits historiques (ou présentés comme tels, supposés) qui sont vus (je parle bien de « vision »), présentés, et donc déformés par les différents regards ou auteurs ayant produit l’œuvre (ou œuvres) en question.
Le regard original de Shusaku Endo présente peut-être déjà (je ne l’ai pas lu) une vision personnelle éloignée de la réalité (les « faits » non alternatifs, « l’Histoire »), celle de Shinoda ayant réalisé une première adaptation au cinéma a sans doute proposé une autre vision et interprétation, et celle de Scorsese est forcément encore différente. Laquelle est la « bonne » ? La moins… « alternative » ? Celle qui présenterait le moins de contrevérités ? La plus cohérente ? La plus conforme à l’originale ? Chaque vision est légitime pourtant elles sont différentes voire contradictoires ou même contraires aux faits historiques. Les auteurs ont tous les droits, y compris de réinterpréter l’histoire, adapter, tordre une vision « originale ». Et si les auteurs ont tous les droits en matière de présentation ou de « vue » de l’histoire, le spectateur-critique aussi. Shinoda interprète l’interprétation de Endo de l’histoire, Scorsese fait de même et tord à nouveau peut-être en fonction de ce qu’il sait ou voudrait savoir de l’histoire, et nous spectateur, on retord notre interprétation de l’interprétation de l’interprétation de l’histoire en fonction de ce qu’on sait, voudrait savoir, etc. De la même manière qu’un auteur n’a aucun devoir de respect envers l’histoire (la grande), le spectateur-critique n’a aucun devoir de connaissance historique, même s’il est amené comme ici à utiliser ses mé/connaissances (soumises à interprétation/s) pour appuyer pas un propos, mais une vision. Parce que le spectateur à tous les droits, il exprime sa vision, sa compréhension d’un objet critiquable, à savoir une œuvre d’art baignant dans une savante soupe dramatique et narrative. Une histoire, ce n’est pas l’histoire.
Tout est vision. Vision contre visions. Celle que propose un ou des auteurs (celui qui met en scène fait sienne la vision d’un autre, mais elle peut déjà ne plus rien à voir avec l’originale, comme l’originale peut parfaitement maltraiter l’histoire, la grande…). Et tout est matière dans l’art à l’incompréhension et au malentendu, c’est presque le propos même, l’utilité de l’art : nous présenter ce qui nous sépare pour nous forcer en quelque sorte à nous rapprocher par le biais de nos différences. Jamais l’art ne prétend à la vérité ou forcer un droit, une légitimité, de ce qui est « vrai ». C’est même il me semble tout le contraire comme quand dans un même récit un auteur nous présente un même événement vu par différents personnages. Et là encore, ce n’est pas qu’un privilège des auteurs mais aussi celui des spectateurs : dans un récit à la Rashomon par exemple, il n’y a pas que l’interprétation faite par les différents points de vue des personnages, il y a aussi celle qu’en fera chaque spectateur. Ni contrevérité ni faits alternatifs, mais des visions différentes.
Laissez donc Durenmachin offrir à ceux qui le suivent pour des raisons qui leur sont propres son avis, sa vision, son interprétation d’une œuvre d’art, parce que si l’œuvre en question n’est pas soumise à un devoir de véracité historique, les spectateurs non plus. Si l’auteur a tous les droits, celui qui le critique aussi.
Si Durenmachin peine à utiliser des arguments historiques que vous auriez de toute façon un peu tort de vouloir lui reprocher dans un contexte créatif, c’est une chose. Il s’exprime mal, il est plus inculte que vous, peut-être. Reste qu’il cherche à exprimer son expérience, sa vision, sur un film, et que ça, ça lui appartient. Dans l’art, la fiction, tant au niveau de sa représentation que dans sa compréhension, il n’y a pas de « vérité », pas de « faits historiques ». Tout ce qui est lié à la « fable » (l’histoire, le canevas, les événements dramatiques) est subjectif, quels que soient les éléments historiques ou prétendument réels auxquels ils « semblent » se référencer. L’ennui de Durenmachin, s’il y fait référence, il est bien réel, lui. Peu importe s’il ne sait pas étayer « son ressenti », sa « vision » de la « bonne » manière. Il est dans son droit et chacun pourra juger de la cohérence, de la pertinence, de ce qu’il balance. Ça lui appartient. Et on ne détord pas ce qui par nature est (et doit rester) tordu. On ne partage pas une « vision », on ne fait que des « tentatives de partage ». Oui, il est question de subjectivité. Ça commence quand un auteur place une histoire dans un cadre historique. Le contexte pourrait être le mieux documenté du monde, les personnages qu’il y introduit sont fictifs. L’interprétation commence là, et elle ne s’arrête plus. Parce que l’art, ce n’est pas une opinion, c’est une expérience, c’est une simulation du réel (ou d’un réel) justement pour expérimenter à peu de frais (une fiction comme un rêve — qui partage les mêmes propriétés — on y vit par procuration des événements qui sont censés nous apporter une expérience qu’il est préférable de « vivre » à travers ces simulations qu’en les vivant « pour de vrai ») le réel. Le contresens, il serait plutôt de chercher à resituer ce qui n’est qu’interprétatif, fictif, dans la réalité. C’est vain, insensé, et sans doute un peu ridicule.
Dernière chose. On n’explique pas une œuvre. On peut bien sûr, mais ce n’est pas une nécessité. Surtout, quel que soit le niveau d’érudition de ceux qui s’en chargeront, on ne pourra là encore éviter de faire de l’interprétation. On ne voit que ça : les exégètes se plaisent à « expliquer » des œuvres, à nous présenter ce qu’à voulu « dire » l’auteur. C’est de la mascarade bien souvent, tout aussi ridicule, mais sans doute plus habile que celle dénigrée ici de Durenmachin. Parce qu’on n’explique pas une œuvre, on l’interprète. On offre des pistes, on propose un cadre historique, un contexte pour aider les lecteurs ou spectateurs à « comprendre », mais il n’y a pas « une » compréhension possible comme il pourrait y avoir des « faits historiques non alternatifs », car tout est alternatif, tout est interprétatif, dans une fiction. Les œuvres s’offrent à tout le monde. Un auteur n’impose pas sa « lecture » ; au contraire même, les œuvres les plus fascinantes sont souvent celles qui offrent le plus de possibilités d’interprétations et de lectures. Elles ne s’offrent donc pas seulement aux érudits. C’est encore un droit du spectateur : ne pas comprendre ce qu’a voulu dire l’auteur. Parce qu’un auteur ne « dit » rien, son œuvre ne « dit » rien. Il(s) raconte(nt). Comme quand on rêve, aucun coryphée ne vient nous dire au creux de l’oreille ce que tout ce bazar va bien pouvoir nous servir. Tout récit, par essence, est soumis à l’interprétation de chacun. Parce que depuis toujours, on se raconte des histoires pour l’ « expérience » qu’on en tire : c’est à la fois ludique et didactique, mais il n’y a que celui qui les reçoit qui peut en tirer des conclusions, une morale. C’est donc un droit du spectateur oui, comme l’auteur a tous les droits de ne pas comprendre ou de travestir, lui aussi, sciemment ou par ignorance, l’histoire (la grande). Vous confondez la liberté d’opinion (que vous voudriez donc voir restreinte pour les cons en somme, puisque c’est bien ce « droit » de s’exprimer, et donc le droit de Durenmachin à exprimer des « contrevérités » que vous voudriez restreindre, belle leçon) et l’expérience cinématographique, critique. Cette expérience, c’est plus une « vision » qu’une « opinion ». On peut toujours discuter, confronter nos expériences, parler d’histoire, mais chercher à interdire un spectateur-critique à s’exprimer va à l’encontre même de tous les principes en art. Et l’art, ce n’est pas de l’Histoire.
Perso, je n’irai pas voir le film (pas plus que je n’irai voir la vidéo du bonhomme en question). J’ai vu la version de Shinoda et je n’ai aucune raison de penser qu’un tel sujet puisse m’intéresser. Même traité autrement (avec une « vision » différente). En revanche, je ne sais si c’est fait, même je vous conseille, vous, de la voir cette version initiale, pour que vous compreniez un peu mieux peut-être qu’avec un même sujet, on puisse tirer des œuvres différentes, voire contradictoires. Et comprendre alors, que si on peut offrir deux visions d’une même histoire évoluant dans un même contexte historique et que l’une semble plus « fidèle » dans sa « reconstitution » que l’autre, c’est bien que la question de la fidélité à l’histoire reste hautement subjective, et parfaitement accessoire dans une œuvre de fiction. Vous pouvez confronter votre vision, avec celle de Durenmachin, puis avec celle de Scorsese ou de Endo (ou de Shinoda), aucune ne serait identique, et ce que vous pourriez juger dans un autre domaine comme étant des « incompréhensions », ou une « méconnaissance » du sujet, n’aurait aucun sens ici puisqu’on a affaire à une fiction. Je le répète : vision contre visions. Pas une question de goûts ou de propos, mais bien de « vision ». Comparer, comme vous le faites dans votre dernière phrase, les vérités alternatives de Trump avec les contrevérités de Durenmachin n’est-ce pas là plutôt un contresens ? Est-ce que vous ne confondez pas interprétations et désinformations ? Est-ce que l’art, la fiction, a un devoir d’information, de vérité historique ? Non. La fiction tord la réalité, prend l’histoire en otage justement pour apporter un peu de relativisme dans la connaissance de l’histoire. Et le relativisme, ce n’est pas forcer des « vérités alternatives ». Si le Shinoda ne vous convient pas par ailleurs, je vous conseille alors sur le même sujet, et pour rester au Japon, le Samouraï de Okamoto traitant de l’incident de Sakuradamon : ou comment la fiction peut illustrer l’idée que l’Histoire peut s’écrire, potentiellement, sur des mensonges.
Réponse de trineor
@limguela Merci pour ton riche message et pour tes recommandations !
Que d’emblée j’éclaircisse notre intention – parce qu’il est tout à fait possible que nous l’ayons mal exprimée, ou même que nous ayons, fût-ce involontairement et malgré la bonne volonté que nous avons tenté de mettre à les réprimer, laissé s’exprimer de plus mauvaises intentions sous-jacentes, une forme de mépris sans doute, qui en effet n’aurait rien de louable. Pour ce qui est de l’intention que nous nous sommes intentionnellement fixée, toutefois : d’aucune façon nous ne souhaitons « clouer le bec » de ce garçon ; d’aucune façon nous ne désirons qu’il cesse de publier des vidéos et d’exprimer librement sa sensibilité et, comme tu le dis justement, de produire une vision qui lui est propre. (Simplement : qui serions-nous pour souhaiter une chose pareille ? Toute sensibilité a sa part à porter à la richesse du réel – celle de Durendal y compris, si incongrue puisse-t-elle régulièrement nous paraître.)
Ce que nous souhaitons, c’est qu’il continue bien sûr à faire ce qu’il aime (il n’attendra de toute façon pas notre aval, et aura bien raison) mais que, si possible, il réalise combien il gagnerait à travailler et à préparer davantage sa prise de parole, à méditer et enrichir un point de vue avant de l’énoncer d’un ton définitif et autoritaire devant plus d’une centaine de milliers de jeunes dont beaucoup l’écoutent comme un prophète.
Tu as tout à fait raison lorsque tu soulignes ce point : si l’on prête attention à ce que dit Durendal, c’est parce qu’il a de l’audience. Durendal faisant du Durendal chez lui avec trois potes, ça ne prêterait à aucune conséquence, et ça ressemblerait probablement au mode d’expression que tous, il doit nous arriver de nous autoriser en petit comité. Où je diverge toutefois avec toi, c’est quand tu évoques à ce propos un « droit à la connerie » : d’accord concernant la parole non-publique en petit comité. Mais le grand nombre, ou parfois aussi le statut du locuteur (s’il est, admettons, un représentant élu, ou dans le cas qui nous intéresse un prophète des jeunes âmes), confèrent à la prise de parole une autorité, et l’autorité ne va pas sans responsabilité. Cette responsabilité consiste justement, il me semble, à ne pas s’abandonner confortablement à un droit à la connerie : l’autorité confère la responsabilité d’une tenue dans la parole, d’une hauteur minimale du propos – laquelle hauteur peut n’avoir strictement aucun rapport avec l’érudition, tant il est vrai qu’on peut faire un usage infect de l’érudition, comme l’on peut sur une base d’ignorance, amorcer de la pensée, dialectique, réflexive, humble, respectueuse, riche…
Pour ce qui est de la valeur de vérité des faits, je m’avoue surpris (agréablement surpris…) qu’on en vienne à un débat épistémologique sur la nature même du “fait”. Et sur le principe, je serais le premier partant pour affirmer avec toi, et contre les néopositivistes notamment, qu’opérer une distinction nette entre les faits et les jugements de valeur est en dernier ressort une illusion, en ceci même que le “fait” est toujours défini / délimité / sélectionné / décrit selon des partis pris interprétatifs sur le réel qui, en eux-mêmes, dénotent déjà du jugement de valeur. Au niveau le plus élémentaire, ne serait-ce qu’au moment de nommer ce qui est physiquement présent, dire que ceci est « un pot de fleurs » ou « des fleurs dans un pot » ou « du myosotis dans une jardinière de briquette rouge » représente déjà trois perspectives sur le réel qui sous-tendent des registres de valeurs différents ; de même que, par la perception, ne serait-ce que commencer à découper des objets à vocation humaine dans la substance informe qui nous environne, c’est déjà interprétation, apposition de vision. En ce sens, je suis bien d’accord : le fait brut, le fait nu, n’existe nulle part.
Mais revenons-en moins abstraitement à ceci : si je pointe les myosotis dans la jardinière de briquette rouge et que je dis : « ceci est un caniche », alors il est quand même manifeste (contre tout relativisme et tout perspectivisme possibles) qu’il y a là une contre-vérité à laquelle on est en droit d’opposer le “fait” – dût-ce ne pas être du fait pur, brut, mais du fait conventionnel. Car il se peut tout à fait qu’en regardant ces myosotis, je capte par quelque découpage interprétatif secret propre à ma sensibilité, une certaine “canichité” du réel, mais en disant qu’il y a là un caniche et non un pot de fleurs, je romps la possibilité d’une compréhension intelligible du réel partageable avec mes semblables, et, pire, si je suis un prophète, se profile le risque que les jeunes âmes s’en aillent par toute la société après cela pointer les pots de fleurs en s’écriant : « un caniche ! »
Je plaisante un peu, bien sûr. Mais un peu, seulement, je t’assure : je ne grossis qu’à peine le trait au regard de certaines des énormités que peut proférer le garçon dont il est ici question.
Après je ne vais pas faire semblant de ne pas comprendre ce que tu dis : on parle de sujets historiques, religieux, artistiques – bien sûr, la part qu’y tient l’interprétation est plus grande que lorsqu’il s’agit de désigner nommément un objet concrètement présent, puisqu’il ne peut s’agir là que d’objets rapportés (pour l’histoire) ou d’objets abstraits (pour la religion et l’art). Et tout ce qui dans cette part que tient l’interprétation ressort du strict jugement de valeur (dire trouver telle œuvre ennuyeuse ou telle autre laide, admettons) est entièrement libre et n’est pas ici ce que nous avons voulu reprocher à Durendal. En revanche, ce qui, dans cette part d’interprétation, prétend s’appuyer sur un fond factuel, donne par là même un droit opposable à la réfutation par les faits – fût-ce, donc, ce que j’appelais du « fait conventionnel », en l’absence de « fait brut ».
Et je sais bien que l’affaire est problématique, car le fait conventionnel que ce soit en matière d’art, d’histoire ou de religion, ne sera pas du tout établi d’après les mêmes conventions selon qu’il le soit par un matérialiste historique marxiste ou par un identitaire tenant de l’appartenance et de la nation (pour prendre en exemple une opposition volontairement un peu grossière, ça délimite de façon plus nette). Mais toute problématique que soit l’affaire, ça n’empêche pas que certaines affirmations, quel que puisse être le référentiel conventionnel éventuel dans lequel on les considérerait, sont purement et simplement indéfendables, car contraire à tout fond factuel disponible.
En ce sens, nous n’aurions jamais idée de prétendre qu’il n’y ait qu’une unique lecture juste, une lecture vraie – que ce soit de l’histoire, de la religion ou plus éminemment encore de l’œuvre d’art, dont tu exprimes quelque chose de très juste, je trouve, quand tu pointes combien elle a à voir avec l’incommunicabilité et le malentendu) ; mais nous prétendons néanmoins qu’il y a des lectures incontestablement fausses, parce qu’insoutenables. C’est un peu la fonction élémentaire du “fait” dans l’épistémologie moderne, d’ailleurs, que de dire que s’il ne peut jamais suffire à “vérifier” une théorie valide (et c’est pourquoi il peut coexister simultanément des théories valides aux affirmations contradictoires entre elles, comme tu le montrais pour la “vision” portée sur l’histoire, la religion ou l’art), du moins le fait suffit à falsifier une théorie invalide. Que le fait soit conventionnel (et non brut comme le pensaient les néopositivistes) ne fait que rendre ce travail de réfutation plus difficile et plus incertain, car plus sujet au malentendu – malentendu en quoi consiste précisément le côté parfois bouffon des mauvais « facts checkings ». Mais n’enlève rien, à mon sens, au devoir de mener ce travail de réfutation face à un discours.
Entendons-nous : je parle du discours.
Une œuvre d’art est un espace d’absolue liberté : on doit pouvoir y exprimer absolument tout, n’importe quel sentiment ou n’importe quelle vision, et c’est pourquoi la censure est la mort de l’art. Mais en l’occurrence, le vlog de Durendal n’est pas une œuvre d’art – quoique, si l’on découvrait qu’en fait, le mec fait une performance depuis tout ce temps, ce serait savoureux… –, c’est un discours sur l’art.
Et le discours pour qu’il y ait ne serait-ce que possibilité logique d’un discours et signification dans le discours, doit garder une vocation à la vérité. (Je suis sans doute en cela kantien.) Ou bien, sinon vocation à la vérité, du moins vocation à ne pas se livrer effrontément à la fausseté. Sauf à tomber dans un perspectivisme nihiliste où la vérité même serait une valeur dépassée et où tout ce qui importerait serait d’imprimer au discours la marque de mon désir, de ma volonté, de mes valeurs, même si ce que je désire dire est factuellement insoutenable et manifestement faux. On entrerait là, ce me semble, dans une espèce de célébration irrationaliste de la volonté, très nietzschéenne, qui rendrait le discours absurde et où le relativisme (initialement voué à la tolérance du point de vue d’autrui) finirait par rendre inopérante la profession même d’un quelconque point de vue, parce qu’affirmer n’aurait plus de sens, parce que parler n’aurait plus de consistance logique. Or c’est ce qu’opère la post-vérité : la prise de pouvoir absolue de l’opinion sur les faits, sans possibilité de recours logique puisque le recours logique a d’avance été désavoué.
Moi : Je ne vais pas faire simple et concis, j’en suis désolé.
« d’aucune façon nous ne désirons qu’il cesse de publier des vidéos »
C’est qu’il y a dans votre présentation une phrase qui le suggère : « (…) nous désirons avant toute chose nous inscrire en faux contre l’idée selon laquelle un discours sur l’art ne serait qu’affaire de subjectivité ou de relativité des goûts, et selon laquelle la liberté d’opinion garantirait un droit à proférer des contrevérités. »
« S’inscrire en faux contre » = s’opposer à l’idée que. Quelle idée ? Celle que la liberté d’opinion garantirait un droit à la connerie (je paraphrase) ? C’est peut-être mal exprimé, ou peut-être y a-t-il une subtilité de langage qui m’échappe. Probable par exemple que cette subtilité se situe au niveau de la définition même d’une critique, d’un avis, d’un commentaire, que tout cela soit écrit, vlogué (?!), public et massivement vu. Vous parlez de discours, voire d’opinion. Or en matière d’art, il me semble plus juste de parler de « vision », « d’expérience », pour insister sur la nature, oui, subjective du commentaire de film. Parce que l’objet discuté, ce n’est pas un fait historique, mais une œuvre d’art qui pose elle-même un regard (donc un premier niveau de subjectivité) sur l’Histoire. Quelle que soit la qualité ou le respect de ce contexte historique, dans l’œuvre, le seul regard de l’auteur anéantit par la suite toute possibilité de ramener le sujet, en commentaires, aux faits historiques, sinon à titre indicatif ; en aucun cas cela pourrait appuyer une argumentation, un discours… critique. L’objet discuté est biaisé par nature : une œuvre, ce n’est pas un discours, c’est une vision. Et le commentaire qu’on en fera, ne sera jamais rien d’autre elle aussi qu’une vue. À partir du moment où on estime que Durenmachin propose un discours, une opinion, et si au contraire on ne voit là comme partout ailleurs que des vues, on risque de se heurter sans cesse aux mêmes incompréhensions.
Ce ne serait que des opinions, d’ailleurs, que je dirais la même chose. Toutes les opinions doivent pouvoir s’exprimer, même les plus extrêmes, même les plus insupportables. Parce que les opinions, les idées, les propos, les commentaires, etc. on peut toujours les combattre avec des mots. Un droit à la connerie, oui, et un droit à proférer des contrevérités. Parce qu’on est tous libres de s’opposer, avec les mêmes armes (les mots), à ce qu’on juge être des contrevérités. Que Durenmachin exprime des opinions ou des vues, cela n’y change pas grand-chose : vous jouissez de cette même liberté pour le contredire. Votre vision, contre la sienne (ou votre opinion, contre la sienne). C’est bien cette phrase qui me titillait. Parce qu’autrement, même s’il faut saluer l’effort, je… m’inscris en faux contre ce que vous écrivez ici : « Ce que nous souhaitons, c’est (…) que, si possible, il réalise combien il gagnerait à travailler et à préparer davantage sa prise de parole, à méditer et enrichir un point de vue avant de l’énoncer d’un ton définitif et autoritaire devant plus d’une centaine de milliers de jeunes dont beaucoup l’écoutent comme un prophète. » Un vœu pieux, non ? Je reviens toujours à mon « droit à la connerie » : qu’est-ce qui l’obligerait (ou l’aiderait) à dire moins de conneries ? En quoi est-ce si problématique qu’un idiot, ou un inculte, offre au monde son opinion, ou sa vision, d’un film ? Ne devrait-on pas laisser chacun libre de juger de ce qu’il lit, écoute ou voit ? Est-ce que regarder un vlog du Durenmachin c’est adhérer à ses idées ? Les visionneurs sont-ils dépourvus d’esprit critique, de liberté de juger et de contredire ce qu’ils voient ? À l’école, j’étais fasciné par les professeurs qui disaient qu’il ne fallait avoir aucune honte à se tromper parce qu’il y avait comme une vertu à se faire corriger. J’adorais cette idée, et elle m’amusait d’autant plus que jamais aucun professeur (et les élèves avec eux) n’était en mesure de l’appliquer, parce qu’en pratique, dès qu’un élève disait une connerie, il se faisait ridiculiser, réprimander. Non seulement c’est contradictoire, mais surtout, c’est improductif. D’une certaine manière, Durenmachin me fait penser à un de ces élèves que je n’ai jamais eu l’occasion de voir, capable de balancer toutes sortes de bêtises avec le privilège certain de ne jamais avoir à être moqué. D’un côté, il est possible qu’il n’entende jamais les critiques qui lui sont adressées, d’un autre côté, je ne peux m’empêcher de penser qu’il y a là aussi une forme de vertu à le voir s’exprimer, se tromper, librement. Les élèves sont partout, les professeurs plutôt rares, désolé de le penser. Nous sommes alors tous nos propres maîtres. Alors, s’il est tout à fait louable de chercher à déniaiser le bonhomme, pourquoi ne pas le laisser apprendre de lui-même, de ses erreurs ? Il est beaucoup écouté, et alors ? Est-ce que les personnes qui le regardent n’ont encore une fois aucun sens critique ? Qu’il continue de dire ses bêtises, s’il n’arrive pas à être son propre professeur, il y en a sans doute parmi ses spectateurs beaucoup qui se font leur propre leçon et iront vérifier par eux-mêmes. On apprend parfois à exprimer une idée… contre une autre. Apprendre à exprimer ce qu’on pense, que ce soit une opinion ou une vue, ce n’est pas forcément aisé, or commencer par dire « je ne suis pas d’accord avec ça », ou penser « ce qu’il dit me paraît être n’importe quoi je vais vérifier » ça peut aider à exprimer des idées que l’on pense juste. Durenmachin n’est pas un prophète. Inutile de s’émouvoir du nombre de ses spectateurs, après tout, la vaste majorité des spectateurs de Cinquante Nuances de Grey va voir le film pour se moquer du résultat. Je pense qu’il y a un peu de ça dans le succès du Durenmachin. Pour nous rassurer, nous avons peut-être besoin de nous définir dans la contradiction : on ne saurait pas précisément pourquoi on n’adhère pas, pourquoi c’est mauvais, mais c’est évident, alors on fonce, et on l’exprime. » Ça en dit peut-être long sur la culture critique de notre société, mais c’est sans doute un début. Et la capacité de contredire, c’est bien aussi ce que nous exerçons tous ici. Il doit y avoir là une forme de cercle vertueux. Qu’aurions-nous à dire sérieusement si les imbéciles devaient se taire à jamais ? Les professeurs ont raison et devraient être capables beaucoup mieux de l’appliquer dans leurs classes : se tromper, c’est bien. Le droit à la connerie est préférable à une absence de liberté d’opinion ou d’expression.
Vous l’aurez compris, je ne serais pas « pour » l’idée de responsabilité du propos une fois un certain statut acquis. C’est un peu comme dire que les footballeurs ont un devoir de respectabilité parce que des jeunes les vénèrent. Je ne comprends pas cette position, sauf si on comprend, et adhère, à l’idée que certaines personnalités puissent être vues comme des héros, autrement dit des demi-dieux et que ce « statut » leur procurerait à la fois des pouvoirs et des devoirs que d’autres citoyens n’auraient pas. Je n’aime pas les exceptions, je n’aime pas les super-héros fabriqués, je préfère l’égalité. Un footballeur, ça joue au foot, tout le reste, c’est du domaine privé, et lui aussi, s’il venait à s’exprimer, devrait pouvoir jouir d’un droit à la connerie, à l’erreur, au moins tout autant que les autres, parce qu’il est un footballeur, rien de plus, rien de moins. Même chose donc pour les vedettes de Youtube ou d’ailleurs. Aucun statut ne vous procure droits ou devoirs supplémentaires. Durenmachin a tout autant le droit de déblatérer les conneries qu’il souhaite, qu’il soit vu par deux personnes ou deux millions. Je ne vois pas bien comment on pourrait justifier le fait qu’il ait l’obligation de raconter moins de conneries. À partir de quel niveau d’autorité, déciderait-on qu’un individu se doive de faire attention à ce qu’il dit ? « Maintenant que tu fais autorité mon petit gars, fais attention à ce que tu dis ! » Dans ce droit à la connerie, j’y place aussi un droit à l’erreur, à la folie, au doute, à la subversion, à la rébellion… Parfois, la connerie, c’est simplement sortir des usages communs, prendre des risques (de se tromper), proposer de nouvelles voix, remuer la société (proposer une voix « contre » sur laquelle les bien-pensants pourront alors confortablement se reposer). Parce que rien n’est jamais né de l’académisme, de la bonne conscience, de l’autorité établie… et même si ces esprits réfractaires à la rigueur, à la logique, au bon goût n’ont « raison » qu’une fois sur un million, j’ai foi en l’idée que cette seule fois peut être nécessaire. Si on ne nous laisse pas la possibilité que cette « fois » vienne chambouler notre univers, c’est la mort des idées, la mort de l’art, de la critique, de l’opinion et du reste. Face à tous ces déchets, cette connerie insupportable, il reste cette possibilité qui vaut la peine qu’on laisse tout le reste demeurer.
Concernant la question de la nature du fait, là encore, j’ai peur qu’on ne parle pas de la même chose. Reprocher à Durenmachin qu’il parle de moines au lieu de prêtres comme il parlerait de caniche pour un pot de fleurs, ç’aurait beaucoup plus de sens, oui, si on se limitait à la question historique et si c’était même l’objet de la discussion. Or c’est un peu accessoire, Durenmachin s’en sert pour exprimer sa vision du film. Si son but ici, par exemple, était d’expliquer au fond pourquoi il s’était ennuyé, que ce soit des prêtres ou des moines, n’y changera pas grand-chose. Certes, cela montrera en quoi, il a pu passer à côté d’un film (celui que d’autres ont vu), mais chacun se représente une image, une vue, une vision, une reproduction personnelle de l’œuvre, car elle est bien plus là la question d’interprétation qu’au niveau des pots de fleurs et des caniches. On pourrait alors lui reprocher pourquoi pas de voir un film probablement très éloigné du film écrit et réalisé, ou même vu par les autres spectateurs, mais encore une fois, le spectateur a toujours raison, il voit le film avec ses connaissances, avec ses armes, avec sa sensibilité, et personne ne peut lui dire quel film il devrait voir. L’expérience reste personnelle. Est-ce qu’il faudrait éduquer tous les spectateurs, les prendre par la main, faire tourner les explications à la fois de l’auteur puis celle du réalisateur voire du distributeur ou d’un historien pour mettre en perspective tout ce qu’on ne saurait pas voir dans le film ? Je ne crois pas. Là encore, je tiens à la liberté du spectateur, qui avant d’être con, avant de pouvoir s’exprimer, doit pouvoir jouir du droit de faire l’expérience d’un film qu’il verra avec ses armes à lui. On ne dirige pas le regard du spectateur sinon à l’intérieur même du film. Cela serait d’autant plus incompréhensible que comme je l’ai dit dans mon précédent message, la vision de Scorsese n’est pas forcément celle de Endo, et le tout ne l’est pas forcément non plus avec ce qu’on sait de l’histoire. Il y a un droit au travestissement de l’histoire pour les auteurs (et en réalité, une fiction l’est toujours), et il y a un droit d’incompréhension du spectateur. Une œuvre qui est trop démonstrative, voire trop désireuse de respecter ou de reconstituer un contexte historique, est rarement intéressante pour le spectateur, parce qu’une partie du plaisir qu’il en tire, c’est justement d’imaginer par lui-même les intentions cachées derrière ce qu’il voit. Et souvent, plus les interprétations sont multiples, plus c’est le signe que l’œuvre est réussie. Qu’est-ce qu’il fait qu’un film ait parfois autant de succès ? Son message est clair, tout le monde y adhère ? Je ne crois pas. Au contraire, c’est très souvent parce qu’il propose des lectures (donc de possibilité de visions) très variées. On peut après, chacun de notre côté chérir des œuvres à la fois plus méconnues et qui font moins l’unanimité, mais la puissance des grands chefs-d’œuvre, il est bien là, à savoir convaincre le plus grand nombre en laissant à chacun l’impression qu’ils ont vu le même film alors qu’ils n’ont jamais vu que celui qu’ils s’étaient chacun reconstitué dans leur tête. L’intérêt de la discussion, des échanges de « vues », il est aussi de comprendre comment certains peuvent être amenés à voir des caniches quand on n’y voit nous que des pots de fleurs. Vision contre visions. Pot aux roses contre poteaux roses.
Tout est soumis à interprétation, encore plus dans la fiction, où elle est à mon sens, toujours la bienvenue. Mais il arrive aussi que les méprises se rencontrent à travers le langage dans des discussions, des argumentations… C’est peut-être moins amusant, le tout est là en revanche de ne pas s’y laisser prendre. Comme quand on use de l’adjectif « insoutenable » dans la phrase : « nous prétendons néanmoins qu’il y a des lectures incontestablement fausses, parce qu’insoutenables. » Cela pourrait tout autant dire « insupportable » qu’« indéfendable ». Il n’y a pas que dans l’art où la méprise peut être induite, volontairement même sans doute, par le langage. Et si on est tolérant avec les méprises probables suscitées par votre propre démonstration, on devrait l’être tout autant pour celles de Durenmachin. Mais j’ai une tolérance plutôt vaste dans le domaine, parce que si j’estime qu’on peut être tolérant à l’égard de la connerie (ou de la méconnaissance) des autres « visionneurs », je pense que ça peut aller jusqu’à la dépréciation voire l’insulte tant qu’elle reste dans le cadre des idées, non des personnes. Même si l’idée peut se révéler alors très sommaire, du genre « t’es qu’un bouffon si tu aimes ce film ». Ce qui est « insoutenable », c’est de sortir du cadre des valeurs. De ce que je comprends, Durenmachin s’en tient à exprimer sa « vision », et vous exprimez la vôtre (qui n’est pourtant pas strictement identique puisque vous êtes « deux ») « contre » la sienne. C’est lui faire, au fond, beaucoup d’honneur, puisque c’est « sa » vision qui est mise en valeur. Comme disait l’autre, qu’importe que l’on parle de moi en bien ou en mal tant qu’on parle de moi. C’est peut-être même là tout le succès de Durenmachin. Moins parce que ceux qui le suivent le regardent comme un Prophète que parce qu’à l’image d’un Cinquante Nuances de machin, on aime à se bidonner devant ce que tout le monde admet être ridicule. À une autre époque, la tête de turc qui faisait le buzz, c’était Michael Vendetta. Et d’une certaine manière, oui, c’est un spectacle, pas un discours.
« C’est un peu la fonction élémentaire du “fait” dans l’épistémologie moderne, d’ailleurs, que de dire que s’il ne peut jamais suffire à “vérifier” une théorie valide (et c’est pourquoi il peut coexister simultanément des théories valides aux affirmations contradictoires entre elles, comme tu le montrais pour la “vision” portée sur l’histoire, la religion ou l’art), du moins le fait suffit à falsifier une théorie invalide. »
Je ne suis pas sûr de bien saisir et pour être franc, ce n’est pas mon domaine. De ce que je comprends, en particulier en sciences, c’est que quand il y a deux théories contradictoires sur un même sujet, c’est précisément qu’on a encore affaire à des hypothèses. On peut aussi parler de théories contradictoires quand le champ d’application n’est pas parfaitement identique comme la question qui oppose physique quantique et relativité. Pour ce qui est de l’histoire, en tout cas celle dont il est question ici, la question du doute est me semble-t-il encore plus présente même si rarement évoquée : on parle de ce qui est référencé, documenté, en oubliant parfois sans doute que tout cela ne retrace qu’une partie connue d’une histoire, d’un contexte, mais on prend tout ça pour acquis tant qu’aucun élément contradictoire ne vient réveiller le doute dans l’affaire (c’est peut-être ce que vous dites d’ailleurs : « le fait suffit à falsifier une théorie invalide »). Mais encore une fois, ce n’est pas mon domaine, et ce n’était pas précisément sur ce point que j’insistais. Mon message était beaucoup plus tourné sur la nature non pas de l’histoire et des faits rapportés mais sur la fiction réinterprétant certains événements pour en reconstituer une image. L’histoire reconstituée, ce n’est pas l’histoire. Si on peut avoir des doutes sur certains pans de l’histoire, il n’est même pas question de ça ici, car une fois remâché par le prisme de l’imagination d’un homme (ou de plusieurs auteurs comme ici), il ne fait aucun doute (en tout cas dans mon esprit) que les faits rapportés ne sont pas l’Histoire. Même si ces événements étaient décrits par un historien avec la plus grande rigueur en matière de reconstitution, la fiction, par essence, est un travestissement du réel. Ces rappels à l’histoire faits à Durenmachin pourraient alors tout aussi bien être faits par vous ou des spécialistes à Scorsese (voire déjà à Endo). L’intérêt ne pourrait être alors qu’informatif, encore une fois. Pourquoi devrait-on reprocher à Durenmachin, à son échelle, de ne pas comprendre ou connaître l’histoire, quand les auteurs, pas seulement ceux de Silence, mais tous, par nature, ne « connaissent » pas l’histoire, mais la reproduisent, travestie. C’est une illusion, une fiction. Et ce qu’il y a de beau justement dans cette notion, c’est que si l’univers d’un auteur reproduit ou s’inspire d’une réalité (historique), le spectateur aura tous les droits, armé de sa connerie et de ses connaissances, pour retraduire à sa manière ce qu’il voit. Une vision. Pas une connaissance. Quand Shakespeare met en scène Richard III, il ne met pas en scène le duc de Gloucester historique, il en fait un personnage de fiction, un personnage qu’ensuite chaque metteur en scène sera charger de présenter à sa manière, comme chaque spectateur sera libre d’en réinterpréter la nature. Est-ce que Shakespeare respecte l’histoire quand il met en scène Jeanne d’arc dans Henry VI ? Sa Jeanne étant plutôt ridicule, on aurait plutôt tendance à penser qu’un spectateur anglais ne la percevra pas de la même manière qu’un spectateur français. Le personnage historique devenu historique propose une « vision » de l’histoire du personnage, et à son tour le spectateur voit autre chose, avec ses préjugés, ses connaissances ou sa sensibilité.
Discours ou pas, c’est pour moi l’expression d’une vision. Le langage n’est là que pour la mettre en forme, la rendre intelligible pour celui qui nous écoute ou nous lit. On ne peut jamais se mettre à la place de l’autre pour comprendre pleinement comment il perçoit une œuvre. Est-ce que c’est pourtant vain d’essayer ? Est-ce à dire que tout est permis ? Non. Parce qu’en place de la « vérité », quand on propose une vision personnelle d’une fiction (et non de l’histoire), ce qui compte me semble-t-il, c’est l’honnêteté et notre capacité à partager cette vision. Bien sûr qu’il peut être nécessaire de replacer des éléments factuels et historiques au cœur d’un « discours », mais cela vaut, à leur échelle, autant pour Durenmachin que pour les auteurs de fiction, car chacun étant plus spécialiste qu’un autre, on trouvera toujours à redire de la manière dont les uns et les autres reconstituent et voient, une histoire. Il ne faudrait pas s’y tromper : si certaines laissent à croire qu’elles sont respectueuses de l’histoire, elles ne le sont jamais. Elles le sont peut-être même d’autant moins qu’elles semblent reconstituer fidèlement un contexte historique et donnent alors l’illusion que ce qui est présenté est réel quand une reconstitution ouvertement infidèle, inspirée de, au moins ne jouerait pas avec l’illusion d’une reconstitution dont seuls les érudits seraient capables de déceler ce qui est reconnu, probable mais non vérifié, faux, etc. Est-ce que c’est le sens de l’art de jouer avec cette illusion ? Même pas. Ne pouvant être spécialistes et historiens, il faut prendre pour acquis le fait que toute fiction est un travestissement de l’histoire. Ce qui n’interdirait pas de jouer au jeu des sept erreurs, mais ça ne resterait… qu’un jeu. On ne serait toujours pas dans le discours.
S’interroger comme vous le faites sur les risques de travestissements ou de la méconnaissance de certains locuteurs avec un fort suivi quand il est question précisément d’histoire, de faits et d’événements historiques, d’accord. Le faire dans un domaine artistique où dès le départ, l’objet concerné, l’œuvre, est par essence un travestissement du réel, une illusion, je n’en comprends pas bien le sens. On pourrait même dire que reprendre l’inculte qu’est Durenmachin, c’est un peu facile ; on ne prend guère beaucoup de risques en disant qu’il se trompe et en s’appliquant à rappeler ce qu’est l’histoire… Ce qui serait plus louable, moins évident, ce serait de pointer du doigt les inexactitudes de Scorsese. Voir l’histoire, la reconstituer, c’est la trahir. Traduire, c’est trahir. Eh ben, on pourrait attendre des érudits qu’ils mettent ces différences en lumière, sans les juger ou en faire des éléments dépréciatifs du film, mais simplement pour amener à la connaissance du spectateur des éléments dont la plupart lui sont inconnus. Que Durenmachin confonde « prêtre » et « moine », est-ce que c’est si important dans sa vision ? Est-ce qu’il n’y a pas plus de tolérance envers Scorsese quand dans sa propre vision, ses personnages censés être portugais parlent avec la langue de Shakespeare ? On peut le souligner, mais en quoi cela rendrait moins légitime sa « vision » ? Ben pour Durenmachin, c’est pareil : on peut souligner ses méconnaissances, mais sa vision reste, malgré ces errances, parfaitement légitime. De la même manière qu’on ne demande pas à un auteur de changer sa vision, on ne le demande pas à un idiot qui n’a rien compris au film. Dans le domaine de la critique, ce n’est pas tant le film qu’il faut « comprendre », c’est le regard « de l’autre ». Avec sa bêtise et sa méconnaissance. Parce que le film, puisqu’on le vit comme une expérience, on le comprend toujours. « L’autre », beaucoup moins.
Ma réponse adressée sur la vidéo (considéré par Youtube comme du « spam ») :
Un « petit » commentaire histoire d’essayer humblement de vous éclairer, me semble-t-il, sur ce qui sépare vos différentes perceptions des choses et de la cinéphilie en particulier.
Je ne regarde jamais les vlogs, mais contrairement aux deux auteurs de l’article dont la présente vidéo se propose de répondre, je ne vois que des avantages à cette nouvelle manière de communiquer. Je ne regarde jamais les vlogs en question, mais je les ai souvent vus critiqués sur SensCritique. Or je pense pouvoir être plutôt objectif en défendant ni la position des uns ou des autres, et je voudrais en profiter pour revenir sur ce qui est évoqué en conclusion de cette vidéo parce que ça me semble bien illustrer le malentendu (ou l’incompréhension) qui vous oppose (moi aussi je n’ai regardé que l’intro et la conclusion de la vidéo).
Concernant d’abord la cinéphilie, et de la définition plus ou moins de ce qui se cache derrière cette pratique étrange. Vos « cinéphilies » ne sont certes pas du tout les mêmes, mais pour être franc, de la définition qui en est faite ici, je la trouve encore trop réductrice et révèle en fait un peu pourquoi vos perceptions de la pratique, de sa définition, peinent tant à se rencontrer. L’évocation d’Autant en emporte le vent par exemple laisse à penser qu’un film ne doit être perçu, jugé, évalué, ressenti, qu’en fonction de sa mise en scène. Peut-être y a-t-il autre chose, mais ça m’a un peu surpris, parce que de mon côté par exemple (et c’est bien pourquoi ça m’a étonné), je n’ai aucun problème à laisser de côté les considérations techniques et esthétiques dans un film si le sujet m’intéresse et si le développement de l’histoire, son traitement, trouve grâce à mes yeux. Ce qui m’importe avant tout, moi, spectateur, c’est l’histoire. Donc, pour essayer de schématiser, il me semble que ce qui vous sépare ici, c’est que d’un côté, pour l’un, c’est la mise en scène qui importe, et que pour les deux autres, c’est le sujet et les idées évoqués (pour d’autres, comme pour moi, ce sera encore autre chose).
La cinéphilie est multiple. On ne juge pas en fonction de critères objectifs, parce que même si on pouvait nous mettre d’accord sur ces critères à évaluer, on privilégierait toujours des critères par rapport à d’autres. Je ne crois pas du tout à l’idée qu’on puisse argumenter, échanger des « opinions » ou des « avis », encore moins des « thèses », car tout cela laisserait à penser qu’on puisse discuter de ce qui parmi ces critères devrait être prioritaire. Or, c’est à chacun me semble-t-il de décider pour lui ce qui lui importe en priorité : ça peut être l’histoire, le sujet, les idées, la réalisation donc, parfois aussi ce sera le seul critère du plaisir. Au fond, ce qui fait qu’on « aime » plus ou moins un film est déterminé au moment du film à travers une sorte de contrat passé avec lui (le film, voire le réalisateur, celui qui fait souvent office d’auteur ou de « narrateur »). On ne décide alors pas après coup en évaluant chacun des éléments dont on sait qu’ils importent pour nous ; on décide au fur et à mesure pendant le film d’y adhérer ou pas ; et parfois, de simples éléments, des thèmes, des approches, des critères à évaluer, peuvent nous faire basculer définitivement vers l’adhésion ou le rejet. Mais ces éléments nous seront bien souvent parfaitement personnels et déjà ici toute notre histoire de cinéphile, notre expérience avec ce qu’on tolère par habitude ou par choix, ce qu’on attend aussi d’un film, rentre en compte dans notre décision d’accepter ce « contrat ». Tout ce qu’on vient à penser, réfléchir, étudier, argumenter, par la suite, ne vient alors que conforter l’impression qu’on s’est faite pendant le visionnage du film. Et très rarement, en y repensant, nous sommes capables de revoir notre « jugement ». Peut-être justement parce qu’il n’est pas question de « jugement », mais plus de « ressenti », de réminiscence d’un ressenti, ou plus encore comme je l’évoquais dans ma réponse sur l’article, de « vision ».
Une vision (voire une « expérience »), on peine souvent à la partager, probablement d’abord parce qu’on trouvera difficilement les termes ou les clés pour la comprendre nous-mêmes. Nous adoptons des réflexes pour l’exprimer, on en vient à parler « d’argumentation », « d’avis », « d’opinion », mais c’est là à mon avis où on se trompe. Je pense qu’il est vain de penser qu’on puisse partager ces « visions ». Par nature, elles touchent à la sensibilité, à l’inconscient, et le langage, la raison, ne pourra jamais toucher ce qui au fond reste impalpable et mal compris de nous-mêmes. Ne regarde-t-on pas des films (ou ne partageons-nous pas notre intérêt pour l’art) justement pour en apprendre un peu plus sur nous et pour baliser toujours mieux un territoire abstrait tout autour de nous qui serait censé nous définir ? Quand on juge et se pose dans une salle, commente, un film de Scorsese ou d’un autre, est-ce que c’est le film qu’on va voir ou est-ce que c’est l’image de nous-mêmes qu’on sera bientôt capable (on l’espère) de pouvoir projeter à notre tour à nos proches et/ou à nous-mêmes ? Comme disait l’autre, dis-moi ce que tu aimes je te dirai qui tu es.
Bref, je m’égare. Tout ça pour essayer de mesurer tout ce qui vous sépare et ne vous fera sans doute jamais adopter une même posture « cinéphile ».
J’en viens à mon dernier point, évoqué en fin de vidéo aussi, et le lien avec ce qui précède sera facile à faire. Il est question du site SensCritique, et puisque l’auteur de la vidéo s’est montré particulièrement critique à l’encontre du site (et de manière générale aux sites de notation et d’échanges « d’avis » si je comprends la logique), je vais un peu le défendre (et je suis pourtant un des membres les plus critiques du site, mais je suis un gros consommateur « d’outils d’évaluation ou de check » de ce genre comme IMDb ou icheckmovies.com).
J’écris plus haut qu’il me semble vain de penser qu’on peut partager nos « visions » des films. Pour autant, je ne pense pas qu’il soit vain d’essayer de le faire. Cela peut paraître paradoxal, pourtant reconnaître une certaine forme d’incommunicabilité ou d’impossibilité de faire ressentir aux autres ce qu’on a « vu » ou « ressenti » ou « expérimenté », c’est une chose, et essayer de le faire en est une autre. Toute la différence se situe en fait dans l’effort produit à essayer de comprendre et à aller vers l’autre, vers sa « vision », parce que si on ne peut jamais adopter la « vision » de cet autre étranger, je pense qu’on ne cesse d’élargir « notre vision » en nous forçant à regarder ailleurs, en particulier en dehors de cette zone de confort qu’on cherche le plus souvent à défendre, à délimiter, et à, vainement donc, expliquer. Essayer de se mettre à la place de l’autre, c’est une forme d’empathie, et je suis peut-être naïf ou idéaliste, mais je pense que l’art, ou plus précisément ici le « spectacle », s’il a une utilité, c’est bien de nous pousser à aiguiser cette qualité qui a fait de notre espèce fragile, l’espèce dominante sur cette terre (et au-delà !!! – avec la voix de Buzz l’éclair pour les vieux). (Attention, tunnel explicatif barbant, ou comme disent les savants : « pileux »). Oui, l’empathie a sans doute été le moteur poussant notre espèce à développer un monde abstrait, le forçant à se projeter d’abord au-delà de son temps (prévoir) pour préserver ses congénères les plus faibles, en lui réclamant sans cesse plus d’habileté pour concevoir des procédés lui permettant de se rendre maître de son espace face aux menaces des espèces concurrentes, et enfin, et c’est sans doute le plus important, lui ouvrant en grand les portes des mondes imaginaires, mêlant alors le cultuel au culturel. L’homme est une espèce sociale qui a besoin de se tourner vers l’autre, y trouve du plaisir à échanger, objets et idées, et tout cela s’est marié avec une capacité à communiquer hors du commun (une souris me souffle à l’oreille que d’autres espèces ont développé des modes de communication plus élaborés et sans doute plus efficaces, mais on s’en tape, quelle emmerdeuse). Une capacité à communiquer utile, à faire dire à ceux auxquels on tient qu’on les aime, aux autres qu’ils nous insupportent, et d’autres fois, quand on fait quelques efforts d’intelligence, aux étrangers combien leur « vision » nourrit la nôtre et combien on espère aussi un peu nourrir la leur (en réalité, les insultes sont apparues bien avant le mode « diplomatique » mais j’essaie de simplifier mon cours car c’est en général à ce stade qu’on finit de me lire et qu’on commence à me traiter d’emmerdeur péteux, insolant, inculte et moche). De cette empathie, nécessaire à notre survie (je me préoccupe en fait pas du tout de la survie de notre espèce, je n’en ai rien à foutre, mais on va prétendre pour les âmes sensibles), sont donc nés à la fois le langage et l’imagination. Or il y a deux « phénomènes » propres à notre espèce (encore) qui utilisent l’un et l’autre pour ne cesser de nous mettre à l’épreuve et nous rendre plus performant : c’est le rêve et l’art de la représentation. Tous deux sont des phénomènes qu’on pourrait imaginer être bien différents, qu’on pourrait aussi penser être accessoires dans nos vies, or ce sont deux phénomènes qui « simulent » le monde, nous plongent dans des situations dangereuses à travers lesquelles, toujours grâce à notre empathie, on est capable de nous plonger intensément au point de ressentir souvent les émotions des « êtres imaginés » rencontrés, de comprendre les conflits qui les animent, leurs peurs, les enjeux qui les poussent à avancer. Le langage intervient assez peu dans nos rêves, mais pour ce qui est de l’art de la représentation (les vieilles histoires qu’on se racontait dans les cavernes, les vieilles légendes, les mythes pour expliquer le monde, etc.) c’est presque un langage à lui seul, avec une structure, des codes qu’on retrouve d’un bout à l’autre de la planète et qui n’ont sans doute pas évolué depuis la nuit des temps. Si on en vient aujourd’hui depuis un siècle à parler parfois de langage pour le cinéma, c’est en réalité depuis cette époque que plusieurs « langues » cohabitent, se nourrissent, pour favoriser et entretenir l’avantage évolutif, voire sociale très vite, à disposer d’un langage ou d’un savoir riche et varié. L’art se communique, il est fait pour ça, ce qui veut dire qu’il se structure à travers un émetteur (un auteur ou un récitant, un metteur en scène), qu’il se transmet et se reçoit, mais aussi qu’il se… commente. (Toutes ces conneries sur l’évolution à dormir debout pour en arriver là.) Pas d’art (ni de langage d’ailleurs) sans dialogue.
Le langage n’a pas été créé dans le but (façon de parler, pas de déterminisme ici) de donner des ordres, dire ce qui est, mais au contraire pour poser des questions et y répondre : « Quelle est cette pierre ? est-ce que tu l’échangerais contre cette plume ? » « Ma foi, vois-tu, étranger, c’est que cette pierre est précieuse, je l’ai échangé avec un émissaire du dieu Peta Houch-Snock ; en échange de ta fille en revanche, je dis pas non ! » « It’s a deal ! ». (Remarquez combien très tôt on maîtrisait l’art du point-virgule et le bilinguisme cool).
L’art, si pour moi ne « dit » rien (il est absurde de se demander ce qu’un « auteur » a voulu dire, en revanche il me semble plus juste de nous demander ce qu’une histoire, une « représentation » nous dit, nous raconte, à la fois sur nous-mêmes, les autres ou le monde) a cette fonction de nous faire parler, nous pousser à l’échange, nous questionner, nous opposer, nous étonner des « visions » étrangères à la nôtre, et au bout du compte nous force à adopter un point de vue sans cesse moins rigide et intolérant. L’imagination pousse au langage, le langage pousse à la confrontation des idées et des « visions », la confrontation pousse à l’imagination de solutions ou de visions étrangères, et « l’étrange(r) » devient ainsi familier. D’un monde obscur, étrange, craint, on a fait un nouvel espace, on se l’est approprié, et on compte bien venir y faire camper des amis (nos ouailles, parfois). Dans les cours d’école, on a tout compris, parce qu’on résume très bien tout ça, on y explique « qu’on finit moins con ». On entretient son « pré carré » ou on développe son « champ de visions », c’est au choix.
Toute cette démonstration abrutissante pour essayer d’expliquer (pas vainement j’espère) en quoi il me semble que tout partage de ces « visions » est bienvenue, nécessaire, pour tous, même si on ne fait jamais que lâcher des pistes que pour que ceux qui nous lisent, nous écoutent ou nous regardent, comprennent par eux-mêmes ce qu’ils ont « vu » ou trouvent des « angles » pour les exprimer à leur tour. Cela vaut autant pour les « critiques » ou « commentaires » exprimés sur des sites comme SC que dans des vlogs, car les deux ont la même finalité depuis l’avènement d’Internet rendant accessible et possible le partage massif de ces « visions » (et des « visions » exprimées pas forcément « instantanées » comme cela a été reproché, puisque tout ce qui est sur le Net a plus ou moins vocation à le rester sur la durée). À côté du regard critique « professionnel » (dont les usages cachent souvent en fait une manière tout aussi personnelle de « voir » un film), ce qui est parfois nommé « avis », « commentaires » voire « critiques » sur SensCritique ou tout autre site de ce type, c’est une richesse dont on devrait se féliciter plus que s’offusquer ou s’inquiéter. Que nous soyons ensuite maladroits, passablement intolérants avec les « visions » des uns ou des autres, importe finalement peu, car nous sommes tous là à faire la même chose, même avec un minimum d’effort : nous échangeons, nous rentrons plus ou moins en empathie avec des « étrangers » pour comprendre leur position (ne serait-ce que pour la caricaturer et pour balancer des ad hominem faussement aveugles), nous exprimons la nôtre de « vision », et tous ça participe malgré tout à une société intelligente qui fait l’effort de se construire un imaginaire commun, une culture commune, des clés de compréhension communes… C’est là où je ne rejoins pas du tout les deux auteurs de l’article. La vision académique, rigoureuse, que peuvent porter certains « commentaires » érudits, sera toujours importante, mais la possibilité qui nous est offerte depuis vingt ans de démultiplier les rencontres, nos paroles et le partage de nos « visions » de simples béotiens, c’est aussi une richesse dont on aurait tort de se passer. Il me semble que c’est un fait historique (les grands connaisseurs me corrigeront si nécessaire) : chercher à réduire les échanges, la communication, le dialogue n’a jamais été le signe d’une société bien portante. Au contraire, mieux les échanges se portent, mieux la société se porte, et la culture avec. Internet me fait l’effet d’un grand caravansérail où se rencontrerait le pire comme le meilleur des échanges du monde : pour qu’un plus grand nombre puisse accéder au « meilleur », il faut accepter aussi que transpire par les mêmes réseaux le « pire ». Sinon c’en serait à en perdre son latin (comprendre : on ferme la clé, on reste entre grands érudits, on ne partage plus, on n’échange plus, on ne se force plus à aller vers l’autre, et au bout du compte, on meurt avec nos certitudes, notre expertise, et on laisse derrière soi un grand désert).
Notes, collections, listes, sont aussi utiles dans cette optique d’échange. Ce ne sont que des outils, je ne pense pas que beaucoup les prennent autant au sérieux. Ils servent d’amorce en quelque sorte pour les échanges, les découvertes, les discussions, même si le plus souvent il faut l’avouer, ces échanges sont très limités. Mais rien que pour soi, ces outils permettent de mettre de l’ordre dans ce qu’on a vu : avoir une meilleure « vision » de ce qu’on a « vu ». Voyez l’idée ?…
Celui-dont-je-ne-sais-ni-écrire-ni-prononcer-le-nom-ou-le-pseudo n’est peut-être pas brillant, il est peut-être maladroit, inculte ou je ne sais quoi, mais il exprime une « vision », la sienne, et par la popularité de ses vlogs transmet, cultive, une passion, une pratique vieille comme l’art, comme la critique, comme le langage, comme la religion (ou le « mysticisme, le « cultuel »). C’est une vieille tradition nécessaire. Elle n’est sans doute pas parfaite, mais elle pousse, oui, oui, à l’intelligence de chacun, à la rencontre, à l’empathie, à la compréhension… Est-ce que d’un côté comme l’autre (vlogeur comme hum… « articuleurs » – je me qualifierais humblement pour ma part de « marmonneur ») vous n’avez pas l’impression d’avoir appris quelque chose de ces échanges, d’avoir… agrandi votre propre « champ de vision » ? d’avoir, après quelques empoignades et égarements, fait un pas vers l’autre, pour le comprendre ?… Comprendre « sa vision » ?
Je repars. Je m’étais toujours dit que ça ne sentait pas suffisamment le pâté sur YouTube. Voilà qui est réparé.
lien vers la réponse au « post » du youtubeur
Un grand merci à trineor pour ses efforts et sa compréhension, ainsi qu’un big up (?!) à l’algorithme de YouTube ayant mis ma réponse à la poubelle.
Je m’en vais tailler ma haie.