Violence II Society

Menace II Society
Année : 1993
Réalisation : les frères Hughes
Avec : Tyrin Turner, Larenz Tate, Samuel L. Jackson, Charles S. Dutton
Je poursuis mon voyage à travers les films de gangs des ghettos de Californie après Boyz’n in the Hood.
Assez peu convaincu. La distance avec la violence me paraît toujours suspecte. Dans l’ensemble, malgré la morale de l’histoire et l’usage du récit à la première personne, le film manifeste une certaine complaisance envers tout ce que véhicule de toxique cette société. Dès la première séquence, deux guignols s’en prennent à un couple coréen qui tient une supérette parce que le commerçant aurait dit quelque chose de travers (on apprend sur IMDb que la phrase proférée au départ était censée être ouvertement raciste, alors que « je plains ta mère » serait plus subtilement raciste… une manière de justifier le meurtre, on rêve).
La suite est du même acabit : ça tire sur n’importe qui à cause d’un mot de trop, et cette violence semble irriguer tous les aspects du quotidien au point qu’on peine à concevoir un autre mode d’expression ou de recours pour régler des conflits souvent mineurs. En dehors du racisme sous-jacent de ces brutes qui tirent sur des Coréens, qui s’injurient en permanence en se traitant de « négro », la même vision sexiste déjà observée chez John Singleton, traverse le film. Ajoutons ici l’homophobie.
Ce sont des brutes, certains pourraient arguer que le film a une valeur illustrative. Après tout, dans Les Affranchis, Scorsese explore une violence similaire. Je n’en suis pas sûr. Soit un film de gangsters montre une société pourrie à tous les stades de son développement et l’on en dévoile tous les aspects à travers les yeux de quelques personnages qui navigueront dans cet univers (certes parfois avec une certaine fascination, mais non pas sans distance : ces univers mafieux deviennent des allégories de toutes les sociétés), soit il montre des personnages qui sont victimes de leur environnement bien plus qu’ils en sont acteurs volontaires. Rien de tel, ici. Au contraire des personnages paumés, victimes de leur environnement, eux l’acceptent et ne cherchent jamais à le questionner (seuls les grands-parents et les femmes semblent prendre conscience de l’environnement particulièrement toxique dans lequel ils évoluent, tous les personnages qui sont acteurs de cette violence l’acceptent comme une société où il faut faire ses preuves, où il faut se faire justice soi-même).

Et puisqu’on n’a pas non plus un regard transversal ou exhaustif, un regard capable de « mystifier » ces relations mafieuses entre divers types de truands et victimes pour en faire des éléments exceptionnels de la société représentée, mais au contraire, puisque ce regard est concentré sur un groupe d’amis gangsters sans envergure, on n’a même pas la distance sociale ou pédagogique (voire, oui, souvent ludique) des films de gangsters qui permettent un pas de côté pour ne pas laisser supposer qu’on adhère à ce que l’on décrit. Le point de vue porté sur ces personnages devient nécessairement moins distant et interdit toute critique possible : ce ne sont pas des archétypes, des modèles, des antihéros qu’on met en scène, mais des « monsieur tout le monde » vers lesquels on demandera puisqu’ils sont « communs » un effort d’identification. On accepte le côté ludique des films de gangsters comme on le fait avec tous les films de genre observant des codes spécifiques et adoptant la parfaite distance.
Je peux prendre d’autres exemples : si un Joe Pesci est dépeint comme un psychopathe dans ses personnages de mafieux chez Scorsese, c’est balancé par le regard « distant » qu’apporte alors son comparse Robert De Niro qui, lui, malgré ses agissements ne « joue » pas les fous (ce qui peut poser d’autres problèmes, mais l’effet est paradoxal : on prend de la distance avec le sujet parce que son personnage nous paraît moins réaliste en s’approchant de la normalité ; s’identifier à lui, c’est s’écarter de la violence qu’on nous présente).
Pour le spectateur, ces films possèdent toujours l’espoir, à travers cette « normalité psychologique affichée », qu’ils puissent à tout moment regretter la violence qu’ils déploient. Leur culpabilité et leur brutalité résulteraient de leur condition de victimes d’abord consentantes d’un milieu. À force d’en tolérer les règles, ils finiraient par se sentir coupables. C’est tout le sens d’ailleurs de certaines thématiques liées à la rédemption ou à la réhabilitation dans ce type de films. Nous en acceptons la violence si au moins quelques personnages reconnaissent le rôle néfaste qu’ils tiennent dans leur société. Dans Scarface, par ailleurs, le protagoniste est fou, mais le récit se place à bonne distance. Ce que l’on y voit, c’est le parcours d’un jeune arriviste, un peu lunaire, plein d’enthousiasme et d’une soif de réussir maladive : montrer son ascension sans son violent déclin n’aurait aucun sens (à moins d’adopter une approche plus distante dès le début en se plaçant dans le registre de la satire, de la comédie ou de l’esthétique). Ce que révèle Scarface, c’est la réalité d’un mirage, celui de l’argent facile, celui de la criminalité glamour. Le mirage, à l’image d’une drogue, dévoile très vite ses revers et finit par vous être fatal.

Ce sont des parcours initiatiques, des récits qui se veulent mythologiques. Ici, comme dans Tueurs nés (avec des protagonistes ouvertement présentés comme fous de violence), aucune distance, aucune réhabilitation possible. On nous incite à prendre plaisir à partager cette violence gratuite avec les personnages. Elle ne possède pas non plus, comme chez Tarantino ou John Woo, une valeur esthétique, lyrique, voire poétique, et elle ne dispose pas d’un pouvoir cathartique sur les truands qui la déploie.
Ce serait d’ailleurs tout le danger de vouloir imiter les approches de Scorsese ou de John Woo sans en maîtriser les nécessaires outils de mise à distance (ces deux réalisateurs ont prouvé également qu’ils pouvaient rater cet objectif, par exemple dans Le Loup de Wall Street). Comme chez Scorsese, la caméra s’infiltre et vagabonde entre les personnages (si Scorsese avait donné le ton, et si ça deviendra la norme dix ou vingt ans après un peu partout au cinéma, à l’époque, les caméras sont bien plus statiques, et ça offre une modernité assez saisissante au film, bien plus que le film de Singleton). Mais Scorsese utilisait le procédé pour finir par isoler le personnage appelé (dans le meilleur des cas) à s’isoler de cet environnement, à lui tourner le dos. Et les fusillades ne manquent pas de jouer des ralentis. Sauf que chez John Woo, ces séquences stylisées sont le but avoué des histoires racontées : là encore, il n’y a pas de complaisance avec la violence exposée à l’écran si l’on produit clairement un film d’action, un film de gangsters, sans aucune volonté de dénoncer le milieu décrit qui pourrait tout autant ne pas exister (aucun naturalisme). Sans justifications alambiquées de la violence, paradoxalement, on évite la compromission et la violence : tout est prétexte à montrer des chorégraphies de balles qui volent et de coups de poing à la figure.
Rien de tout ça avec Menace II Society : c’est l’effet Tueurs nés. En cherchant à dénoncer la violence (ici la facilité avec laquelle on tue, et meurt), on la cautionne. Cela aurait été plus acceptable si le personnage qui raconte son histoire montrait réellement une volonté de sortir de son ghetto, s’il énonçait au fil de son récit des regrets, de la compassion envers ses victimes ; au lieu de ça, il ne vaut guère mieux que la plupart des autres guignols écervelés et machistes qui l’accompagnent. Son histoire à la première personne consiste presque à le faire passer pour une victime, alors que les victimes de ses violences sont traitées avec indifférence. Pour la rédemption, on repassera.
Menace II Society, les frères Hughes (1993) | New Line Cinema
Liens externes :
Si vous appréciez le contenu du site, pensez à me soutenir !
Réaliser un don ponctuel
Réaliser un don mensuel
Réaliser un don annuel
Choisir un montant :
Ou saisir un montant personnalisé :
Merci.
(Si vous préférez faire un don par carte/PayPal, le formulaire est sur la colonne de gauche.)
Votre contribution est appréciée.
Votre contribution est appréciée.
Faire un donFaire un don mensuelFaire un don annuel


 Année : 2008
Année : 2008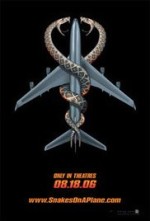


 Année : 1994
Année : 1994

