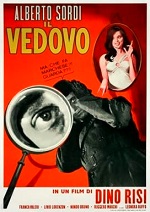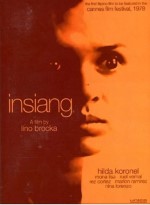Plongée brutale dans le monde sordide de Manille. Beaucoup de clichés sur la condition des femmes des grandes villes pauvres. À une ou deux reprises, on flirte même avec le soap (les soaps, c’est comme un éternel épilogue qui se ressasse où les protagonistes n’agissent plus et ne font plus que causer et pleurer, une forme de théâtre classique et moderne dans laquelle l’action est toujours passée et hors-champ — l’épilogue ici n’était pas vraiment nécessaire). Mais au-delà de ces excès excusables, j’avoue que l’on y rencontre beaucoup des aspects, par son sujet et son parti pris pour les femmes, et de la couleur des films avec Ayako Wakao où sa beauté, attirant des hommes toujours plus beaux parleurs, obsédés et lâches, s’impose à elle comme une fatalité sans cesse répétée, une beauté présentée non comme un don ou une chance, mais un fardeau responsable de diverses souffrances et supplices. On retrouve cette répétition de malheurs, jusqu’au comique parfois, dans le Justine du Marquis de Sade, et sans aller jusqu’à ces outrances, le parcours d’Insiang vaut surtout le détour pour son caractère représentatif de la condition des femmes dans le monde.
Insiang est donc bien servie par le malheur : dotée par la nature d’une composition agréable au regard, tout le monde ne pense qu’à la sauter. Ce monde-là d’hommes ne vit et ne parle que pour ça : de quoi parlent les hommes quand ils se réunissent ? De savoir si oui ou non ils vont enfin conclure (sexuellement, s’entend), de savoir qui couche avec qui, de savoir qui l’a déjà fait, de savoir lequel sera capable de toucher la poitrine de la serveuse, etc. Et à ce petit jeu vulgaire qui ne fait rire que les hommes, les femmes (qu’elles soient jolies ou non) n’ont jamais le beau rôle. Au point que même quand une d’entre elles tombe dans le piège d’un de ces sauvages, elles prennent rarement le parti de leur congénère et victime. À la violence et à l’insécurité physique et sexuelle, s’ajoutent la violence et l’insécurité psychologique : les agresseurs aux yeux de la société ne font que s’amuser ; les hommes ont tous les droits ; et plus tragique encore, même les femmes se rangent à cette idée. Il y a une forme de servitude volontaire dans ce manque de soutien des femmes entre elles. Le violeur est toujours un héros ; la femme violée, une tentatrice. On n’a probablement pas beaucoup évolué depuis que les femmes qui faisaient tourner la tête des hommes au Moyen Âge étaient brûlées pour sorcellerie. Une femme dans ces conditions, quand elle se fait violer, comme Insiang ici, ou comme les personnages d’Ayako Wakao, n’a d’autres choix que de se venger et de manipuler les hommes à son tour, souvent simplement ne serait-ce que pour échapper à son ou ses agresseurs ou pour se prémunir encore des suivants.
Rien de bien original là-dedans (même s’il faut reconnaître que ça pointe bien du doigt les mécanismes qui, à travers toutes les sociétés du monde, font des femmes les sempiternelles victimes des hommes), mais un regard aiguisé d’homme civilisé porté sur le comportement des hommes envers les femmes. Le seul male gaze véritable que je connaisse, c’est celui-ci, celui d’hommes cinéastes prenant à 100 % fait et cause pour les femmes victimes de la sauvagerie des hommes, de l’indifférence des autres femmes et de la société tout entière.
Brutal donc, réaliste, voire naturaliste. Mais c’est la force du cinéma aussi de savoir poser de tels constats et de rappeler certaines évidences qui font mal. On est loin des luttes virtuelles et désuètes lancées par les pseudo-féministes de ce siècle, incapables d’en rester à ce constat pourtant souvent encore d’actualité pour y préférer humilier et dénigrer les hommes qui ne les ont jamais agressées ou qui sont censés à leurs yeux leur voler une part du monde qui leur revient. Quoi que vous fassiez alors, cela sera vécu comme une agression, comme la preuve que vous appartenez à cette caste d’agresseurs de l’ombre : coupez la parole à une femme comme vous pourriez le faire tout autant à un homme, et vous voilà censeur misogyne ; prenez un peu trop de place dans un bus, et c’est la marque évidente de votre potentiel agressif misogyne ; réfutez la typographie inclusive, vous voilà démasqué dans votre refus de faire place à la féminisation sous toutes ses formes ; votre enfant porte des chaussettes bleues, et vous le préparez à se conformer à l’idée qu’il est un mâle voué à dominer des femmes formatées par leurs petites chaussettes roses. Oui, savoir pointer du doigt les bons problèmes, au cinéma comme ailleurs, c’est un talent et une nécessité sans quoi les solutions apportées ne font toujours qu’additionner de nouveaux problèmes aux anciens.

Insiang, Lino Brocka 1976 | Cinemanila
Un détail parlant du film résume le conflit intérieur presque schizophrène, voire racinien, d’un désir très vite porté en passion qu’une femme ne reconnaît pas toujours être responsable de ses malheurs : le frère timide de la meilleure amie d’Insiang, amoureux d’elle, sérieux, lui propose de partir loin comme elle en rêve. Le problème, c’est que les hommes gentils, discrets et sérieux, ça passe pour un manque flagrant de virilité et les femmes s’en détournent au profit d’hommes bien moins sûrs qui seront souvent leurs futurs agresseurs (et amants). Je ne suis pas sûr que l’attention que Insiang réserve à ce garçon serait bien différente dans une société occidentale de ce siècle. Un homme, pourtant, ça s’éduque. Si l’on donne raison aux types violents, audacieux et menteurs, en répondant à leurs attentes (y compris sexuelles), en valorisant leurs audaces grasses, en privilégiant parmi tous les autres qui se feront alors rares, en un mot si l’on récompense leur virilité mal placée, eh bien, ces hommes n’apprennent pas à respecter les femmes, à respecter leurs désirs contraires ou retardés (un simple « non » qui aurait pu se muer en « oui » franc et lascif en réponse à des assauts répétés mais attentifs et doux). Et l’on accepte que ces hommes, au détriment des femmes, ne vivent qu’à travers leurs petites satisfactions sexuelles éphémères. Un homme, ce n’est pas différent d’un môme ou des clebs, il faut lui apprendre les bonnes manières et lui apprendre à réfréner ses pulsions. Ce que Insiang fait d’ailleurs très bien avant d’être victime de deux hommes lâches et violents gouvernés par leur instrument frétillant. Eux sont encore joyeusement et égoïstement esclaves de leurs pulsions sexuelles, de véritables pulsions destructrices que personne encore n’a su (surtout pas eux-mêmes) restreindre et dompter, et l’on ne parle pas ici d’une certaine propension que pourraient avoir certains à couper la parole ou à s’étaler sur une place de bus. C’est la différence entre un homme sauvage et un homme civilisé. Et soit dit en passant, je range nombre d’hommes modernes se proclamant fièrement féministes parmi les tartuffes cherchant à s’attirer les faveurs des femmes pour mieux les tromper ou simplement pour se conformer à des idées derrière lesquelles on se réfugiera d’autant plus facilement qu’elles restent vagues et mal définies (la conformité, c’est comme la paix sociale, c’est une forme d’invisibilité qui vous permet sans grands efforts d’être accepté par les autres, d’être « conforme » en vous déclarant simplement « en être » comme les autres). Derrière cette nouvelle forme d’hommes trompeurs et menteurs se cachent les nouveaux sauvages ; et les femmes semblent encore beaucoup plus attirées par ces hommes habiles et dangereux, que par ces autres mecs timides, respectueux et discrets à qui elles ont trouvé un nouvel adjectif pour se moquer de leur manque de virilité (et donc d’attirance pour elles) : les « fragiles ». Dénigrer les individus de l’autre sexe pour leur signifier qu’ils ne nous plaisent pas en prenant un prétexte différent à leur renvoyer à la figure, c’est d’ailleurs une des marques usuelles des agresseurs mâles : on dira à une femme qu’elle est grosse par exemple pour bien signifier plus que nécessaire, et plus par goût de l’humiliation que cela devrait impliquer pour quelqu’un de ne pas se conformer aux désirs de l’autre, qu’elle ne nous plaît pas. Les extrêmes se rejoignent, surtout dans l’idée qu’on gagne sa liberté en l’imposant au détriment d’un individu plus faible, du moins dénigré, rabaissé par notre attitude envers lui.
Les « fragiles » pourtant ne mentent pas, n’abusent pas, n’ont pas d’arrière-pensée et ne violent pas. Quoique. Il faut se méfier de l’autre qui dort : même si l’on peut difficilement qualifier le petit ami d’Insiang de « fragile », il aime à se présenter à elle comme un garçon tout ce qu’il y a de respectable, et par conséquent un type d’homme qui ne la viole pas. Un loup dans la chaumière de grand-mère. À ce stade, la question de savoir si elle est conscience de l’état d’esprit de son amoureux reste ouverte ; nous voyons, nous en tant que spectateurs, toute la bassesse et la dualité du personnage avant qu’il parte une fois obtenu ce qu’il cherchait, mais la jeune fille en était-elle tout aussi consciente que nous avant leur nuit à l’hôtel ou était-elle naïve et aveugle comme sa mère, cela n’est pas évident. Et quoi qu’il en soit, sans en arriver jusqu’au viol, son petit ami présente finalement malgré sa gueule d’ange tous les aspects d’un dangereux hypocrite en quête d’aventures sexuelles. Difficile pour une femme de se faire une place parmi les loups : une femme qui n’a pas encore vu le loup et qui se jette malgré elle dans sa gueule, et voilà la tragédie philippine d’Insiang — comme les Malheurs de Justine — qui commence.
Quant au frère de sa meilleure amie, Insiang l’écoute, indifférente, lui proposer de partir, lui dire qu’il n’avait jamais osé lui dire qu’il l’aimait jusque-là, et elle ne semble pas le croire ou vouloir le croire parce qu’on a dû lui faire cent fois. Son aveu la laisse de marbre, et on ne reverra plus ce frère éconduit (le récit joue parfaitement l’affaire en intégrant à l’histoire ce personnage comme une possibilité laissée à Insiang, une chance à saisir pour s’extirper de son destin, une occasion manquée, qui se révélera donc être une fausse piste, une piste en tout cas vite rejetée par Insiang — et une indifférence qui à elle seule en dit beaucoup sur l’aveuglement ou la naïveté tragique de ces femmes).

Bref, un homme qui n’insiste pas, c’est tellement peu séduisant, tellement peu rassurant pour une femme qui se sentira tellement plus en sécurité aux côtés d’un beau parleur et d’un type à la virilité (et donc à la violence) plus affirmée. C’est une question de violence indomptée, de désirs destructeurs, ce n’est pas qu’une question de choix ou de valorisation sociale et culturelle de certains types d’hommes plus que d’autres, c’est aussi tout simplement des femmes qui répondent à leurs désirs les plus primaires. Alors oui, ça leur fait beaucoup de choses à dompter dans ce monde, mais s’il fallait attendre que le monde tourne rond grâce aux hommes, seuls, je crois que l’on pourrait encore attendre longtemps. La civilisation, elle naît aussi, et entre autres, de la capacité de la femme à dresser ses propres désirs (favoriser les mecs dociles et droits) et à dresser les hommes qui s’appliqueront à combler ces désirs. Une civilisation faite et par les hommes est une civilisation vouée à se bouffer de l’intérieur, c’est une civilisation en quête permanente de nouveaux territoires, une civilisation en lutte permanente interne pour s’arroger le gros du pouvoir, et finalement, une civilisation vouée à la disparition parce qu’elle ne construit rien : c’est Gengis Khan, en somme.^^
Une civilisation qui construit au contraire, c’est une civilisation où les hommes sont tenus en laisse au lieu de rêver à de grandes conquêtes sauvages, c’est une civilisation où les femmes ont le pouvoir d’être craintes au moins pour ce qu’elles sont, les égales des hommes, et non vues comme des objets de conquête ou d’échange. Un homme qui veut conquérir une femme, c’est un homme qui veut tout autant conquérir le monde pour l’assujettir à ses désirs, le contraire d’une civilisation donc. On ne conquiert pas une femme, on s’entend avec elle, comme on s’entend avec la société. (« Mademoiselle, je m’entends avec vous passionnément ! — Comment, ne voudrais-tu donc pas conquérir mon cœur ? — Oh, non, belle demoiselle, je ne souhaite rien de plus que de m’entendre avec vous ! — Ne serais-tu pas prêt à décrocher la lune pour moi ?! — Oh, non, ma belle, je veux vivre en bonne intelligence avec vous, que nous nous ennuyons ensemble jusqu’à la fin de nos jours ! — Joli programme ! Ne voudrais-tu pas te faire moine à la place ?! — Que nenni ! Que voudriez-vous que je fasse pour vous séduire ?! — Mais voyons, Monsieur, je rêve de chevaliers blancs ! Un homme qui présente bien au regard de la société, et un homme, un vrai, qui saura me botter les fesses dans l’intimité de notre couche ! — Un homme madame, qui partira faire de nouvelles conquêtes dès qu’il vous aura engrossée ! — Oui, et non ! Un homme comme cela, mais un homme qui laissera son cheval à l’étable et sa lance dans le porte-parapluies ! — Madame, un homme qui a un cheval et une lance finit toujours par repartir à l’assaut d’une nouvelle forteresse ! — Que tu m’ennuies ! — Merci. — Reviens quand tu auras fait la guerre pour moi. Sinon, ne reviens pas ! Je suis digne d’être aimée par un homme, un vrai ! Un homme viril et féministe ! Pas d’être seulement… entendue par un confident ! »)
Ce monde décrit par Lino Brocka est un enfer pour tous, et c’est probablement un enfer qui est encore une réalité pour beaucoup de populations dans le monde, mais c’est un enfer où le plus souvent les sociétés sont des sociétés d’hommes. Des hommes victimes d’une société sans pitié, dure, corrompue ; des hommes victimes dont la puissance frustrée et laminée par une société malade, viendra s’exercer sur plus faibles qu’eux : les femmes et les enfants. Je ne parlerais pas de patriarcat parce que ça ne veut rien dire, surtout dans une société qui me semble surtout mourir de ses inégalités et de son absence de droit (d’ailleurs, on voit bien qu’il n’y a pas de patriarche dans le film, mais une matriarche aveugle, froide et avare), mais donc bien de sociétés d’hommes : ils sont comme des cafards dans le film : paresseux, violents, ivres et manipulateurs (tous les composants d’une société corrompue et inégale), tandis que les femmes sont, en dehors de la matriarche, dignes, besogneuses et soumises. Les femmes rasent les murs et se mettent au service des hommes, souffrent autant que les hommes des injustices qui parsèment la société, souffrent bien plus encore des agressions et de l’insécurité physique, mais n’ont pas encore pris conscience que leurs malheurs prennent racine dans ce rapport de force constant où au lieu de s’unir contre une oppression commune, on cherche à trouver plus faible et soumis que soi. (C’est même flagrant dans le film : les hommes sont parfois relativement, et faussement, solidaires, alors que les femmes ne le sont jamais entre elles. Comme dans toutes les sociétés pauvres et corrompues, on incite les plus pauvres et les plus soumis non pas à s’unir, mais à user de ces mêmes méthodes de soumission avec d’autres dans l’espoir un peu vain de s’émanciper un jour de ses grandes et petites contraintes — pour ne pas dire soumissions — sociales.)

La révolution sexuelle, celle capable de faire émerger une civilisation juste et apaisée, elle passe d’abord par une révolution du droit (la sécurité au sens large et la justice, ce qui a été probablement en Europe une conséquence de l’embourgeoisement de la société…) et une révolution quasi sociale des tâches : si les femmes ont un rôle supérieur par rapport aux hommes, c’est celui de dompter les hommes, de les humaniser, de les punir quand il faut comme on punit un enfant ou un chien récalcitrant parce que, encore une fois, un homme ce n’est souvent pas différent. Et le devoir des hommes alors, ce serait celui d’obéir. Si tant est qu’ils soient capables de reconnaître et de juger que les ordres qu’on leur donne vont dans le sens de la « civilisation », une idée de la civilisation dépourvue de corruption, guidée par le droit et le bien commun. Car le but n’est pas d’obéir aveuglément à une puissance supérieure, mais de comprendre que la civilisation, le droit, la justice, l’égalité, la société, c’est encore aussi le meilleur moyen d’arriver, pour un homme, à ses fins : niquer tant qu’il lui plaira. Enfin… dans certaines limites : tant que sa partenaire s’en contentera. (La liberté de niquer s’arrête là où commence celle de l’autre.) Les bons toutous font les bons citoyens.
Les hommes sauvages et les hommes civilisés ont cela en commun qu’ils sont avant tout des êtres sociaux : les petits sauvages draguent en meute, boivent et parlent de leurs aventures en société, et ce n’est pas très différent chez les hommes civilisés. La seule différence, c’est le niveau de violence induite dans les premiers groupes et les capacités productives d’une société sans violence chez les autres. Si les femmes sont de fait victimes des hommes, les hommes sont aussi les premières victimes de ces quelques hommes sauvages d’une société malade et corrompue. C’est encore bien montré dans le film : le goujat, qui s’est moqué d’Insiang en lui promettant monts et merveilles pour lui voler une nuit d’amour avant de partir avant le lever du jour, finira les dents cassées ; il l’a peut-être bien cherché, mais, de fait, il devient à son tour victime de la violence d’autres hommes, plus puissants, plus nombreux, et obéissant à la volonté assez légitime, mais extrême d’une femme. Le cercle vicieux se referme, et aucune autre justice, aucun droit ou autorité supérieure, ne vient s’interposer à cette justice personnelle.
Ces hommes-là sont aussi incapables, seuls, de dompter la sauvagerie qui les gouverne ; c’est donc toute une société, ces hommes supposément « fragiles » ainsi que les femmes qui doivent « faire société » et ne pas laisser de place dans cette société à ces hommes violents. Malheureusement, le féminisme misandre de ce siècle est à l’image de la matriarche du film, à la fois aveugle de la manipulation dont elle est victime, mais aussi incapable d’accepter ses responsabilités dans la manière dont elle traite sa fille et sa naïveté face au scélérat qu’elle a laissé entrer chez elle. Si les sauvages sont problématiques et profondément nocifs pour une société, les femmes tout à la fois acariâtres, misanthropes et misandres semblent toujours tiraillées par leurs désirs tout aussi sauvages ou penser qu’il y aurait un plus grand intérêt à se lier à ces tartufes virils (qu’ils en veuillent à leur argent ou à leurs filles) qu’à ces « fragiles » honnêtes et timides. Une sorte d’attirance-répulsion destructrice : une bête, on apprend d’abord à ne pas faire d’elle une bête, on lui préfère ses congénères plus dociles ; ensuite, tenter de raisonner une bête sauvage ou de s’en plaindre pour précisément ce pour quoi on l’a préférée à une autre plus docile, ç’a presque autant de sens que de raisonner un troll. On dompte une bête comme on dompte ses désirs.
Reste à savoir, pour en finir, si des femmes plus guidées par la défense de leurs droits que de leurs désirs, soucieuses de s’émanciper ensemble des mains de leurs bourreaux, peuvent émerger dans une telle société philippine, foncièrement traditionaliste, corrompue et patriarcale. Il est à craindre, avant que les femmes puissent faire valoir leurs droits, que les hommes aient obtenu largement les leurs. Le film date de 1976. La situation aux Philippines a-t-elle changé sur le plan des droits humains et des droits de la femme depuis ? Rien n’est moins sûr. Il y aurait encore à l’heure actuelle un système de corruption généralisée (appelé système Padrino) qui ne laisse guère espérer d’avancées en la matière.